Septembre 2016
Russie : l’éternel « retour de la puissance pauvre » ? / Par Arnaud Dubien
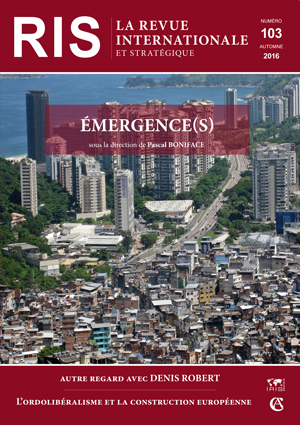 Émergence(s)
Émergence(s)
RIS N°103 – Automne 2016
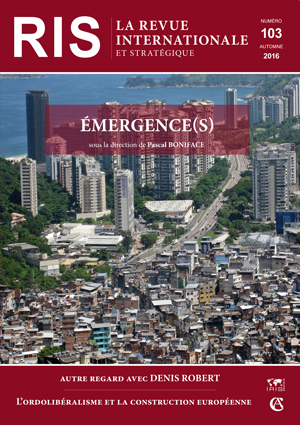
À l’approche du vingt-cinquième anniversaire de l’effondrement de l’Union soviétique, un spectre hante l’Occident, celui du retour de la puissance russe. Que ce soit pour s’en réjouir ou le déplorer, la plupart des observateurs admettent que la Russie a retrouvé, à la faveur notamment de la crise ukrainienne et du conflit en Syrie, une certaine ans les affaires internationales. Le temps où elle était comparée par Zbigniew Brzezinski à un « trou noir » [1] à envisager un « monde sans Russie » [2] semble bien loin. Paradoxalement, ce constat est fait alors que le pays traverse des turbulences économiques majeures : pour la première fois depuis l’accession de Vladimir Poutine au pouvoir, le 31 décembre 1999, la Russie va connaître au moins deux années consécutives de récession. Dans ce contexte, doit-on considérer la résurgence de la Russie comme une tendance éphémère, peut-être déjà révolue ? Où se situe le pays et que
Cet article est en accès libre sur Cairn.


