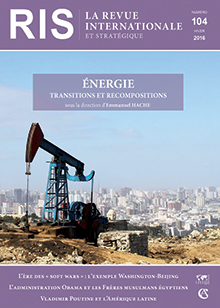
Problématiques régionales Le dernier pénalty. Histoire de football et de guerre / Gigi Riva, Paris, Seuil, Fiction & Cie, 2016, 192 p. Rédacteur en chef de l’hebdomadaire L’Espresso, Gigi Riva a notamment couvert les conflits des Balkans des années 1990. Avec Le dernier pénalty, il livre une histoire de la fin de la Yougoslavie au prisme du football. Le point de départ choisi par l’auteur se trouve en Italie : lors du quart de finale de la Coupe du monde de football 1990 opposant la Yougoslavie à l’Argentine, le capitaine Faruk Hadzibegic manque le tir au but décisif, entraînant l’élimination de son équipe, alors que son pays s’apprête à basculer dans la guerre. Le récit s’ouvre ainsi sur un épilogue dans lequel le lecteur suit l’actuel entraîneur de Valenciennes sur les terres anciennement yougoslaves, où tant Bosniens que Serbes et Croates n’ont de cesse de lui rappeler : « Ah ! Si vous l’aviez marqué ce péna
Cet article est en accès libre sur Cairn.

