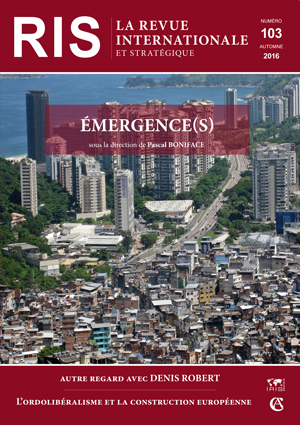
Problématiques régionales « Qu’on nous laisse combattre, et la guerre finira ». Avec les combattants du Kivu / Justine Brabant Paris, La Découverte, « Cahiers libres », 2016, 248 p. Comment raconter l’atrocité des drames qui persistent depuis vingt ans dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) ? La démarche de la journaliste Justine Brabant, qui a enquêté sur le terrain pendant trois ans, est d’un courage inouï à la vue des dangers de la région. Qui sont ces Mayi Mayi, dont on dit qu’ils pillent et qu’ils violent ? Pourquoi se battent-ils dans une série de conflits qui ont fait des millions de morts ? Comment sont-ils organisés ? Majoritairement agriculteurs et éleveurs, à l’occasion coupeurs de route, voleurs de bétail ou superviseurs de mines, ils prônent l’expulsion des Banyarwanda, ces rwandophones installés en RDC parfois depuis plusieurs générations ou venus après le génocide de 1994. I
Cet article est en accès libre sur Cairn.

