Septembre 2016
L’ordolibéralisme et la construction européenne / Par Michel Dévoluy
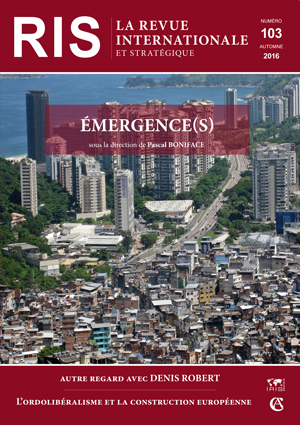 Émergence(s)
Émergence(s)
RIS N°103 – Automne 2016
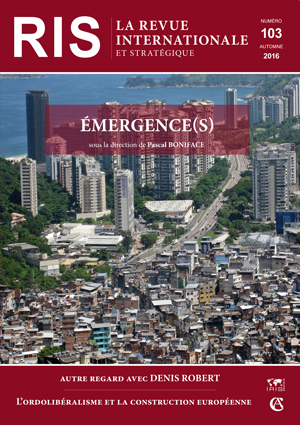
L’ordolibéralisme est une doctrine économique et sociale allemande née dans l’entre-deux-guerres. Ce courant de pensée servit d’abord de base idéologique au modèle rhénan d’économie sociale de marché. La construction européenne en fut ensuite imprégnée dès ses débuts. Son poids n’a cessé de s’accroître avec l’approfondissement du processus d’intégration. La preuve de sa centralité est aujourd’hui apportée par le contenu des traités européens et des politiques qui en découlent. Comprendre l’ordolibéralisme permet, par conséquent, de mieux déchiffrer l’histoire de l’Europe et d’éclairer les débats sur la responsabilité de cette doctrine dans le traitement européen de la crise enclenchée en 2008. Aujourd’hui, la référence à l’ordolibéralisme traduit souvent, en creux, une défiance vis-à-vis d’une Allemagne rigoureuse, autocentrée et intransigeante, adepte des cures d’austérité, réfractaire à la solidarité fina
Cet article est en accès libre sur Cairn.


