Septembre 2016
« Le vrai pouvoir est de cacher ce qui a été révélé » / Entretien avec Denis Robert
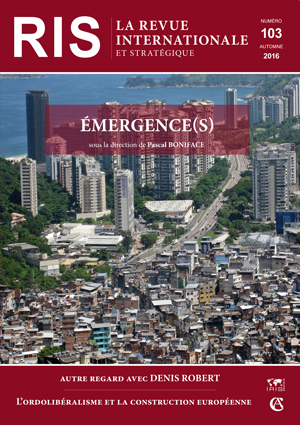 Émergence(s)
Émergence(s)
RIS N°103 – Automne 2016
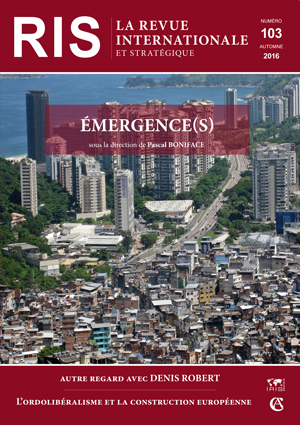
Denis Robert est journaliste, écrivain, réalisateur, producteur et plasticien. Diplômé en psycholinguistique, il entame une carrière de journaliste à Actuel, puis à Libération durant douze ans. En 1996, il réunit sept grands magistrats anticorruption pour lancer l’appel de Genève en faveur de la création d’un espace judiciaire européen dans le but de lutter contre le crime financier. À partir de 2001, ses livres Révélation$ et La Boîte noire (Les Arènes) et son film Les Dissimulateurs révèlent le fonctionnement de la société Clearstream. S’ensuivent dix années de procédures judiciaires à l’issue desquelles D. Robert est blanchi par la Cour de cassation et voit son enquête entièrement réhabilitée. Il est aussi l’auteur d’une dizaine de romans. Fin 2015, il sort sa première enquête depuis Clearstream, Mohicans (Julliard), sur la face cachée de Charlie Hebdo. En 2016, il publie une bande dessinée, Grand Est (Dargaud), avec Franck Biancarelli. P
Cet article est en accès libre sur Cairn.



