Septembre 2017
Le transport maritime face aux menaces sécuritaires / Par Hugues Eudeline
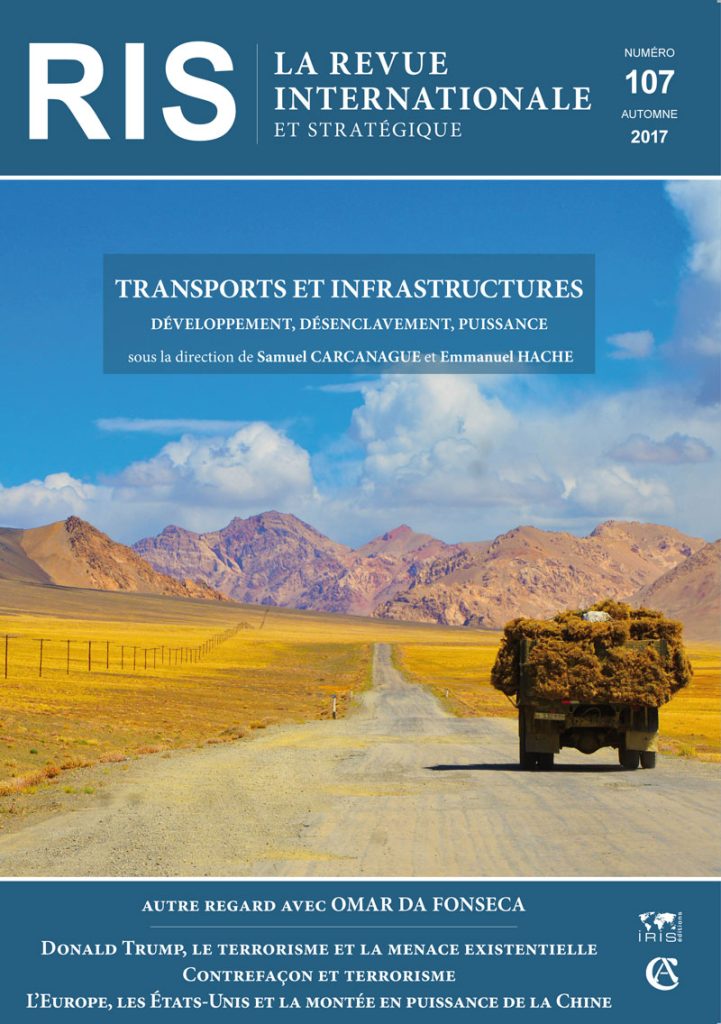 Transports et infrastructures : développement, désenclavement, puissance
Transports et infrastructures : développement, désenclavement, puissance
RIS N°107 - Automne 2017
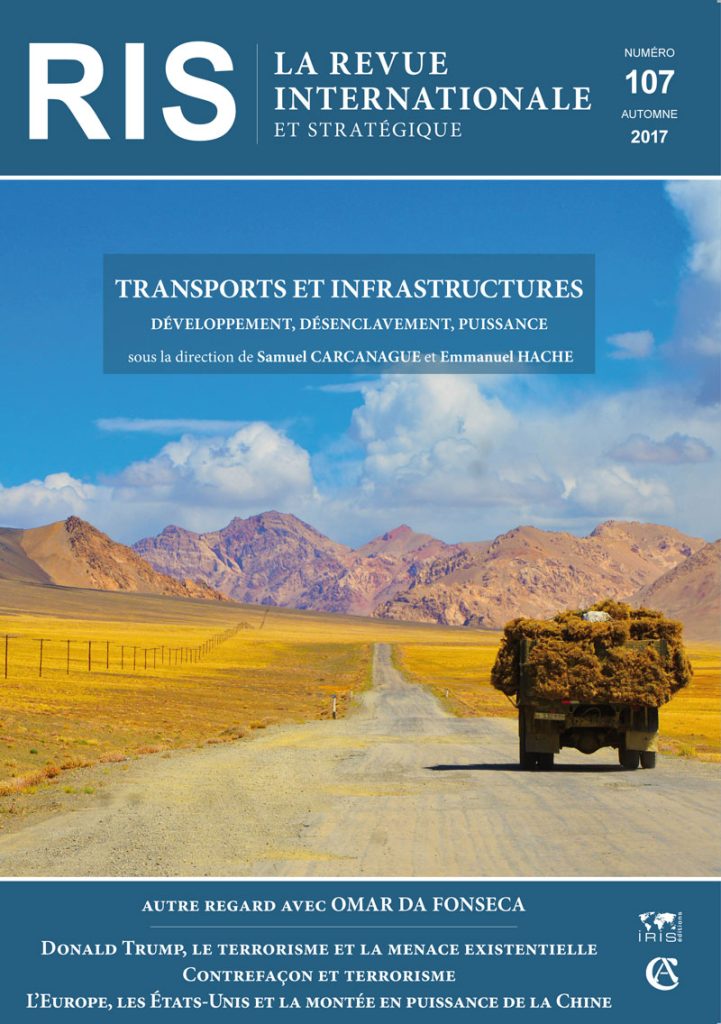
En 2014, la barre des 10 milliards de tonnes transportées sur les mers a été franchie. Ce chiffre avait alors doublé en l’espace de vingt ans. Il devrait encore croître de façon significative avec le projet chinois de « route de la soie maritime ». Le transport maritime assure aujourd’hui environ 90 % des échanges mondiaux de biens, 60 % des flux intraeuropéens et 78 % des importations françaises. À ces flux des biens s’ajoutent ceux des personnes, une activité particulièrement sensible qui connaît un développement très rapide par le biais de l’industrie de la croisière, dont la croissance mondiale a été de 7 % en 2015. Au 1er janvier 2016, 91 000 navires, avec une capacité d’emport de 1,8 milliard de tonnes et armés par 1,5 million de marins, parcouraient des espaces maritimes recouvrant 71 % de la surface terrestre. La liberté de navigation y prévaut en haute mer – au-delà de 200 milles nautiques des côtes – ; ailleurs, les n
Cet article est en accès libre sur Cairn.


