Septembre 2017
« L’Argentine est plutôt en phase descendante » / Entretien avec Omar da Fonseca
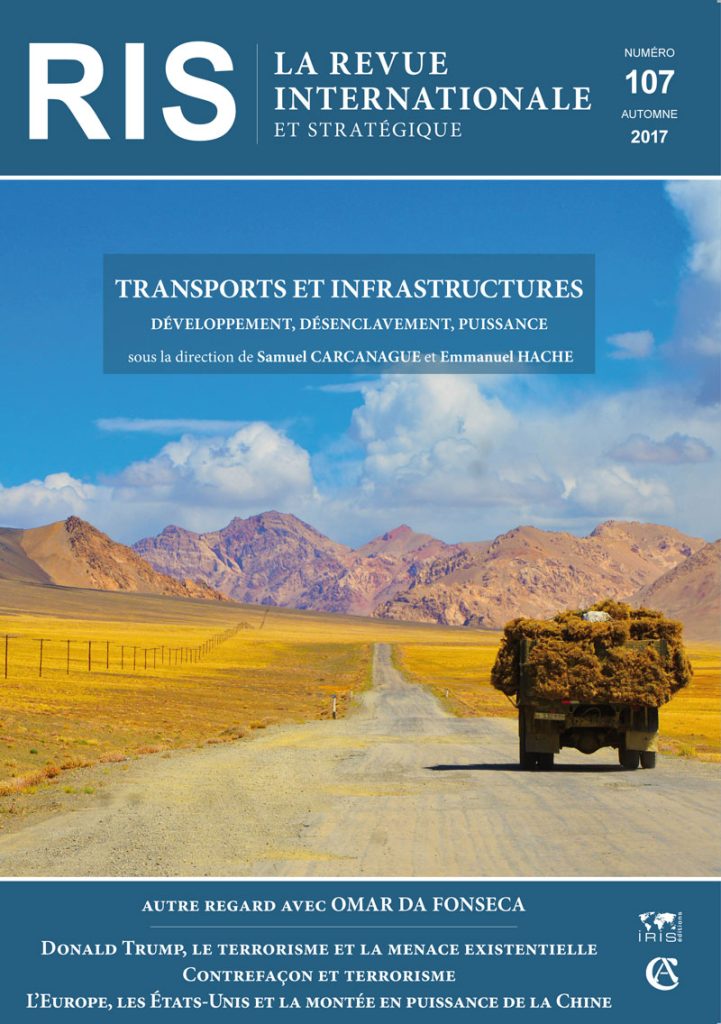 Transports et infrastructures : développement, désenclavement, puissance
Transports et infrastructures : développement, désenclavement, puissance
RIS N°107 - Automne 2017
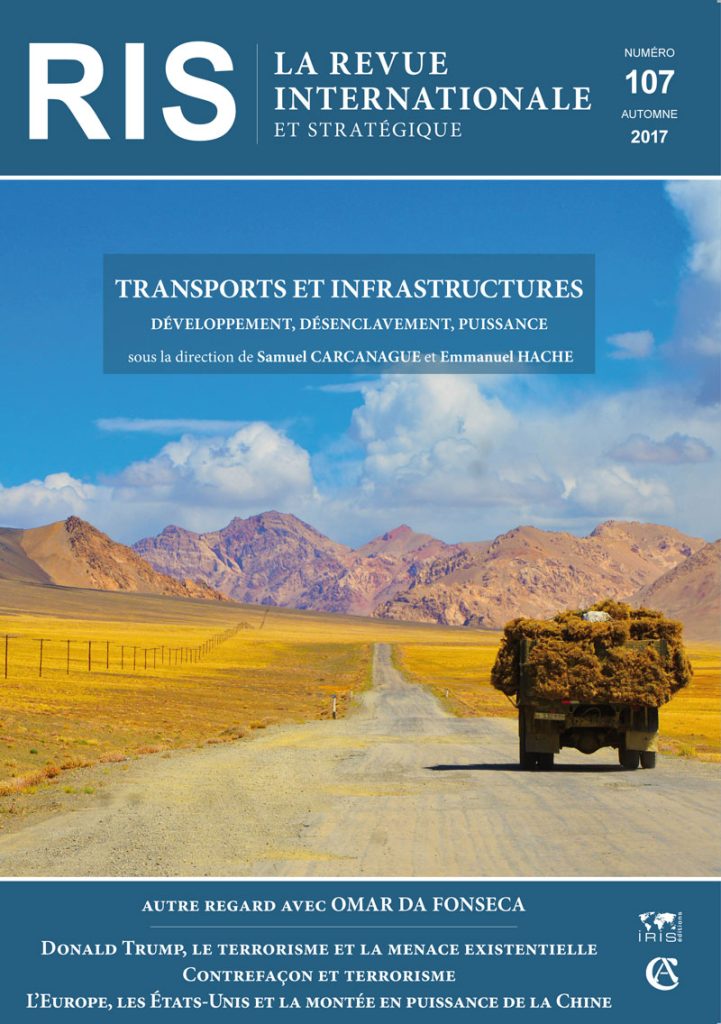
Pascal Boniface et Marc Verzeroli – Pourrions-nous revenir sur votre parcours et sur ce qui vous a conduit à devenir footballeur professionnel ? Omar da Fonseca – Je viens d’une famille de classe moyenne normale. Mon père était ingénieur en électronique. Très jeune, il a eu l’idée d’aller aux États-Unis parce qu’à l’époque, dans les années 1950, en Amérique du Sud, on utilisait le papier journal pour emballer les aliments quand on allait à l’épicerie. Il avait entendu parler de la production de plastique, et il est parti voir de quoi il s’agissait pour tenter de l’importer. Il a ramené une machine et a commencé à travailler dans son garage. En ce sens, il a été un précurseur. Lui avait fait des études, alors que mon grand-père était arrivé du Portugal. À la maison, tout le monde avait également fait des études et nous en parlions beaucoup. Ce qui est paradoxal, c’est que j’ai un frère qui est devenu ingénieur. Il est parti é
Cet article est en accès libre sur Cairn.




