Décembre 2016
L’administration Obama et les Frères musulmans égyptiens dans les révolutions arabes / Par Mohamed-Ali Adraoui
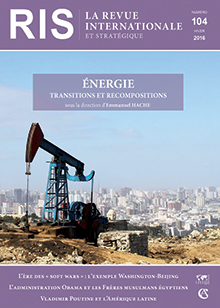 Énergie : transitions et recompositions
Énergie : transitions et recompositions
RIS N°104 – Hiver 2016
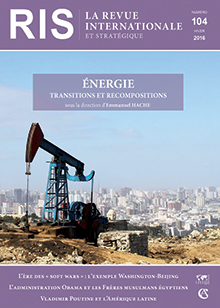
Les soulèvements qui ont caractérisé le monde arabe en 2011 ont eu pour conséquence notable de rapprocher dans de nombreux pays l’islam politique des sphères de pouvoir par le biais d’élections ouvertes et démocratiques. En Égypte, les États-Unis ont ainsi été amenés à (re)définir une véritable politique à l’égard du principal mouvement islamiste contemporain. Cette diplomatie à destination des Frères musulmans, et plus particulièrement de leur bras officiel – le Parti de la liberté et de la justice (PLJ) –, repose sur un ensemble de discours et de pratiques s’inscrivant dans le contexte d’un monde arabe en ébullition, mais plus largement sur une certaine compréhension intellectuelle de l’islam politique en tant que phénomène potentiellement radical, révolutionnaire et révisionniste [1]. Ces conceptions sont antérieures aux « printemps arabes », puisqu’elles alimentent depuis plusieurs décennies de nombreux débats universit
Cet article est en accès libre sur Cairn.


