Septembre 2016
La Turquie à la recherche d’une croissance forte et équilibrée / Par Asaf Savaş Akat et Seyfettin Gürsel
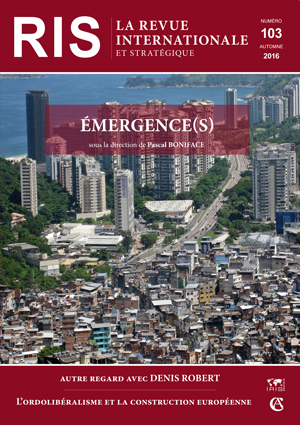 Émergence(s)
Émergence(s)
RIS N°103 – Automne 2016
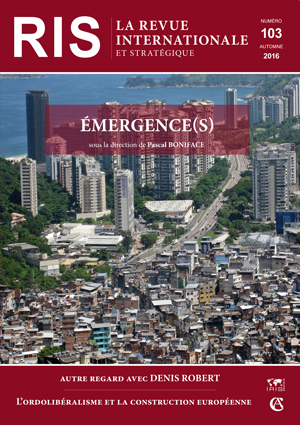
Les économies « émergentes » frappent par une diversité bien plus grande que les pays « développés ». Du point de vue des institutions fondamentales telles que l’État de droit, la démocratie, la transparence et la corruption, on ne peut classer dans la même catégorie ni la Chine et l’Inde, ni la Russie et le Brésil, ni non plus la Turquie, candidate à l’adhésion européenne malgré ses déboires actuels. Cette diversité englobe également les niveaux et modèles de développement. Le rôle des entreprises publiques, les stratégies d’industrialisation – substitution aux importations ou basées sur les exportations –, le degré d’ouverture ou de protection au commerce international, la liberté des mouvements de capitaux ainsi que l’étendue de l’État social diffèrent largement d’un pays à l’autre. La Turquie, qui occupe le deuxième rang au revenu per capita (tableau 1) de l’ensemble des pays composant les « éme
Cet article est en accès libre sur Cairn.


