Décembre 2018
La capitale qui n’existait pas : pouvoirs urbains et États fragiles en Afrique subsaharienne/Par Marc-Antoine Pérouse de Montclos
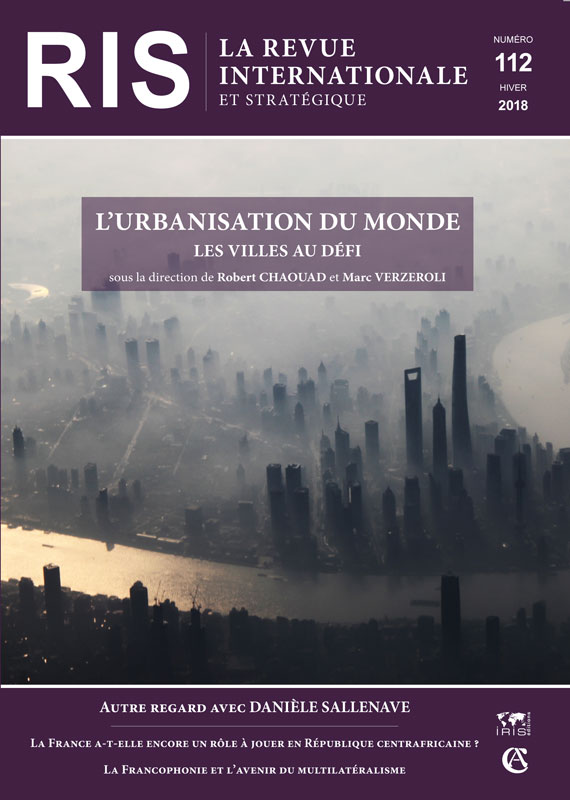 L’urbanisation du monde. Les villes au défi
L’urbanisation du monde. Les villes au défi
RIS 112 – Hiver 2018
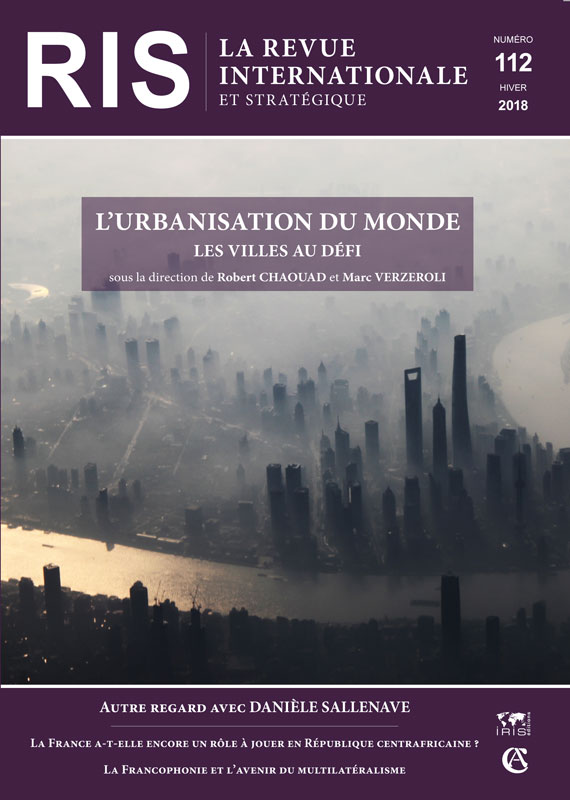
En Afrique subsaharienne, les capitales sont souvent des villes « imparfaites », excentrées et portuaires. Leur désorganisation plus ou moins apparente est à l’image d’États inachevés : il n’y a ni cadastre ni plan d’occupation des sols, et la poussée urbaine s’effectue essentiellement de manière informelle, en dehors du contrôle officiel des autorités. Dans certains cas, il est même permis de se demander s’il existe vraiment un gouvernement en place. Mogadiscio ou Kinshasa, par exemple, n’apparaissent pas comme le centre géographique et politique d’un pouvoir qui, dans les faits, peine à se matérialiser autrement que par la violence. Leur importance stratégique s’apprécie plutôt lorsque la ville-capitale est la cible de putschs militaires ou de guérillas venues des campagnes. De Pretoria à Bangui, il existe certes d’énormes contrastes. La diversité du continent interdit les généralisations abusives et invite à ne pas faire d’amalga
Cet article est en accès libre sur Cairn.


