Septembre 2017
Infrastructures : comment quantifier les besoins dans les pays en développement ? / Par Claire Nicolas
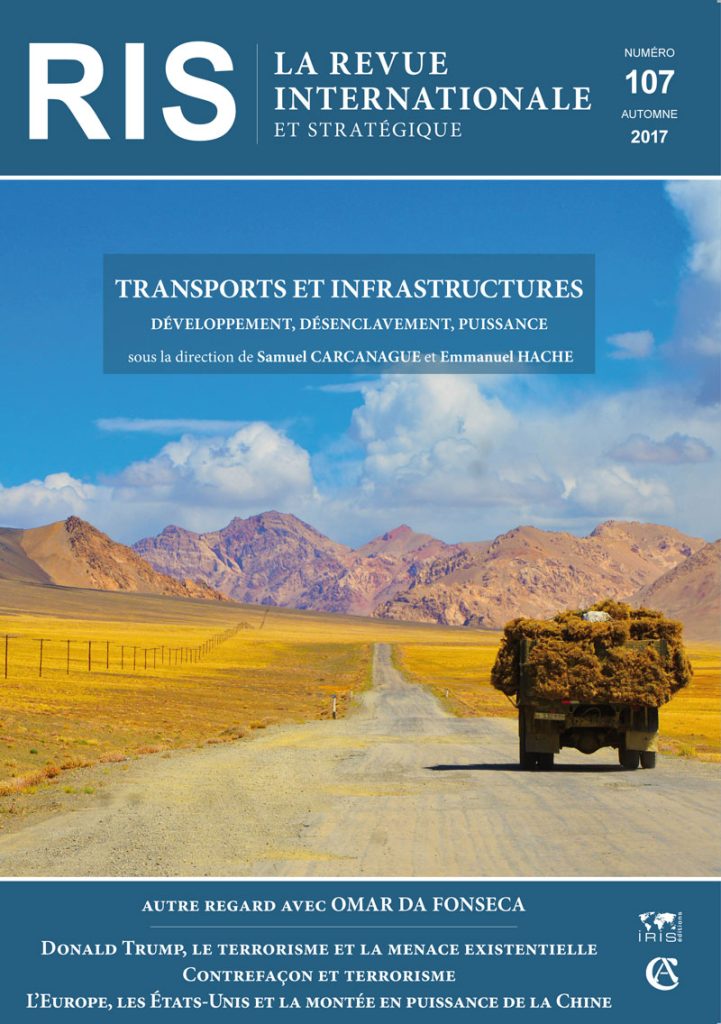 Transports et infrastructures : développement, désenclavement, puissance
Transports et infrastructures : développement, désenclavement, puissance
RIS N°107 - Automne 2017
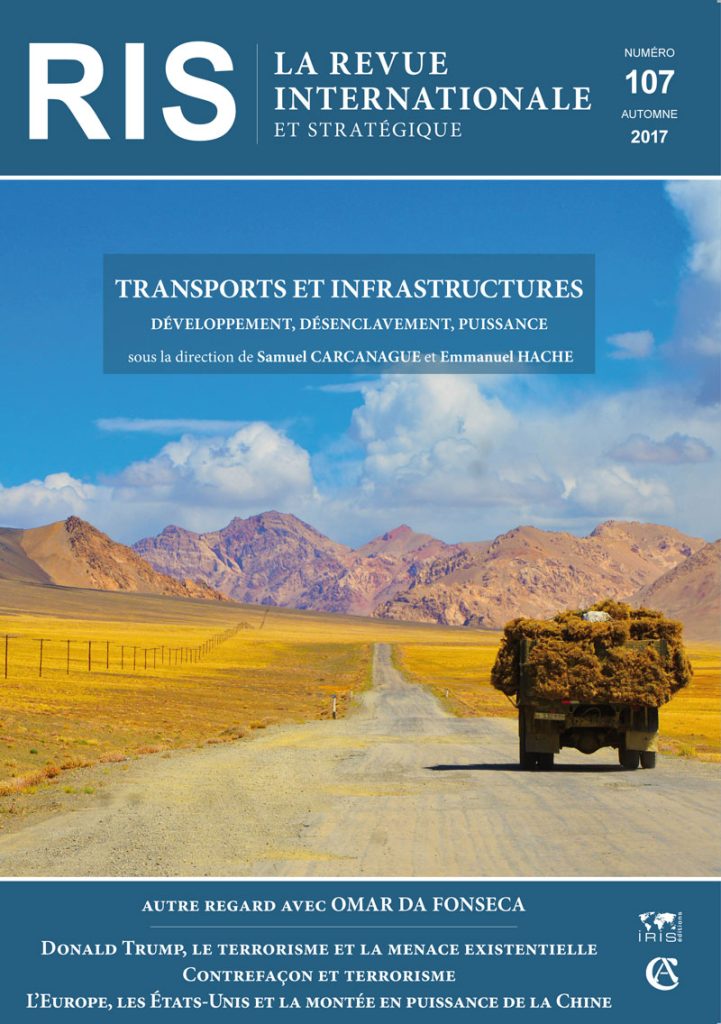
Les pays en voie de développement ainsi que les pays sous-développés souffrent aujourd’hui d’un manque criant d’infrastructures, affectant à la fois leurs populations et leurs entreprises. Une forte croyance chez les décideurs politiques lui attribue même les différentiels de croissance observés entre l’Asie du Sud-Est et le reste des pays en développement [1]. La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) estime, pour sa part, que l’Afrique perd 1 % par an de croissance économique en raison de son déficit d’infrastructures [2]. Or, loin de se résorber, le problème irait en s’aggravant, puisque les décennies à venir devraient voir l’émergence d’une classe moyenne toujours plus importante, à mesure que la croissance de ces pays continue sa course. Les infrastructures sont présentes dans nombre des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies – qui vont de l’élimination de la pauvreté à
Cet article est en accès libre sur Cairn.


