Septembre 2016
Émergence et développement : une relation complexe et contrariée / Par Dalila Chenaf-Nicet
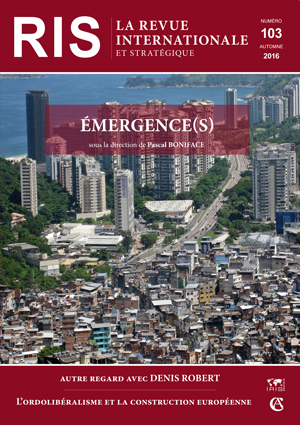 Émergence(s)
Émergence(s)
RIS N°103 – Automne 2016
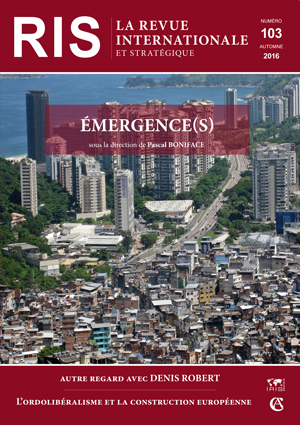
Le mot « émerger », qui nous vient du latin « emergere », signifie « sortir de » ou encore « apparaître ». Cette apparition, qui pour le dictionnaire Larousse est « soudaine », peut concerner divers systèmes. Dans le cas des systèmes économiques, l’émergence renvoie donc à l’apparition soudaine de performances industrielles et commerciales au sein d’économies qui jusqu’alors n’en étaient pas coutumières. Les pays émergents sont ainsi des pays en développement « performateurs » [1], dont la croissance économique est soutenue par un changement structurel qui autorise une insertion dans les chaînes de valeur mondiales. Les deux moteurs de leur croissance extravertie sont, d’une part, une forte attractivité aux capitaux étrangers et, d’autre part, une ouverture commerciale via des accords de libre-échange et d’intégration régionale qui accélèrent l’accès aux marchés internati
Cet article est en accès libre sur Cairn.


