Décembre 2016
Compagnies nationales, compagnies internationales : vers une nouvelle donne pétrolière / Par Nicolas Mazzucchi
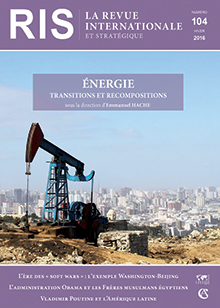 Énergie : transitions et recompositions
Énergie : transitions et recompositions
RIS N°104 – Hiver 2016
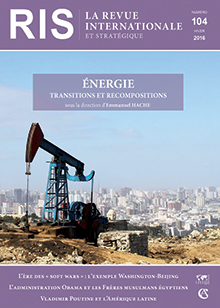
Lancées dans les sables du désert arabique ou encore dans les jungles d’Asie du Sud-Est, la grande aventure des compagnies pétrolières tiendrait presque du roman, surtout à lire leur histoire dans l’excellent ouvrage de Daniel Yergin, The Prize [1]. La réalité est bien évidemment plus prosaïque en ce début de XXIe siècle, puisque ces dernières sont désormais des acteurs économiques durablement installés, comme le démontre leur poids dans les différents classements internationaux de rentabilité des entreprises. Toutefois, cette hyperpuissance financière est à relativiser, car ces compagnies sont fortement dépendantes de ressources qu’elles ne maîtrisent au fond que très peu. Les géants occidentaux du pétrole et du gaz (IOC, pour International Oil Companies) sont en effet obligés de composer avec les États, propriétaires des gisements à travers des compagnies pétrolières nationales (NOC, pour National Oil Companies). Dépossédées des ressources d
Cet article est en accès libre sur Cairn.


