Septembre 2017
Autour du gaullo-mitterrandisme / Par Jean de Gliniasty
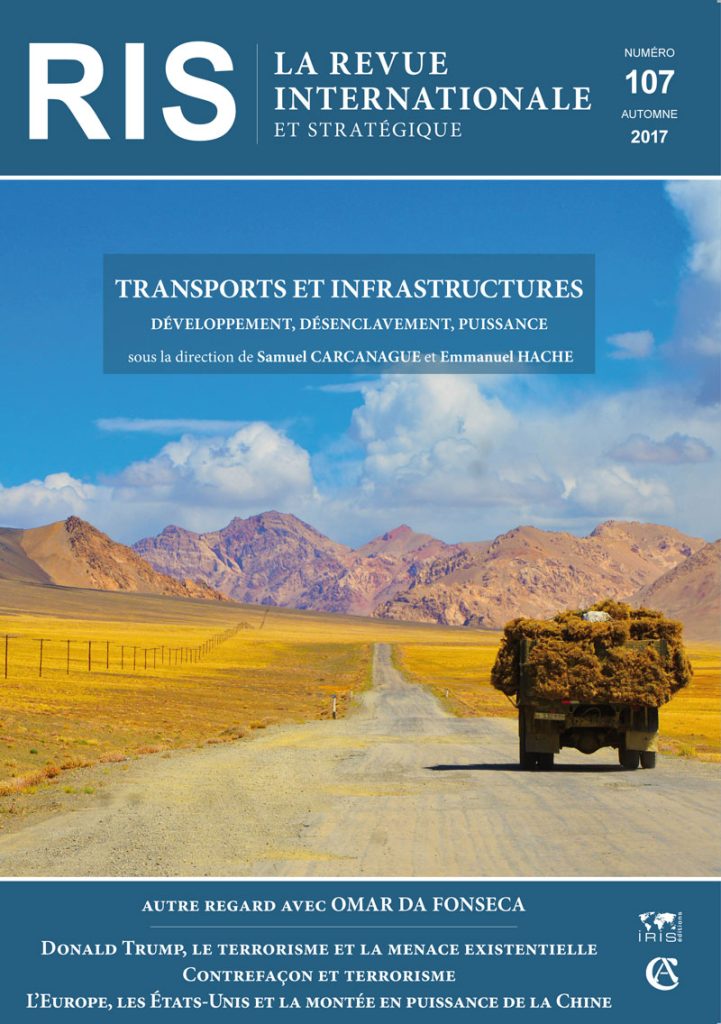 Transports et infrastructures : développement, désenclavement, puissance
Transports et infrastructures : développement, désenclavement, puissance
RIS N°107 - Automne 2017
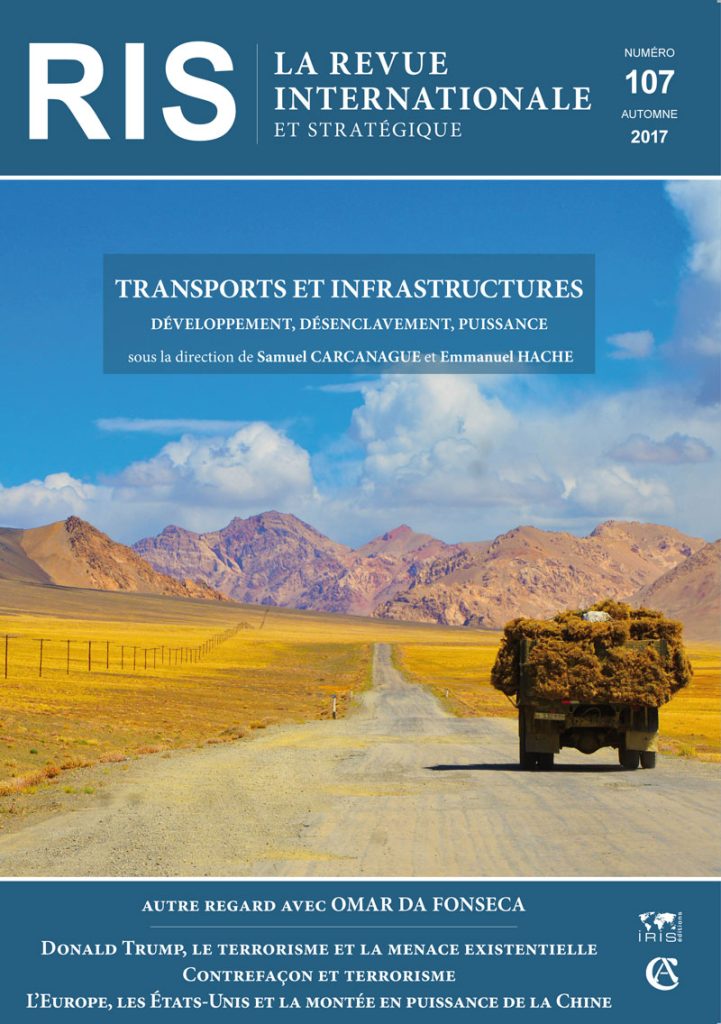
À propos de : Régis Debray, Civilisation. Comment nous sommes devenus américains, Paris, Gallimard, 2017, 240 p. Renaud Girard, Quelle diplomatie pour la France ? Prendre les réalités telles qu’elles sont, Paris, Éditions du Cerf, 2017, 142 p. Laurent Fabius, 37, Quai d’Orsay. Diplomatie française, 2012-2016, Paris, Plon, 2017, 199 p. Christian Lequesne, Ethnographie du Quai d’Orsay. Les pratiques des diplomates français, Paris, CNRS Éditions, 2017, 258 p. Thierry de Montbrial et Thomas Gomart (dir.), Notre intérêt national. Quelle politique étrangère pour la France ? Paris, Odile Jacob, 2017, 332 p. Olivier Schmitt, Pourquoi Poutine est notre allié ? Anatomie d’une passion française, Lille, Hikari Éditions, 2017, 132 p. Bruno Tertrais, La revanche de l’Histoire, Paris, Odile Jacob, 2017, 144 p. Dominique de Villepin, Mémoires de paix pour temps de guerre, Paris, Grasset, 2016, 672 p. Après une longue période de
Cet article est en accès libre sur Cairn.


