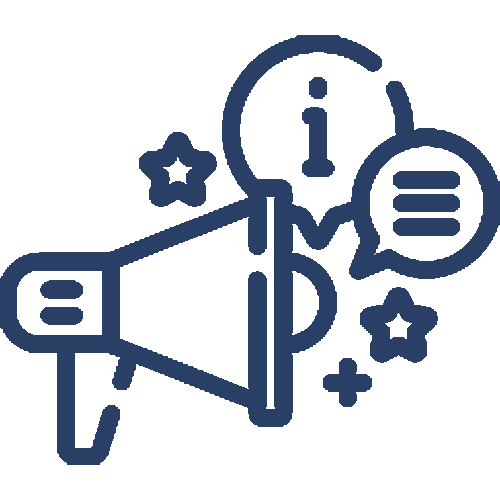François Hollande a introduit samedi 10 mars le rassemblement des ultramarins par l’annonce symbolique de la suppression du mot "race" de la Constitution. Le recours à ce mot dans notre droit, même s’il a pour objet de prohiber les discriminations entre les êtres humains, est une forme de validation et de légitimation de l’existence de "races humaines". Dans cette note, Béligh Nabli montre pourquoi il convient de supprimer ce terme de notre ordre juridique, au nom de la science, de la rigueur intellectuelle et de l’idéal républicain.
Alors que le ministre de l’Intérieur Claude Guéant se complait dans une posture conflictuelle et un discours stigmatisant l’Autre, sa déclaration sur « l’inégalité des civilisations » est révélatrice de l’ignorance de l’œuvre de Claude Levi Strauss[1] et du caractère encore prégnant des conceptions hiérarchiques de l’humanité. Au-delà des approximations sémantiques et autres débats sur le « relativisme culturel », le trouble suscité par ce regard vertical porté sur l’humanité s’explique notamment par son versant biologique et ses échos historiques. Les conceptions de l’humanité fondées sur la notion de « race » ont servi de support aux théories et idéologies racialistes à l’origine d’actes discriminatoires et criminels.
L’idée de classification/hiérarchisation des hommes sur la base d’un critère biologique ou génétique a été invalidée et désavouée par les travaux scientifiques : il existe une seule et même espèce humaine, pas de « races humaines ». Cette vérité scientifique vient conforter notre philosophie universaliste et républicaine qui vise depuis 1789 à nier le concept même de différence naturelle. En dépit de l’ambiguïté de certains discours tenus au sommet de l’Etat, cette unité biologique ou génétique n’interdit pas la diversité culturelle…
Nombre de nos concitoyens ignorent le non-sens de la notion de « race ». Une réalité de fait confortée par une situation juridique : la présence de ce mot dans notre propre droit. Une telle référence est une anomalie qui affecte la lettre et l’esprit de notre Etat de droit. La consécration juridique explicite du mot « race » date du régime de Vichy, dont l’adhésion aux théories racialistes s’est traduite par des réglementations discriminatoires, antisémites et des mesures criminelles. Paradoxalement, la restauration de la République n’a pas purgé notre système juridique de ce terme dont la genèse est anti-républicaine. Certes, les diverses références à la « race » ont aujourd’hui pour objet de prohiber les discriminations entre les êtres humains. Il n’empêche, le recours à cette notion est une forme de validation et de légitimation de l’existence de « races humaines », notion scientifiquement infondée et moralement condamnable (sauf si elle est appliquée au monde animal). Il convient de remédier à cette incohérence au nom de la science, de la morale républicaine et de la rigueur intellectuelle.
La suppression du mot « race » dans l’ensemble de la législation française[2] – dès lors qu’il vise les êtres humains (ce qui signifie a contrario que cette suppression ne concerne pas les textes où le mot « race » se réfère à la désignation d’espèces animales) – signifierait solennellement que le législateur ne reconnaît pas l’existence des « races » et mettrait un terme à la contradiction qui veut que notre législation invoque la « race » ou les origines « raciales » pour prévenir ou combattre une discrimination contraire à notre Constitution. Bien évidemment, les mots « raciste » et « racisme » ont vocation à demeurer dans notre droit ; si les « races » n’existent pas, le racisme et les racistes existent malheureusement.
Pour éviter tout risque de vide juridique, il est préconisé de remplacer les adjectifs dérivés du mot « race » (« racial », « raciale », « raciales », « raciaux », etc.) par l’adjectif « ethnique » (proposition du député communiste Michel Vaxès[3]) lorsque celui-ci n’était pas déjà mentionné. Le terme d’« ethnie » fonde les distinctions entre les populations non pas sur des critères génétiques mais sur des spécificités sociales et historiques. Il fait référence à des caractères de civilisation, notamment la communauté de langue et de culture, et à des aspects comportementaux tels que l’alimentation, le statut social ou les croyances en matière de santé. Ainsi, cette notion permet de ne pas obérer les différences qui existent entre les populations, et qui sont une source d’enrichissement, tout en faisant référence à des caractéristiques objectives, culturelles, qui permettent de distinguer « l’autre » sans donner prise à des idéologies fondées sur la hiérarchisation des individus.
Ce choix a déjà prévalu dans certains textes de loi. Ainsi, l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires interdisait, initialement, d’opérer des distinctions entre les agents publics « en raison de (…) leur appartenance ethnique » : l’absence de référence à la « race » était, semble-t-il, délibérée. Cette référence a été malencontreusement introduite par l’article 11 de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, précitée, relative à la lutte contre les discriminations.
Au sommet de notre ordre juridique, le mot « race » est également doublement présent : à l’article 1er de la Constitution de 1958 et dans le préambule de la Constitution de 1946 (inséré dans le bloc de constitutionnalité).
Paradoxalement, les constituants de 1946 se sont référés – dans le préambule de la Constitution de la IVe République – à ce mot qui symbolisait les régimes et idéologies combattus durant la Seconde Guerre mondiale. C’est d’autant plus dommageable que le préambule de la Constitution de la IVe République[4] fait partie intégrante du « bloc de constitutionnalité ». Le choix du constituant de 1958 de conserver et de se référer à nouveau à la « race » est aussi injustifiable. L’inscription du terme « race » à l’article 1er de la Constitution de 1958[5], c’est-à-dire dans l’article même qui affirme les valeurs fondamentales de la République, est illogique, et ce même s’il s’agit d’une « phrase qui a pour objet de lui dénier toute portée »[6]. Le constituant de 1958 se réfère à ce terme alors même que l’interdiction de toute discrimination selon « l’origine », terme plus objectif et plus général, surtout si on le met au pluriel (suivant l’idée du député socialiste et président du Conseil régional de la Guadeloupe Victorin Lurel), donne les garanties suffisantes à l’interdiction de distinction selon la couleur de la peau, l’origine génétique, généalogique, sociale, culturelle, etc.
La gauche a déjà imaginé et défendu l’idée de supprimer la référence constitutionnelle à la notion de race, notamment lors de la discussion de la loi contre les discriminations, à l’occasion du débat sur la révision constitutionnelle sur la décentralisation, ou encore lors de l’examen de la proposition de loi visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. Cette démarche fut incarnée par Victorin Lurel, co-auteur d’une contribution thématique au congrès national du Mans présentée le 8 juillet 2005[7] et initiateur d’un amendement[8] et de deux propositions de loi constitutionnelle en ce sens[9]. Les débats parlementaires ont permis de montrer un vrai clivage gauche/droite sur cette idée : largement soutenue par la gauche, la suppression du mot race de notre ordre juridique est traditionnellement rejetée par la droite, au nom de l’argument suivant lequel elle impliquerait une régression dans la lutte contre les discriminations.
Cette position n’est pas convaincante. En effet, la référence à la « race » n’est jamais mentionnée de façon isolée, notamment dans le code pénal. Elle est toujours accompagnée d’une énumération de termes – « ethnie », « origine », « nation », ou « religion » – dont le contenu recouvre le contenu, autre que biologique, généralement attaché à ce mot. Ainsi, la suppression du mot race ne créerait pas de vide juridique et n’autoriserait pas le juge à laisser impuni un quelconque comportement raciste : les catégories juridiques existantes sont suffisantes pour assurer une telle protection.
En outre, le fait que certains engagements internationaux auxquels la France a souscrit se réfèrent à la « race » ne saurait faire obstacle à la volonté politique de le supprimer de notre propre législation. Un tel acte n’est pas contraire à nos obligations internationales. Mieux, même en cas de suppression du mot « race » en droit interne, rien n’empêcherait le juge national de s’y référer (même à titre subsidiaire), en application de nos engagements internationaux (dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) pour incriminer un acte à caractère raciste.
Après un quinquennat marqué par la division, la stigmatisation et l’injustice, il est de notre responsabilité de renouer avec l’idéal républicain par un acte symbolique fort : la suppression du mot « race » de notre ordre juridique. Certes, cet acte ne suffira pas à éradiquer les discours et comportements « racistes ». Il n’empêche, outre sa vertu pédagogique, un tel geste politique et normatif refléterait un projet de civilisation humaniste conforme à la tradition républicaine, loin de l’esprit et des actes qui ont marqué le mandat de Nicolas Sarkozy.