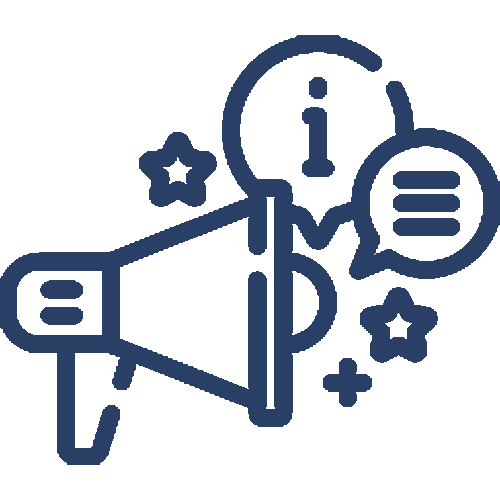A l’automne 2007, Vladimir Poutine avait fait un choix courageux en ne cédant pas aux pressions de ses amis qui le poussaient à modifier la Constitution et à effectuer un troisième mandat consécutif. Cette décision renvoyait à un raisonnement implicite, mais crucial en termes d’identité politique : l’ancien – et futur – président russe considérait que ce qui était envisageable en Ouzbékistan ou en Azerbaïdjan n’était au fond pas digne d’une grande puissance européenne comme la Russie. Pourquoi, quatre ans plus tard, Vladimir Poutine a-t-il décidé de revenir au Kremlin ?
En adoubant, fin 2007, Dmitri Medvedev, le président sortant faisait le pari d’une ouverture symbolique et contrôlée. Vladimir Poutine savait que son successeur au Kremlin incarnait une autre Russie que lui, moins liée à l’URSS et à une conception impériale de la puissance. Le calcul politique, parfaitement fondé, était que ces deux visions de la Russie étaient complémentaires et permettraient de ratisser large, tant au plan électoral que sur la scène internationale. C’était cependant sous-estimer l’incompatibilité entre l’héritage des années 2000-2008 et tout projet de réforme en profondeur. L’article "Russie, en avant", manifeste de la modernisation selon M. Medvedev, rappellera cette évidence dès l’automne 2009.
Contrairement à ce qu’affirment ceux qui ont toujours considéré Dmitri Medvedev comme un homme de paille, les intentions du président russe ont été prises très au sérieux par l’entourage de Vladimir Poutine. La désétatisation souhaitée de l’économie remettait en cause les rentes de personnages- clés de l’oligarchie poutinienne tels que le vice-premier ministre Igor Setchine (le fossoyeur de Ioukos) ou le patron de la holding publique Rostekhnologii Sergueï Tchemezov (un ami de la période est-allemande de Vladimir Poutine). Certaines nominations effectuées par Dmitri Medvedev, de même que les appels – comme celui du vice-premier ministre Alexeï Koudrine à Krasnoïarsk en février – en faveur d’élections libres, ont été perçus comme autant de provocations par le parti Russie unie et l’entourage de Vladimir Poutine. Les questions de politique étrangère ont également clivé le tandem. La présence de Dmitri Medvedev au sommet de l’OTAN à Lisbonne en novembre 2010 – où il fut notamment question de coopération dans le domaine de la défense antimissile – ou le non-veto de Moscou à l’ONU sur le dossier libyen – épisode qui a donné lieu en mars à l’un des rares affrontements publics entre le président et le premier ministre russes – ont été instrumentalisés par les adversaires de Medvedev.
Si l’on s’en tient à la version officielle, réitérée le 30 septembre par M. Medvedev dans une interview accordée à trois chaînes de télévision russes, la permutation au sein du tandem était prévue de longue date et a fait l’objet d’un consensus entre les deux têtes de l’exécutif. De nombreux éléments permettent d’affirmer qu’il n’en est rien. Le statu quo, confortable à maints égards, a longtemps été le scénario privilégié. Le retour de Poutine au Kremlin n’allait pas de soi.
Plusieurs facteurs ont joué dans cette décision. Le premier est le très mauvais score réalisé par Russie unie aux scrutins locaux du mois de mars. Dans certaines régions, le parti du pouvoir a enregistré un recul de près de 20 % par rapport aux précédentes élections, et ce malgré le recours massif à la ressource administrative et le verrouillage médiatique. A neuf mois des législatives et à un an de la présidentielle, ce pilier du régime Poutine est à bout de souffle.
Le deuxième élément, quasi concomitant, est l’offensive politique du président Medvedev et de ses soutiens. Plusieurs épisodes méritent d’être rappelés : le limogeage du général Viatcheslav Ouchakov, le directeur adjoint du service fédéral de sécurité (FSB) le plus influent ; le discours prononcé le 3 mars par le président à Saint-Pétersbourg à l’occasion du 150e anniversaire de l’abolition du servage en Russie ; les annonces faites à Magnitogorsk sur la fin de la présence des ministres aux conseils d’administration des groupes publics. Ce faisant, le Kremlin envoyait un message clair à la Maison Blanche. Le pacte de 2008 allait devoir être renégocié. Les lignes rouges, probablement implicites, dessinées alors par Vladimir Poutine (non remise en cause des équilibres au sein du FSB, du secteur énergétique et des institutions), n’étaient pas immuables. Une dynamique favorable à Dmitri Medvedev, et donc à l’hypothèse d’un second mandat – de six ans, conformément à la réforme institutionnelle adoptée à l’automne 2008 -, s’esquissait alors.
La riposte du clan Poutine ne s’est pas fait attendre. Dès le 14 avril, le président de la Douma, Boris Gryzlov, déclarait que Russie unie avait naturellement vocation à soutenir son leader, c’est-à-dire Vladimir Poutine, à la présidentielle de 2012. Puis, début mai, était annoncée la constitution d’un Front populaire panrusse autour du premier ministre, dans la plus pure tradition de mobilisation politique à la soviétique.
L’effet immédiat de cette contre-offensive a été de bloquer le président Medvedev. De ce point de vue, sa non-annonce de candidature pour 2012, à l’occasion de l’étrange conférence de presse du 18 mai, marque un tournant. Que cela se soit produit à Skolkovo, sur le site du projet se voulant le symbole du projet de modernisation promu par le Kremlin, n’en est que plus significatif.
Le retour de Vladimir Poutine au Kremlin reflète le véritable rapport de forces au sein des cercles de pouvoir russes, fondamentalement conservateurs et rétifs à l’idée de réformes, associées le plus souvent au désordre. Ce à quoi aspirent les élites en place est un retour à l’âge d’or du poutinisme, ces années d’avant crise placées sous le signe du triptyque – verticale du pouvoir, démocratie souveraine, nationalisations – et bercées par une douce pluie de pétrodollars.
Les quatre années de la présidence Medvedev, déjà présentée à Moscou comme un interrègne, n’auront-elles servi à rien ? Le bilan est certes maigre, mais pas nul. Le legs le plus important est sans doute le renouvellement en profondeur des élites régionales. Le renvoi du maire de Moscou Iouri Loujkov, ainsi que les départs de Mintimer Chaïmiev et de Mourtaza Rakhimov (respectivement à la tête des républiques du Tatarstan et du Bachkortorstan depuis près de vingt ans), sont à relever. La réforme du ministère de l’intérieur, bien qu’inachevée et insuffisante, ne se résume pas à un simple changement de nom de la police comme on l’a beaucoup écrit.
Dmitri Medvedev a en outre joué son rôle de président en mettant au coeur du débat public des enjeux vitaux pour l’avenir de la Russie tels que la corruption ou la modernisation. Il a de fait restauré une forme de pluralisme à Moscou. Le chef de l’Etat a ce faisant redonné quelques espoirs aux libéraux, aux démocrates et aux représentants de la classe moyenne urbaine russe quant à une évolution normale – c’est-à-dire, au fond, européenne – de leur pays. La désillusion n’en est que plus terrible pour ces catégories sociales, tentées par l’émigration et sans lesquelles le redressement de la Russie est impossible.
L’une des principales interrogations aujourd’hui en Europe concerne les conséquences du retour de Vladimir Poutine au Kremlin sur les relations russo-occidentales. Dmitri Medvedev incarnait une hypothèse de développement plus optimiste pour la Russie, qu’il s’agisse de ses réformes internes ou des possibilités de coopération internationale. Un second mandat avait la préférence des Occidentaux. Le vice-président, Joseph Biden, avait fait passer le message à Moscou au printemps. Certains diplomates français doutent que Paris se soit engagé dans la vente du porte-hélicoptères Mistral à la Russie si Dmitri Medvedev n’avait pas été l’interlocuteur de Nicolas Sarkozy depuis l’automne 2008.
Le retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 2012 ne modifiera pas immédiatement la substance de la diplomatie russe (sauf peut-être dans la Communauté des Etats indépendants et au Moyen-Orient). Ce que va changer, en revanche, c’est la perception de la Russie à l’étranger. La France et l’Allemagne auront plus de mal à convaincre leurs partenaires et les instances bruxelloises d’être optimistes sur l’évolution de la Russie à moyen terme. Une défaite de Barack Obama à l’automne 2012 signerait la fin de la politique de reset et replongerait Américains, Russes et Européens dans l’atmosphère de mini-guerre froide caractéristique de la fin de la présidence Bush.
Vingt ans après l’effondrement de l’Union soviétique, Moscou semble à nouveau regarder vers le passé plus que vers l’avenir. Dmitri Medvedev, comme bien d’autres réformateurs russes avant lui, a été sacrifié. Il est à craindre que la Russie paie très cher ce nouveau rendez-vous manqué avec la modernisation.