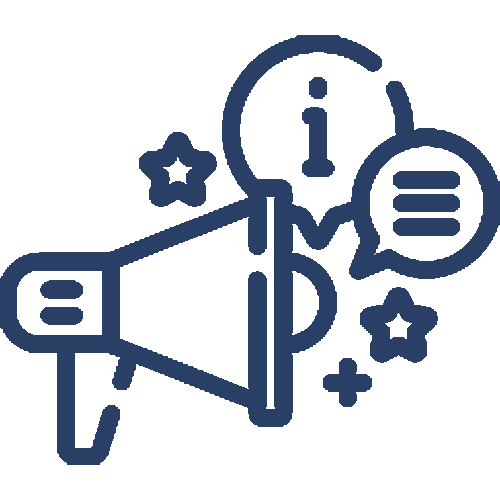En 1962, le président John F. Kennedy donnait une réception en l’honneur d’une cinquantaine de récipiendaires du Prix Nobel. Il s’adressa à cet illustre aéropage en disant : « Jamais dans l’histoire n’a été réunie, dans une seule salle, à la Maison Blanche, une telle extraordinaire concentration de talent et de savoir humain, à une exception près peut-être… quand Thomas Jefferson dinait tout seul. » Kennedy voulait ainsi rendre hommage à son illustre prédécesseur, et rappeler que ce dernier n’avait pas uniquement été un grand homme d’Etat et le rédacteur de la Déclaration d’indépendance, mais aussi un immense intellectuel pluridisciplinaire, philosophe, architecte, paléontologue, fondateur de l’université de Virginie, musicien, inventeur, personnage si polyvalent qu’il fut surnommé par certains « The American Leonardo », le Léonard de Vinci américain. Nonobstant les zones d’ombre et sans ouvrir à nouveau l’inépuisable débat sur la question de son attitude sur le sujet de l’émancipation des noirs, il est incontestable que Jefferson fut un fervent partisan des Lumières, attaché aux vertus républicaines et à la séparation des pouvoirs, garantes des droits individuels face aux dérives autoritaires.
Tout au long de cette année 2010, nous avons eu le sentiment que le spectre de Jefferson planait sur les Etats-Unis et sur le monde. En tant qu’auteur du Statut de Virginie pour la liberté religieuse, qu’aurait pensé Thomas Jefferson du pasteur intégriste Terry Jones, des autodafés du Coran, de la montée de la xénophobie et des identitarismes ? Toujours méfiant envers les intérêts catégoriels et le pouvoir débridé des milieux financiers, pourfendeur des banques, comment Jefferson aurait-il réagi en voyant, deux ans après le déclenchement de la crise de 2008, les institutions financières reprendre leurs bonnes vieilles habitudes, comme si rien ne s’était passé ? Inconditionnel de la liberté de la presse, Jefferson disait que s’il devait choisir entre d’un côté, pas de gouvernement et une presse libre et de l’autre côté, un gouvernement et l’absence de presse libre, il choisirait sans hésiter la première proposition. Apôtre de la transparence, qui était pour lui un excellent antidote contre les abus de pouvoir, quelle aurait été son attitude face à la révolution Wikileaks et à ce grand déballage planétaire ? En bon libéral, Jefferson était particulièrement attaché à l’idée des checks and balances. Comme Montesquieu, il honnissait le « confusionnisme », la confusion en quelques mains de l’ensemble des pouvoirs. Dans son discours d’adieu à la nation, il avait, comme John Adams, dénoncé la tentation impériale. Peut-être aurait-il vu en Wikileaks un nouveau contrepouvoir, face à un empire en état d’hubris, engagé dans une « guerre contre le terrorisme » propice à tous les dérapages.
Jefferson était par ailleurs l’un des promoteurs de l’idée d’un « mur de séparation entre la religion et l’Etat », nécessaire selon lui aussi bien pour protéger les religions que pour empêcher que les querelles religieuses ne viennent corrompre le gouvernement. Qu’aurait-il pensé de l’instrumentalisation croissante des religions par des politiques en mal de légitimité, aux Etats-Unis, dans le monde musulman, et d’un bout à l’autre de la planète ?
En Amérique, l’année 2010 fut celle du retour en force de la droite radicale et de l’influence grandissante des Teas Parties. Certains leaders des Tea Parties n’hésitaient d’ailleurs pas à se réclamer de Jefferson, et notamment de ses conceptions en matière de refus du centralisme et de l’Etat moloch. Pour autant, Jefferson aurait probablement été horripilé par la démagogie outrancière des Tea Parties. Jefferson le francophile et universaliste n’aurait pas accepté leur chauvinisme et leur francophobie. Jefferson le disciple des philosophes des Lumières aurait été écoeuré par toutes les superstitions véhiculées par les figures de proue du courant populiste, leurs idées d’un autre âge sur la masturbation ou le créationnisme, qui ont amené certains éditorialistes à affirmer que « les lumières s’éteignent aux Etats-Unis. »
Non, Jefferson ne reconnaîtrait pas son Amérique, pas plus d’ailleurs que l’immense cinéaste Frank Capra, qui était pourtant un homme de droite et qui dans chacun de ses films, s’arrangeait pour glisser un discret hommage aux pères fondateurs des Etats-Unis. Capra était lui aussi qualifié de populiste, mais le populisme de Capra, fait de sollicitude envers les faibles, de refus des compromissions, de bonté et d’idéalisme, a peu de choses à voir avec le populisme des Tea Parties et de leurs prédicateurs médiatiques, lequel populisme baigne souvent dans la hantise de la différence, dans la volonté d’en découdre avec la modernité, avec le cosmopolitisme, avec la diversité, et dans la peur maladive et obsessionnelle de l’autre. (l’autre qui fut incarné successivement dans l’histoire des Etats-Unis par l’indien d’Amérique, par le catholique, par le juif, par le noir, et aujourd’hui par l’immigré hispanophone et surtout par le musulman.)
Toujours est-il que ce mouvement ne doit pas être considéré comme un simple phénomène folklorique, né en réaction à l’élection de Barack Obama. Il représente un important courant d’opinion présent depuis fort longtemps dans l’histoire politique américaine et qui fut porté naguère par des mouvements comme le People’s Party à la fin des années 1800 ou la John Birch Society dans les années 1960. Ce courant est aujourd’hui devenu l’épine dorsale du Parti Républicain, lequel aura beaucoup de mal à retrouver son point d’équilibre.
Ce n’est pas uniquement aux Etats-Unis que l’année 2010 fut celle d’une résurgence des nationalismes, des vents droitiers et des courants populistes. Le « rêve européen » cher à Jeremy Rifkin semble aujourd’hui en piteux état. Jamais l’essoufflement du projet européen n’aura suscité autant d’inquiétudes. Il y a à peine 10 ou 15 ans, les intellectuels continentaux célébraient Jurgen Habermas et d’innombrables colloques évoquaient sa notion de « patriotisme constitutionnel », censée permettre l’émergence d’une union politique qui ne serait pas fondée sur des bases ethniques, nationales ou religieuses, mais tout simplement sur l’adhésion à des valeurs communes, sur le respect des normes juridiques et constitutionnelles, sur l’humanisme et le respect des droits fondamentaux de chacun. On en est bien loin aujourd’hui, et l’on assiste à un retour des vieux démons de l’histoire européenne. En Hongrie, on voit réapparaître une extrême droite ouvertement antisémite. Aux Pays-Bas de Geert Wilders, en Angleterre avec l’English Defence League, en Belgique avec le Vlaams Belang et dans d’autres pays, les vieilles haines endossent des habits neufs et modernes. La rhétorique raciale du siècle dernier a laissé place à une nouvelle antienne plus en phase avec l’air du temps, celle du choc des cultures et du combat contre un islam présenté comme conquérant et inassimilable. La crise économique, les secousses de la zone euro, la stagnation du pouvoir d’achat en Europe, la hantise du déclassement qui saisit les classes moyennes, sont autant de phénomènes qui viennent approfondir les lignes de faille et favoriser la recherche de boucs émissaires.
Au-delà des extrêmes, même les partis de gouvernement peinent à articuler des politiques de sortie de crise novatrices, tant il est difficile de trouver l’équilibre entre les nécessaires projets de relance et l’état des finances publiques qui est de plus en plus préoccupant, alors que la croissance demeure anémique et que les déficits se creusent. En Grande-Bretagne, le gouvernement conservateur de David Cameron s’efforce de réduire le train de vie de l’Etat et procède à des coupes drastiques dans les dépenses publiques, qui signifient de facto le délitement de l’Etat-providence. En France, l’année fut notamment marquée par les violentes polémiques avec la Commission européenne autour de la question du traitement des Roms. En Italie, le berlusconisme s’essouffle, ce qui incite l’hebdomadaire The Economist à faire le parallèle avec Pagliacci, l’opéra de Leoncavallo, où l’on voit Canio, le clown directeur de la troupe, faire un pas en avant, poignarder Silvio et annoncer au public : « La Commedia è finita ». En Espagne, les socialistes de Zapatero ne sont guère plus en forme et leur politique d’austérité agrège les mécontentements.
On pourrait penser qu’alors que l’Occident souffre du marasme économique et est dominé par les peurs identitaires, l’Asie continue de vivre dans l’espérance et de prospérer économiquement. Mais cette vision est par trop idyllique. Si les résultats économiques des puissances émergentes et notamment de la Chine sont certes impressionnants, ces puissances sont encore loin de pouvoir assurer une relève. Elles ont pris acte de la fin du monopole occidental de la gestion des affaires du monde, mais tardent à s’affirmer politiquement. La chaise vide lors de la remise du prix Nobel de la paix à Lu Xiabao était un symbole très parlant. Même l’Union Soviétique avait autorisé l’épouse d’Andrei Sakharov à aller recueillir le prix. En outre, l’économie chinoise reste toute entière tournée vers la satisfaction de la demande extérieure. Ce n’est qu’une question de temps avant que l’émergence des classes moyennes et l’exigence d’une plus grande ouverture ne se transforment en grains de sable susceptibles d’enrayer la machine si bien huilée. Face à la stupéfiante interdépendance de notre époque, la géopolitique ne peut être vue comme un jeu à somme nulle où les malheurs des uns feraient le bonheur des autres. Certes, à moyen et long terme, les rapports de force entre puissances évoluent et le centre de gravité se déplace, mais à court terme, chaque coup dur subi par une puissance économique impacte négativement ses partenaires commerciaux, fussent-ils des rivaux.
Par ailleurs, l’année 2010 a été marquée par un nombre impressionnant de catastrophes naturelles, qui sont venues accroître les effectifs des laissés pour compte de la mondialisation. L’ONU décompte aujourd’hui 49 pays où règne la très grande pauvreté, contre seulement 25 en 1971. On pourrait être tentés d’incriminer une nouvelle fois la crise économique et les vents mauvais, mais comme le dit un proverbe danois, « quand on ne sait pas vers quel port on navigue, aucun vent n’est le bon. » D’où l’urgence de voir fixé un cap. Le besoin d’une réforme de la gouvernance mondiale n’a jamais été aussi important. Si la réforme de l’ONU demeure un serpent de mer et a peu de chances d’aboutir, c’est surtout sur le G20 que les regards sont désormais braqués. Certes, sa légitimité n’est pas aussi incontestable que celle de l’ONU, mais c’est aujourd’hui le seul forum susceptible de prendre des décisions importantes et d’assurer leur mise en oeuvre. La présidence française du G20 sera-t-elle un tournant décisif ou une occasion manquée ? Face aux crises économiques, financières, écologiques, sanitaires et alimentaires, tout le monde est aujourd’hui conscient de l’urgence d’une action collective à laquelle participeraient l’ensemble des pays du globe. Reste à savoir si le courage politique sera au rendez-vous, ou si les égoïsmes nationaux et les replis frileux viendront une nouvelle fois empêcher la réforme tant attendue de la gouvernance globale.