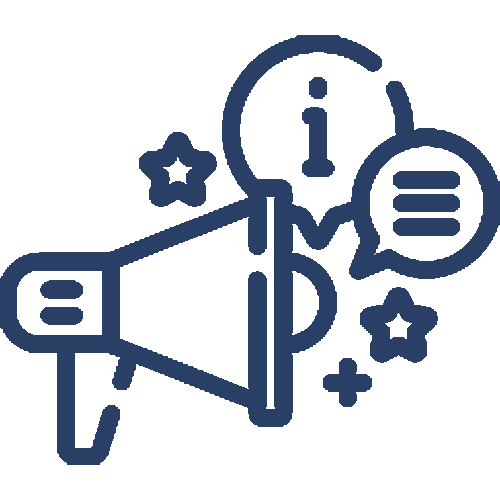Oussama Ben Laden est mort. L’évènement est historique. Sa célébration populaire, médiatique et officielle n’en est pas moins troublante : "Justice" a-t-elle été faite ? Au-delà de considérations purement morales et éthiques, les conditions de cette mise à mort suscitent des interrogations qui relèvent du droit international, dont le mot " terrorisme " ne fait pas disparaître les règles. Nonobstant les zones d’ombre qui continuent d’entourer les circonstances de ce décès, au moins deux points peuvent d’ores et déjà être discutés. On n’insistera pas ici sur la violation de l’exclusivité territoriale – et donc de la souveraineté – du Pakistan, pour s’attacher à deux principes juridiques fondamentaux, porteurs de valeurs essentielles : l’interdiction de la torture et le droit à la vie.
La localisation de Ben Laden, en effet, semble avoir été obtenue par l’utilisation de techniques de torture. Or, il s’agit d’une pratique absolument interdite par le droit international, conventionnel et coutumier. La jurisprudence y voit même une norme impérative (jus cogens) à laquelle aucune dérogation n’est permise. L’interdiction n’est évidemment pas liée aux finalités. Quelque légitime et légal que soit l’objectif recherché, la torture est proscrite. Avancer des finalités d’exception, et prétendre notamment que le recours à la torture serait justifié lorsqu’il serait l’unique moyen d’obtenir des informations dans la lutte contre le terrorisme, c’est remettre en cause le principe lui-même. Il y a là un acquis fondamental, à préserver en toute circonstance, car de la dictature Argentine au Chili de Pinochet, de Vichy à la guerre d’Algérie, l’histoire regorge hélas de tortionnaires prétendant œuvrer contre des terroristes pour la sécurité de la population civile et la défense de valeurs supérieures.
En outre, les circonstances de la mort de Ben Laden font naître des doutes sérieux quant au respect de son "droit à la vie", garantie internationale coutumière évidemment applicable à tous les hommes, même criminels ou terroristes. Sur ce point, il convient de préciser que l’intervention américaine ne constitue pas "un acte licite de guerre" pouvant justifier l’homicide de Ben Laden. En effet, l’opération a eu lieu au Pakistan, près de la capitale, dans une zone et dans un contexte qu’aucune fantaisie juridique ne pourrait rattacher à la nécessité militaire dans le conflit afghan.
L’action des agents américains s’inscrivait donc au mieux dans le cadre d’une "simple" action de police. Et encore, suivant les versions, on se réfère tantôt à la volonté de répondre aux crimes qu’on lui impute (police judiciaire), tantôt au désir d’éviter des maux futurs et éventuels en "décapitant" un réseau terroriste en place (police administrative). Dans ces conditions, si la mission ordonnée par Barack Obama avait effectivement pour objectif de tuer le chef d’Al-Qaïda, il s’agirait d’une violation manifeste du droit fondamental à la vie. On comprend dès lors pourquoi le président américain a déclaré que l’opération était destinée à "capturer Oussama Ben Laden et à le présenter devant la justice". La précision est notable : ni acte de guerre, ni mesure préventive (administrative), mais opération de police judiciaire. Dans cette optique, Ben Laden devait répondre de sa responsabilité dans les actes de terrorisme pour lesquels il est accusé, devant un juge et dans le respect du droit à un procès équitable. Du coup, son décès serait une sorte de regrettable accident, une arrestation qui aurait mal tourné.
Pourtant, dans le contexte revendiqué d’une tentative d’arrestation, la mort de Ben Laden ne pourrait se justifier que par la logique de la légitime défense. Or, si celle-ci est effectivement invoquée, les faits (re)connus ne semblent pas conforter cette thèse : Ben Laden était désarmé et rien dans ce qui a été rendu public ne permet d’imaginer que sa "résistance" mettait les forces américaines en danger. À l’opposé, la mort d’une "cible" désarmée et les festivités officielles qui l’accompagnent convergent pour désigner une exécution sommaire.
Alors que ce décès ne change rien à la tragédie afghane, pas plus qu’aux atrocités commises par Al-Qaïda, il interroge sur le sens du mot "justice". Le droit international n’autorise ni la torture (y compris pour soutirer des informations " vitales "), ni les exécutions extrajudiciaires (même à l’encontre des "terroristes"). Pour esquiver tout débat, voire toute analyse, certains contestent la légitimité d’une appréciation juridique de faits relevant de la seule "Raison d’Etat", d’une "logique de guerre" contre la terreur, voire d’une conception substantielle de la justice. L’idée se résume ainsi : il n’y a pas lieu de s’embarrasser de règles de droit lorsqu’on a affaire à des terroristes qui (précisément) n’en respectent aucune. Ce type de "raisonnement" traduit une régression liberticide de l’esprit de justice. Doit-on adapter notre échelle de valeurs aux conceptions de ceux que nous qualifions par ailleurs de "barbares" ?
De Nuremberg à La Haye, c’est au nom de l’Humanité qu’on a choisi de traduire en justice ses ennemis. C’est notre projet de civilisation, fondé sur la volonté de substituer la "justice" à la vengeance. Face à la tentation contemporaine de céder à la passion vengeresse, il devient urgent d’en rappeler le risque : "le droit qui prend la forme de la vengeance constitue à son tour une nouvelle offense, n’est senti que comme conduite individuelle et provoque, inexpiablement, à l’infini, de nouvelles vengeances", écrivait Hegel.