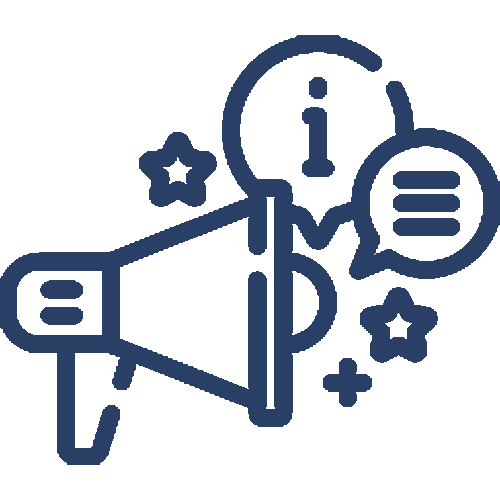Les Français et leurs dirigeants ont été surpris par certaines réactions « égoïstes » ou moins européennes – de l’Allemagne lors des crises survenues dans la zone euro au cours de ces derniers mois. C’est tout simple, explique Jacques-Pierre Gougeon, un des meilleurs connaisseurs de notre grand voisin. L’Allemagne est devenue plus « normale », et c’est pour cela qu’elle fait plus clairement valoir ses intérêts nationaux. Sans complexes.
Oui, car, au cours des dernières années, il y a eu une double rupture. D’abord avec la réunification, en 1989-1990, qui a totalement modifie la donne une nouvelle situation géographique et démographique, ainsi qu’une puissance économique accrue, aujourd’hui manifeste après de gros efforts, notamment pour permettre à l’Est de « rattraper » son retard. Ce rattrapage – encore inachevé – a nécessité 1450 milliards d’euros de transferts financiers de l’Ouest vers l’Est. Mais la césure majeure, c’est le changement de génération politique, qui a transformé les mentalités Helmut Kohi a été le chancelier de cette transition, de 1982 à 1998, le dernier à avoir vécu la guerre. A partir de 1998, avec le social-democrate Gerhard Schrôder (jusqu’en 2005), né en 1944, puis avec Angela Merkel, née en 1954, arrivent des dirigeants dont le rapport à l’histoire allemande est très différent.
Parallèlement, c’est la relation de l’Allemagne à la puissance, avec le reste du monde et, par voie de conséquence, avec la France qui a changé. L’ancien chancelier Helmut Schmidt (en poste de 1974 à 1982) rappelle dans ses Mémoires que, d’un point de vue protocolaire, il laissait toujours la priorité à la France. Cette vision est caduque. L’Allemagne s’assume désormais comme puissance. Et elle aussi prend d’abord en compte ses propres intérêts. Un des moments clefs de cette évolution a été le sommet européen de Nice, où, pour la première fois, un chancelier allemand, Gerhard Schrôder, a remis en cause, au nom de la démographie,
la parité de représentation entre la France et lAllemagne.
Avant la réunification, l’intégration politique européenne servait généralement les intérêts allemands. Mais, aujourd’hui, on la juge au coup par coup, selon qu’elle sert ou non les intérêts du pays. Déjà, dans les dernières années d’Helmut Kohi, on décelait le changement.
Il temporisait encore, parce qu’il considérait qu’une Allemagne se mettant trop en avant pouvait effrayer ses partenaires. Cela aussi est fini. L’année 1999 est celle où tombe le tabou militaire : pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne envoie des soldats dans l’ex-Yougoslavie. Jusque-là, au nom du passé, il ne pouvait pas y avoir d’intervention de soldats allemands en dehors de la zone de l’Otan. Mais, en 1999, c’est au nom du même passé que l’Allemagne a choisi d’intervenir, pour défendre des victimes. Cela correspond à une autre approche intellectuelle de sa propre histoire.
Oui, une nouvelle génération d’intellectuels, nés eux aussi après la guerre, notamment des universitaires historiens, a considéré qu’on pouvait parler de l’histoire allemande d’un point de vue scientifique, en dehors des contingences morales. Il ne s’agit pas d’oublier le passé, mais celui-ci ne doit plus être une source d’inhibitions dans les domaines politique et diplomatique.
C’est la fin de la culture de la retenue. Ces historiens étudient par exemple le régime nazi «objectivement», sans tabou, montrant comment il a su « acheter» le ralliement économique de l’immense majorité de la population, ou comment, dès 1942-1943, celle-ci était informée des horreurs commises par le régime, ou encore comment des Allemands ont aidé des Juifs. Avec eux, l’Allemagne assume davantage son passé et remet en cause certains mythes fondateurs : on assiste ainsi à une relecture des années 50 et 60, époque du miracle économique. Ce travail illustre un passage à la normalité qui lui-même permet le discours de la puissance. L’Allemagne, avec 81,7 millions d’habitants, est la première puissance démographique de l’Union européenne, elle pèse 27 % de la richesse de la zone euro, et 8 000 de ses soldats interviennent en dehors du territoire national. On est loin de l’époque où, quand son ministre des Affaires étrangères évoquait l’idée d’un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU pour l’Allemagne, Helmut Kohi rétorquait qu’il n’était pas possible de parler de ce sujet. Désormais, cette revendication est officielle – et soutenue par la France.
Je n’irai pas, comme certains, jusqu’à parler d’un sentiment antieuropéen, mais, chez les dirigeants comme dans la population, on commence à estimer que l’Allemagne, qui est déjà le premier contributeur net au budget européen, est (trop ?) fortement mise à contribution. Les réformes engagées à partir de 2004-2005 ont permis de préserver un système de protection sociale largement hérité des années du miracle économique : les dépenses sociales pèsent toujours 29 % du PIB, dont 11 % pour la santé. Mais les Allemands estiment avoir accompli beaucoup de sacrifices pour adapter leur système. Par exemple, en matière d’indemnisation du chômage : au bout de douze mois, les chômeurs de moins de 50 ans doivent se contenter d’une allocation forfaitaire de 364 euros par mois. Ils supportent donc de plus en plus mal de payer pour d’autres qui n’en ont pas fait autant. Le livre de l’ancien patron de la fédération de l’industrie, Hans-Olaf Henkel, Sauvez notre argent ! L’Allemagne est bradée, rencontre un véritable écho dans la population. Un récent sondage montre que 62 % des Allemands pensent qu’il n’est pas normal que les pays les plus riches paient systématiquement pour ceux qui se sont endettés. Angela Merkel a défendu cette position en imposant l’idée de mécanismes de surveillance plus stricts et la notion de restrictions à l’injection de fonds supplémentaires. Elle a fait prévaloir ce que les Allemands appellent la « culture de la stabilité ». Les élites économiques, plus encore que les politiques, sont prêtes à discuter les priorités européennes si elles vont à l’encontre de leurs intérêts. Cela se traduit dans l’idée de créer deux zones euro, comme le suggère Hans-Olaf Henkel.
La première inquiétude est liée à l’effondrement de la démographie. Les chiffres indiquent qu’au rythme actuel la population aura diminué de 18 millions d’individus en 2050, tombant à 64 millions d’habitants ! Ce qui va poser la question du financement de la protection sociale. Actuellement, les plus de 60 ans représentent 25 % de la population; ils pèseront 40% en 2050. Qui va payer? La question de la démographie et de l’immigration est d’ailleurs au cœur de l’ouvrage polémique L’Allemagne court à sa perte, de Thilo Sarrazin, ancien sénateur social-démocrate de Berlin, qui souligne brutalement que le pays n’a pas été capable de bien intégrer ses immigrés. Or, pour maintenir le financement du système social, on estime qu’il faudrait en doubler le nombre.
Le phénomène des banlieues à la française n’existe guère en Allemagne, même si apparaissent aujourd’hui des zones défavorisées qui cumulent les handicaps, économiques, sociaux et scolaires. A Berlin, il y a trois ans, les enseignants d’un quartier difficile ont fait la une des journaux en annonçant qu’ils ne voulaient plus travailler avec des classes où plus de 80 % des élèves étaient en échec scolaire, ne parlaient pratiquement pas allemand, et dont les familles ne manifestaient aucun désir de s’intégrer. Angela Merkel elle-même a reconnu que le «modèle multiculturel » ne marchait plus. Le phénomène est récent, mais il en est résulté, comme ailleurs, un sentiment d’hostilité à l’égard des immigrés dans une partie de la population.
L’Allemagne revendique davantage de parler avec les « grands » du monde, Washington, Moscou ou Pékin, où elle est d’ailleurs reconnue comme puissance. Pour les Russes, par exemple, le passage obligé vers l’Union européenne, c’est Berlin. C’est un problème pour la France, qui sent qu’elle pèse moins diplomatiquement et économiquement. Le partenariat franco-allemand reste un élément central de la diplomatie allemande, mais il est vécu de manière moins émotionnelle qu’auparavant. Il se trouve relativisé par le fait que, sur les grands projets, il n’y a plus depuis plusieurs années de démarche ni de vision communes, en dépit de mises en scène régulières qui finissent même parfois par irriter Berlin. Par exemple, il n’y a pas d’accord franco-allemand clair sur ce que devraient être les frontières de l’Europe – même si la France et l’Allemagne ont récemment bloqué l’élargissement de l’espace Schengen-, ni de position commune sur la politique énergétique à l’égard de la Russie, pas plus qu’il n’existe de politique commune en matière de recherche. En économie, la France semble vouloir subitement s’inspirer du « modèle allemand », ce qui étonne jusqu’à Berlin, où l’on a encore du mal à comprendre l’idée de « convergence fiscale » dont parle Sarkozy. De même, si l’Allemagne accepte de parler de « gouvernement économique », le terme ne recouvre pas la même réalité des deux côtés du Rhin : on a vu que, récemment encore, Angela Merkel s’était opposée à une plus grande structuration de la zone euro, avec un secrétariat permanent, comme le voulait la France. Au niveau personnel, il subsiste, au-delà du cérémoniel, une certaine méfiance entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, même si les signes d’une tentative de relance du couple franco-allemand ne doivent pas être négligés.
A la fin de la présidence Chirac, il y avait, à Berlin, une très forte attente d’un changement à Paris. Une attente à l’égard de Sarkozy qui a été suivie d’une profonde déception. D’abord, Berlin a mal supporté que les réalisations de la présidence allemande de l’Union européenne, notamment pour remettre sur les rails le projet constitutionnel, au premier semestre 2007, aient été récupérées par Nicolas Sarkozy. Ensuite arrive l’affaire de l’Union pour la Méditerranée. Ce fut une lourde erreur que de tenter de marginaliser l’Allemagne sur ce dossier qui l’intéressait réellement. La confiance et la complicité, toutes deux nécessaires, en ont pâti. Il en reste des traces.
La France aurait intérêt à enfin comprendre ce qu’est cette nouvelle Allemagne. Le rééquilibrage des relations franco-allemandes passera par là tout autant que par de vrais grands projets structurants communs.