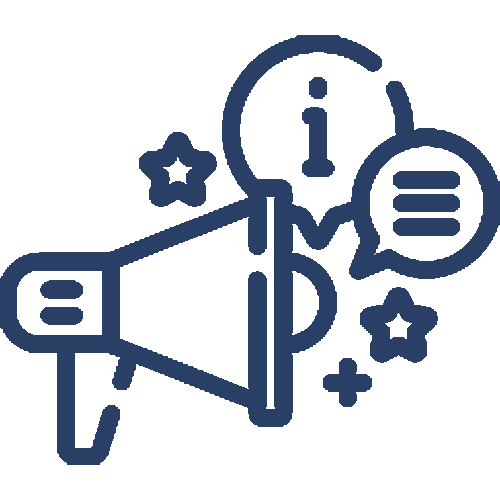Le but du système économique actuel est absurde : il consiste, en effet, à faire arriver sur les tables et dans les armoires du consommateur occidental le maximum de produits possible au plus bas coût possible. Sa seule finalité est de faire consommer encore et toujours plus. L’hyperconsommation est devenue un fait de culture. Or ce système commence à s’épuiser, et il faut penser autrement les problèmes auxquels la planète est confrontée. Mais on ne produit, bien sûr, que pour les gens solvables. La sous-alimentation et la malnutrition n’ont pas été éliminées. Pour analyser le phénomène des pénuries, on ne peut s’intéresser uniquement aux problèmes de production. La question de la distribution est essentielle, puisque l’on constate que, même dans les pays les plus riches du monde, il y a des gens qui ont faim. Il va donc falloir non seulement produire plus, mais aussi distribuer mieux. Les deux préoccupations vont de pair.
Nous sommes, en effet, toujours dans une période d’accroissement démographique. Selon les estimations, le monde devrait compter deux milliards d’individus supplémentaires d’ici à 40 ans. Notre planète est certes en mesure de produire suffisamment pour nourrir la totalité de ses habitants, mais pas à n’importe quel prix. Quelle est la nature des problèmes alimentaires actuels. Tout d’abord, certaines régions du monde ne produisent pas assez pour nourrir leur population. La cause peut être un manque de ressources, une difficulté agricole ou bien une mauvaise gestion de l’agriculture. Les changements climatiques modifient aussi les données dans des régions pauvres. Cela est déjà visible dans la ceinture intertropicale. II faut aussi tenir compte du point crucial de l’accès à l’eau. En dehors des problèmes de production, certaines agricultures ne sont pas forcément organisées dans le but d’assurer la satisfaction des besoins des populations. La nourriture est parfois mal distribuée ou affectée à des usages qui ne concernent pas directement l’alimentation humaine. La consommation de viande, par exemple, s’accroît considérablement, car elle accompagne l’augmentation du niveau de vie dans de nombreux pays. Or la production de viande est dévoreuse de céréales : il faut 4 à l2 calories végétales pour produire une calorie animale. La déperdition est énorme. Un phénomène plus récent est l’utilisation de végétaux pour la production de carburants. Nous sommes entrés dans un système ou cette utilisation concurrence réellement l’alimentation humaine. Aujourd’hui, quelque 60 % du maïs des Etats-Unis sont destinés à la fabrication de carburant. D’énormes surfaces agricoles ne sont plus consacrées à l’alimentation.
Dans certains pays qui ne produisent pas assez, le système agricole est en cause : il a été délaisse ou il est inadapté aux besoins. Les paysans y souffrent de la faim, ce qui peut paraître paradoxal puisque ce sont eux qui produisent la nourriture. La région soudano-sahélienne, par exemple, cumule les déficits de production quantitatifs et qualitatifs depuis des décennies. Le rendement des céréales à l’hectare est inférieur à la tonne alors qu’il dépasse la dizaine de tonnes en France ou aux Etats Unis. Cette situation résulte historiquement de la ponction effectuée sur les paysanneries pour les besoins de la construction des appareils d’Etat. Depuis un demi-siècle, les termes de l’échange intérieur ont été presque systématiquement défavorables aux paysans. Les régions rurales survivent dans un équilibre précaire qui est mis à mal par les aléas du climat et l’accroissement démographique. Certes, quelques pays ont investi. Mais l’agriculture a été développée selon un modèle inadapté aux besoins dans des zones réduites, qui consomme énormément de capitaux et d’intrants tout en recourant peu à la main d’œuvre. Calqués sur le système productiviste occidental, il fournit des produits chers et ne nourrit pas les paysans, puisqu’il ne les emploie pas. Pourtant, avec moins de moyens et plus de volonté, on aurait pu simultanément augmenter leurs revenus et la production.
Il n’est pas nécessaire de copier aveuglement le modèle productiviste pour obtenir des rendements meilleurs. Un doublement ou un triplement serait suffisant pour nourrir la population de ces pays. Hélas, le système des échanges mondiaux bouleverse la donne. Les grands pays agricoles disposent de surplus massivement subventionnes, qu’ils exportent, et qui inondent les marchés tiers. Résultat les paysans locaux sont privés de leurs débouchés. C’est ainsi que la filière avicole sénégalaise a été détruite par les importations des poulets européens il v a quelques années. Une autre question se pose : certains pays sont obligés d’importer pour répondre à l’évolution des habitudes alimentaires de leur population alors qu’ils produisent globalement assez de nourriture. C’est le cas par exemple du Mali autosuffisant en mil, mais qui achète du riz et du blé, céréales plus facilement transformables.
L’agriculture fonctionne dans un système mondialisé biaisé puisqu’il est régulé par les plus puissants. Les pays occidentaux en ont une vision à géométrie variable : ils imposent aux pays du Sud une ouverture totale de leurs marchés, mais restent très protectionnistes pour eux-mêmes. C’est pourquoi des pays, comme le Brésil, demandent une ouverture totale de tous les marches car ils pensent être en capacité de concurrencer les producteurs du Nord. D’autres, comme l’Inde, estiment qu’il est impossible d’assurer la survie de millions de paysans sans une certaine dose de protectionnisme agricole. Un fait est certain l’agriculture de nombreuses régions du Sud ne peut se développer qu’à l’abri d’un système protégeant leurs producteurs comme en ont organisé les pays de l’Union européenne ou les Etats-Unis, lorsqu’ils se sont eux-mêmes développés. L’abolition totale des barrières douanières signifie la mort, au sens propre, de la petite paysannerie.
L’évolution de l’agriculture des pays en développement pose donc la question des modèles. Les «révolutions vertes» des années 1960 ont obtenu des résultats grâce à un recours massif aux semences améliorées, aux intrants et à l’irrigation. Cela a permis de mettre fin aux grandes famines asiatiques liées à des pénuries de denrées – alors que les famines actuelles sont davantage dues à des raisons politiques. Mais des effets pervers ont été observés de façon différée : les paysans les plus pauvres n’ont pas bénéficié de ces révolutions, les sols s’épuisent et l’irrigation a aussi des effets négatifs (grands barrages, salinisation, épuisement des ressources). Aujourd’hui, aucun des décideurs du système ne réfléchit véritablement à un modèle différent de l’agriculture industrielle. Cela ne va pas plus loin qu’un peu de «greenwashing» dans les discours, l’utilisation de valeurs écologiques sans justification. Le petit nombre de personnes qui essaie de penser sérieusement à d’autres méthodes parle de « révolution doublement verte » : il faut utiliser des méthodes plus productives tout en étant respectueuses des écosystèmes, afin d’augmenter la production pour nourrir deux milliards d’humains de plus dans quelques décennies.
Les solutions possibles passent par l’abandon de la monoculture là où elle existe. L’uniformisation des productions et des variétés présente des risques, par exemple le développement de maladies endémiques. Il est possible de revenir aux cultures associées, à l’assolement, à la jachère, aux engrais organiques et à l’utilisation de protections contre les prédateurs des cultures, sans recours à des épandages chimiques massifs. Il est aussi nécessaire de développer des variétés plus rustiques. Hélas, la recherche n’a jamais vraiment tenté d’améliorer l’alimentation des pauvres. Elle est plutôt destinée à produire la pomme la plus grosse et la plus brillante possible pour des consommateurs « riches ». Il est nécessaire de relocaliser pour maintenir une agriculture paysanne au Sud, mais aussi dans les pays du Nord. Cela permet de diminuer l’empreinte écologique liée au transport qui a des conséquences sur le changement climatique.
Les pays riches ont vécu en moins d’une génération un important changement culturel vis-à-vis de l’alimentation : le système productiviste à bas coûts et la quasi gratuite du transport mondial ont offert quantité de produits à bas prix, toute l’année, en Europe et aux États-Unis, mais sans se souder de la destruction des emplois, de l’environnement et de l’éloignement de la production. Le résultat est que le travail des agriculteurs n’ est plus assez rémunéré. La course à la production au plus bas coût possible entraîne forcément la baisse de la qualité de l’alimentation.
Favoriser la démocratie, c’est donner aux gens la maîtrise du savoir. Aujourd’hui, tout est fait pour que le consommateur n’ait pas conscience de la traçabilité des filières de production. Il existe toujours une arme alimentaire, mais elle a changé de nature depuis les années 1970. Des mécanismes conduisent à affamer des gens, même si ce n’est pas toujours volontaire. Par exemple, les systèmes de subventions destinés à rentabiliser l’agriculture du Nord ruinent les paysans du Sud. L’Alena*, l’accord de libre-échange nord-américain, est en train de détruire la petite agriculture paysanne du Mexique. Hélas, la faim et la misère abjecte et absolue ne sont pas des moteurs de révolte, mais plutôt de résignation. En Inde, les paysans qui n’arrivent pas à s’en sortir ne trouvent pas d’autre issue que le suicide. L’histoire montre que les soulèvements sont toujours menés par des populations qui commencent à sortir de la misère. Quand on manifeste, c’est qu’on a encore le sentiment qu’on est capable de changer les choses comme le montrent les mouvements actuels dans les pays arabes. L’expression « émeutes de la faim » a toujours été employée pour désigner, en fait, des mouvements contre la vie chère. C’est le blocage de l’ascenseur social qui provoque le mécontentement. La question de la nourriture n’est qu’une partie du problème. Décevoir les espoirs des populations a toujours des conséquences.