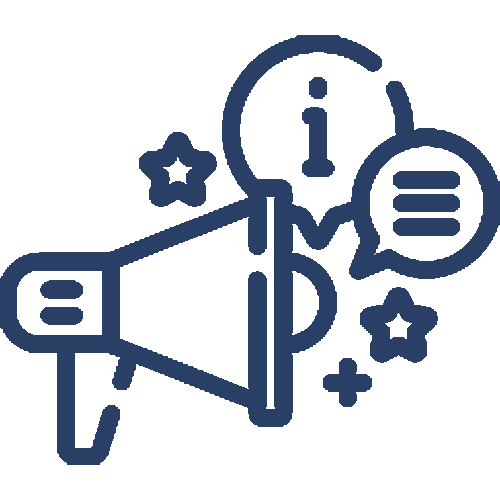La crise économique qui a éclaté en 2008 a montré les limites des logiques monétaristes et des politiques de dérégulation qui prédominaient depuis la fin des années 1970. L’on a assisté à un retour en grâce des idées keynésiennes et les Etats, parfois contraints et forcés, ont recommencé à jouer un rôle de premier plan. Le paradoxe vient toutefois du fait que ce sont surtout les Etats-Unis et la Chine qui ont lancé d’ambitieux plans de relance pour soutenir la demande intérieure. L’Europe de Keynes semble au contraire avoir choisi des politiques de rigueur. Si elle peut apparaître nécessaire compte tenu de l’ampleur des déficits, l’austérité risque néanmoins d’accentuer certains effets de la crise.
Décédé en septembre 2009, Irving Kristol, journaliste très influent qui fut trotskyste avant de devenir le parrain intellectuel du néoconservatisme, avait été l’un des premiers à sonner le glas des « trente keynésiennes ». Dans un article publié le 9 mai 1977 dans le Wall Street Journal, et intitulé « Toward a ‘New’ Economics ? », il soulignait qu’une nouvelle approche de l’économie était en train d’émerger, fondée sur la critique du keynésianisme par l’école monétariste, critique ensuite poursuivie de façon hétérodoxe par des économistes comme Robert Mundell et Arthur Laffer. Cette école, écrivait Kristol, « est encore embryonnaire et le monde ne l’a pas encore vraiment remarquée. »
Ce qui n’empêchait pas Kristol, prescient, de poursuivre : « Il est difficile de surestimer l’importance du fait que, pour la première fois en un demi-siècle, c’est la philosophie économique des conservateurs qui montre des signes de vigueur intellectuelle, tandis que la philosophie économique des libéraux[1] continue de s’empêtrer dans des noeuds gordiens. » A une époque où les économies occidentales étaient marquées par la stagflation, Kristol concluait : « La principale préoccupation, et de loin, de cette nouvelle économie est la nécessité de diminuer les impôts, partout et de façon significative, car c’est le niveau élevé des taux d’imposition qui étouffe les incitations à la croissance. »
Taux d’imposition : d’un extrême à l’autre
On a aujourd’hui tendance à oublier que les taux d’imposition alors en vigueur dans la plupart des pays européens et même aux Etats-Unis battaient des records. A la fin des années 1950, dans le « pays phare du monde libre en lutte avec le communisme », dans l’Amérique du républicain Eisenhower, le taux marginal d’imposition pour la catégorie supérieure était de 91 % ! Ce taux atteignait encore 70 % sous le mandat de Richard Nixon. En Grande-Bretagne, le gouvernement de James Callaghan (1976-1979) avait fixé un taux maximal d’imposition quasiment confiscatoire, puisqu’il atteignait 96 %. Autodidacte influencé par les idées de l’économiste socialiste Harold Laski, Callaghan trouvait tout à fait naturel que les catégories les plus favorisées contribuent lourdement à la solidarité nationale, à travers des impôts sur les grandes fortunes ou sur les plus hauts revenus.
Si un réajustement était bien évidemment nécessaire pour relancer l’esprit entrepreneurial et l’innovation, on était loin de s’attendre à ce que la bascule aille aussi loin dans le sens opposé. Plus qu’un simple changement de paradigme, c’est un véritable changement d’univers qui s’est opéré. L’attribution du prix Nobel d’économie à Milton Friedman, l’élection de Margaret Thatcher en 1979 puis celle de Ronald Reagan en 1980 allaient enclencher un processus de dérégulation à outrance.
Les années 80 furent celles de l’argent roi, et si le film d’Oliver Stone, Wall Street, eut tant de succès, c’est que son personnage principal, le désormais célèbre Gordon Gekko, joué par Michael Douglas, était l’incarnation parfaite de l’esprit du temps. Le slogan de Gordon Gekko, « Greed is good »[2] était emblématique de toute une époque marquée par l’effacement de l’Etat, l’individualisme absolu, la poursuite effrénée du profit et la financiarisation de l’économie[3].
Ce phénomène allait être conforté par la mondialisation des échanges et l’essor économique des années 1990, mais ensuite s’aggraver par l’abrogation en novembre 1999, sous le mandat Clinton, du Glass-Steagall Act[4], puis par la politique fiscale de George W. Bush, qui, à coup de réductions drastiques d’impôts, allait alourdir les déficits et considérablement creuser la dette jusqu’à dépasser les $ 12.700 milliards à la fin de son mandat.
Le taux maximal d’imposition qui était encore de 50 % sous le mandat de Ronald Reagan fut ramené à moins de 35 % par George W. Bush, bien loin des 91 % de l’Amérique d’Eisenhower.
Le graphique ci-joint, réalisé par le Congressional Budget Office, établit une projection des déficits sur les prochaines années et montre bien que la crise économique actuelle n’est responsable que d’une petite partie de ce gouffre, la majeure partie étant la résultante des réductions d’impôts de l’ère Bush et des guerres d’Irak et d’Afghanistan.