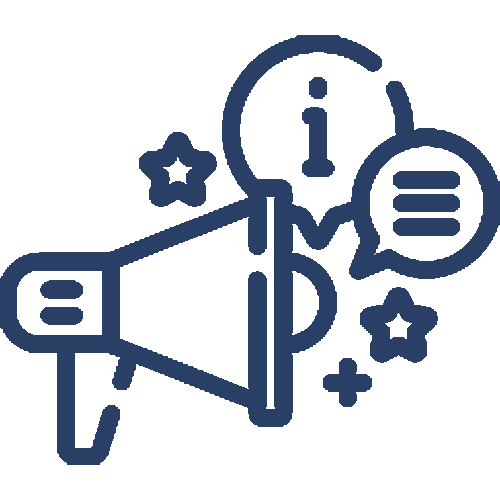Y aurait-il un deux poids deux mesures de la part des pays occidentaux, et plus largement de la communauté internationale à l’égard de la répression à laquelle se livrent les régimes libyen et syrien face à la contestation populaire qu’ils subissent ?
Certains pays de l’OTAN, avec l’approbation de la Ligue des Etats arabes et le feu vert juridique de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies, bombardent depuis plus de trois mois les positions du colonel Kadhafi en Libye. Alors que la répression s’intensifie chaque jour en Syrie et que, malgré le couvre-feu médiatique que veut imposer le régime syrien, les images des horreurs qui s’y passent nous parviennent, aucune mesure concrète ne semble être prise contre Bachar El Assad. Comment expliquer cette différence de traitement ? Plusieurs raisons pertinentes ou contestables expliquent cela.
Tout d’abord, Bachar Al-Assad est moins diabolisé que ne l’est Kadhafi dans les opinions occidentales. Il est, à tort ou à raison, perçu comme un gage de stabilité, alors que Kadhafi est associé à l’instabilité. Ce dernier, outre l’hostilité des opinions occidentales, s’est mis à dos l’ensemble des chefs d’Etats arabes, ce qui n’est pas le cas de son homologue syrien. Il est donc plus facile pour les pays occidentaux d’avoir le soutien de leur opinion pour se lancer dans une guerre contre Kadhafi. Il avait annoncé un massacre avant d’avoir le temps de le mettre en œuvre, Bachar Al-Assad le commet sans le dire. Il y a un fossé entre les déclarations d’ouvertures et promesses de dialogue syrien et ses actes basés sur la seule répression.
Le leader syrien a vu dans l’intervention militaire occidentale contre la Libye, une fenêtre d’opportunité. Il a compris qu’il leur serait difficile d’ouvrir un second front militaire tant que l’affaire libyenne n’était pas achevée. Il en profite donc pour se livrer à une répression de masse en pensant bénéficier de l’impunité. Outre les limites des capacités militaires des pays occidentaux, le régime syrien profite également du courroux suscité chez certains membres du Conseil de sécurité dans le changement de la mission entamée en vertu de la résolution 1973.
Au départ, les frappes des pays de l’OTAN devaient seulement protéger la population libyenne du massacre promis par Kadhafi. Entre-temps on est passé au changement de régime et à la cobelligérance. Les pays qui s’étaient abstenus pour ne pas s’opposer à la mise en place de cette opération militaire se sont sentis floués. Il serait de ce fait difficile de trouver un accord au Conseil de sécurité pour entamer une nouvelle opération. En se donnant pour mission de mettre fin au régime Kadhafi, c’est le concept même de responsabilité de protéger (qui se distingue de l’ingérence classique, car basé sur une approche légale et multilatérale) qui a été mis à mal.
Enfin, les difficultés des opérations militaires effectuées en Libye freinent les ardeurs de ceux qui voudraient en découdre avec Bachar Al-Assad. L’armée syrienne étant considérée comme supérieure à l’armée libyenne. Par ailleurs, il n’y a pas d’insurgés sur lesquels l’OTAN pourrait s’appuyer en Syrie, il y a juste des civils qui fuient la répression comme ils le peuvent. Ce fait devrait normalement être un motif supplémentaire pour intervenir mais cela produit l’effet inverse.
On voit une fois de plus que l’évocation de la morale dans les relations internationales s’efface devant les calculs des rapports de force. La morale joue plus un rôle de légitimation d’une action qu’elle ne constitue sa motivation première.
Mais s’il peut paraître sage de ne pas se lancer dans une aventure militaire contre la Syrie, faut-il pour autant ne rien faire ? Entre la guerre aux résultats improbables et l’inaction il y a toute une gamme d’options. Le Conseil de sécurité pourrait saisir la Cour pénale internationale. Il pourrait étudier la gamme des sanctions envisageables à l’égard de la Syrie et de ses dirigeants. Ce grand écart entre la rapidité de l’intervention en Libye et la lenteur à réagir face au drame syrien est troublant et condamnable.