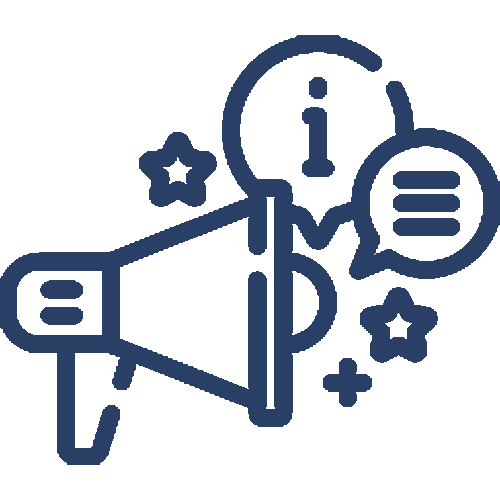Chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), Jean-Jacques Kourliandsky est spécialiste des questions ibériques. Entretien.
Parce que la conjoncture économique est catastrophique et que le président du gouvernement a pensé qu’organiser des élections avant que la situation ne se dégrade encore permettrait de limiter la casse. C’est purement opportuniste, espérant éviter un Parti popular (PP), de droite, majoritaire afin de contraindre à des alliances. Mais les sondages semblent montrer que les choses ne se passeront pas ainsi.
Et ces élections ont traditionnellement, valeur de sondage « réel » pour celles générales. Pourquoi cette victoire de la droite ? A cause de la crise, il n’y a pas d’autres explications. Celle-ci est très violente : un chômage extrêmement haut, des salaires et des retraites qui chutent, un impact sur la consommation et une crise immobilière qui se matérialise de manière identique à ce qui s’est passé aux Etats- Unis avec des personnes qui chaque jour doivent donner leur clé à leur banquier faute de pouvoir rembourser leur prêt, il peut certes sembler paradoxal que le peuple espagnol vote pour un parti dont le leader est peu charismatique, dont le programme est flou et qui est peu présent dans les médias. Mais c’est un vote sanction. Les Espagnols n’acceptent pas les effets de la crise.
En Espagne, le paysage politique s’articule autour de deux grands partis : le PP et le Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE, même si d’autres partis, mais beaucoup plus petits existent. Cependant, élections locales et sondages montrent que les reports de voix existent et que les électeurs socialistes ne vont pas tous voter pour le PP. Le parti communiste, qui s’est allié à d’autres dans la Gauche Unitaire, pourrait ainsi bénéficier de reports. Les sondages annoncent une hausse de 40% mais qui ne les mettraient qu’à 7%. Il y a aussi les cas particuliers de la Catalogne et du Pays basque. Le parti de centre droit Convergence et Union devrait ainsi augmenter, tout comme la coalition indépendantiste du pays basque. Le paysage politique devrait donc évoluer mais à la marge. Il faudra enfin regarder de près l’abstention, dans un pays qui vote beaucoup, à hauteur de 70%.
Après la défaite de ses prédécesseurs qui prônaient l’alliance avec le parti communiste, José Luis Rodriguez Zapatero a effectivement évolué vers une troisième voie, non pas sur les traces d’un Tony Blair qui entretenait des relations proches avec Aznar du PP, mais sur le modèle allemand. L’aventure a été nommée « Socialisme républicain » en référence à Philip Pettit, philosophe politique irlandais, chantre de la liberté individuelle et prônant l’essor des classes moyennes. Zapatero s’est concentré sur des mesures plus sociétales : le mariage de personnes du même sexe, la lutte contre les violences faites aux femmes, la réforme du statut de la Catalogne, etc. En revanche, côté économie, Zapatero s’est contenté de poursuivre le modèle mis en place par ses prédécesseurs, reposant sur l’immobilier, le tourisme et l’agriculture. Aujourd’hui, seul le dernier pilier fonctionne encore et la crise montre combien il aurait fallu diversifier cette économie.
Depuis que Zapatero s’est mis en retrait, le discours s’est gauchisé. Le parti a remis du rouge sur ses affiches, il met des propositions pour relancer la croissance dans son programme. Mais ce discours a du mal à passer. Quand, dernièrement, Zapatero introduit dans la constitution l’interdiction du déficit budgétaire comme le demande l’Allemagne, c’est cohérent avec ce qu’il a fait depuis 2004 mais cela n’aide pas le candidat du PSOE à dire qu’il a changé. Enfin, il ne faut pas oublier que ce vote sanction est aussi très lié à la personne de Zapatero.
José Luis Rodriguez a été élu en 2004 sur la transparence. C’était après les attentats à Madrid injustement attribués par le PP à l’ETA pour, au passage, s’en prendre aux socialistes qui auraient été trop laxistes avec eux. Mais cela a rapidement volé en éclat. Il a aussi été élu sur l’Irak et le désengagement de l’Espagne dans cette guerre : réalisé immédiatement après son arrivée au pouvoir. Zapatero était donc l’homme qui disait la vérité.
Mais en 2008, à sa réélection, il a assuré que la crise était conjoncturelle, que l’Espagne était dans le peloton de tête des bons élèves européens. Un discours maintenu pendant un an qui est apparu d’autant plus décalé quand les mesures autoritaires ont été prises.
Cet horizon bouché trouve sa plus grande traduction dans le mouvement des indignés, tous ces jeunes qui manifestent auraient, sinon, probablement voté socialiste. Et la perpétuation de cette crise ne manquera pas d’avoir des effets sur la paix sociale. Tous les observateurs s’étonnent du caractère pacifique du mouvement qui ne dégénère pas en manifestations dures comme en Grèce. Pour beaucoup, une des explications réside dans la solidarité familiale. Mais cela ne saurait durer.