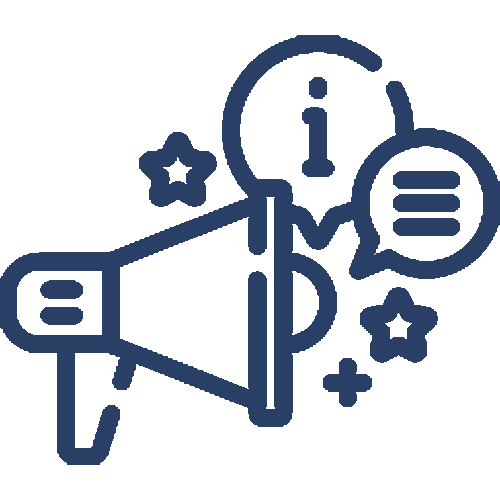Après cinquante ans d’une dictature militaire sanguinaire, le vent du changement souffle sur la Birmanie. Cette semaine, les Birmans se sont vu octroyer le droit de se syndiquer et de faire grève. Depuis sa formation en mars, le gouvernement civil du président Thein Sein multiplie les gestes d’ouverture. Il a accordé l’amnistie à 6300 détenus, avant de libérer 200 prisonniers politiques cette semaine. «Pour respecter la volonté du peuple», la Birmanie a suspendu en septembre un projet de barrage hydroélectrique financé par la Chine, au risque de froisser son traditionnel allié. L’opposante Aung San Suu Kyi a rencontré le 19 août Thein Sein. Pour la première fois, elle exprime alors son optimisme. Avec prudence. Car près de 1800 prisonniers politiques croupissent encore dans les geôles birmanes. Journalistes, avocats, artistes, opposants ou moines bouddhistes, beaucoup sont emprisonnés depuis des décennies. Sceptiques, les observateurs ont d’abord perçu les nouveaux élans du nouvel homme fort comme autant de gestes cosmétiques pour séduire l’Union européenne et les Etats-Unis, qui imposent des sanctions à la Birmanie depuis la fin des années 1990. C’est plus que cela, explique Olivier Guillard, directeur de recherche Asie à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) à Paris.
On pouvait croire d’abord à une gesticulation politique du pouvoir birman pour s’attirer les faveurs de l’Occident. Mais, au vu de la rapidité des transformations, elles apparaissent plus comme un vrai mouvement de fond. Le nouveau président montre une réelle sincérité pour faire avancer les choses. Tous les observateurs sont surpris par la rapidité des transformations en cours, il reste beaucoup à faire bien sûr, mais ce changement est aussi spectaculaire que profond.
Thein Sein n’est pas seul, mais il est soutenu par d’autres acteurs de poids, le chef de l’état-major actuel, le président de l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur et celui de la Défense cautionnent les avancées inédites et courageuses du nouveau président. Ils représentent un courant de pensée réformateur, qui tente d’extraire la Birmanie de l’impasse économique dans laquelle elle se trouve. Pour obtenir de meilleures conditions économiques sur le plan international, ils savent qu’il est nécessaire d’actionner les leviers politiques : libérer les prisonniers, adopter une attitude plus pacifique avec les groupes ethniques minoritaires. Le pouvoir commence à répondre aux attentes de la communauté internationale, mais aussi de la communauté des affaires de ce pays sinistré. Ce n’est pas une révolution par la contestation, mais une révolution en douceur, impulsée par le haut.
L’hypothèse d’un coup d’Etat militaire n’est pas totalement exclue. Les transformations ne plairont pas à la vieille caste militaire, soucieuse de préserver ses privilèges. Mais les réformes sont soutenues par la majorité de la population et par la communauté internationale. Elles sont bien parties.
Elle est n’est plus seulement l’icône de l’espoir démocratique dans le pays. Elle accompagne les changements du régime et montre son optimisme. Elle se trouve dans une logique de coopération inédite : elle, l’opposante numéro un, pasionaria d’une Birmanie sans militaires, est invitée à dîner avec le président. C’est du jamais vu. Le pouvoir sait qu’il ne peut pas se passer d’elle, dans le pays comme à l’extérieur. Elle aura un rôle clé lorsqu’il sera temps d’appeler les Etats-Unis et l’Europe à lever les sanctions qui pèsent sur la Birmanie. Elle pourrait donner l’élan politique en faveur de son pays.
Le pouvoir birman tient compte de la peur de la Chine au sein de la population et livre ainsi un gage d’indépendance. La Chine est le premier investisseur en Birmanie, le pays aura encore besoin d’elle pendant longtemps. Mais, en tentant de diversifier ses alliances, notamment avec l’Inde, elle montre que Pékin n’est pas seul à la courtiser. C’est un message bien ressenti par la communauté internationale, qui se demande en ce moment si elle va accompagner la Birmanie dans ses transformations.