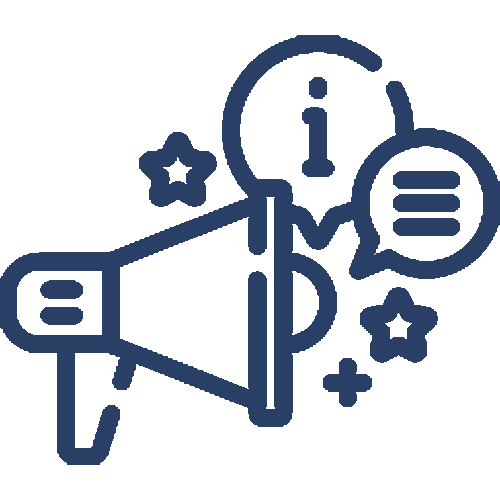L’année 2011 restera marquée par l’évènement catalyseur d’une série de soulèvements populaires : l’immolation d’un homme qui provoqua la première révolution du XXIe siècle et une puissante onde de choc dans l’ensemble du monde arabe. Cette façon suicidaire d’interpeler le pouvoir constitue un acte de rupture avec les différents modes de mobilisation politique : à travers le vote, la manifestation ou la révolution, une forme de participation (plus ou moins directe et agencée) est pensée. Le geste de Mohammed Bouazizi échappe à cette typologie : son suicide est à la fois l’expression funeste d’une dés-espérance, d’une dé-mobilisation, et un acte postmoderne de résistance et de défiance à l’égard du pouvoir. Mieux, véritable fondement ontologique de la révolution tunisienne, cette action individuelle et nihiliste a suscité une mobilisation collective puissante et radicale pour un avenir meilleur. Le paradoxe apparent de cette immolation s’inscrit dans un imaginaire entourant l’action du feu et celle des hommes, le feu de l’action et la révolte radicale. Bachelard, dans sa Psychanalyse du feu, définissait déjà le complexe d’Empédocle comme une fascination pour le bûcher, où «la destruction [par le feu] est plus qu’un changement, c’est un renouvellement».
Cette révolution est une invitation à la déconstruction des grilles d’analyse et autres dogmes orientalistes enracinés dans les chancelleries occidentales. Le 14 janvier 2011 fut la démonstration de la capacité d’un peuple arabe à recouvrir sa pleine souveraineté, à se transcender au nom de l’idéal démocratique et à porter un message universel, pacifique. Après le temps de la passion révolutionnaire, le temps du désenchantement démocratique ?
La démocratie n’est ni innée ni acquise : c’est une construction qui suppose une acculturation. En visite officielle en Tunisie (mars 2011), le secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a estimé que «la révolution tunisienne est un modèle de transition démocratique». Une telle prétention est discutable, car il demeure difficile de théoriser ou de «modéliser» les phénomènes de «transition démocratique». En outre, il est encore trop tôt pour connaître l’issue du processus enclenché en Tunisie, pays qui connaît une crise protéiforme. La transition démocratique est par définition une période charnière, incertaine, faite d’improvisations de la part d’acteurs qui font l’expérience de la démocratie en temps réel. Enfin, au-delà de la formule englobante et artificielle de «printemps arabe», le mouvement de mutation politique s’inscrit dans des sociétés (tunisienne, libyenne, égyptienne, yéménite, syrienne…) marquées par d’irréductibles particularismes inhérents aux identités nationales, locales. Il n’empêche, au-delà de la révolution tunisienne, on ne peut nier le mouvement transnational qui traverse le monde arabe. D’abord, il s’agit de soulèvements populaires – souvent initiés par la jeunesse – à l’encontre d’un système de captation du pouvoir politique et économique par des clans familiaux qui ont dénaturé le caractère républicain du régime. Ensuite, les mobilisations sont d’ordre politique (désir de démocratie, de liberté, de dignité) et social (lutte contre l’injustice, la corruption et le chômage de masse qui touche des pays qui connaissent une transition démographique rapide). Alors que ces sociétés sont souvent présentées comme archaïques, elles ont su conjuguer des formes classiques (manifestations de masse, grèves générales) et modernes, technologiques (information continue via les chaînes spécialisées, Internet et réseaux sociaux) de mobilisation. Enfin, forts de la rupture symbolique qu’ils incarnent et de leur ancrage dans des sociétés qui demeurent conservatrices, les «islamistes» – l’islamisme politique est pluriel – sont sortis renforcés des mouvements populaires dont ils n’étaient pas les instigateurs. Pourtant, on ne saurait parler d’ores et déjà d’un quelconque mouvement «contre-révolutionnaire». Les intégristes n’en demeurent pas moins des «animaux politiques» qui savent se départir d’un certain dogmatisme (religieux ou non). Le cas tunisien atteste de leur capacité à former une coalition avec des partis «progressistes» minoritaires, et ce au nom de l’intérêt national. Surtout, au-delà des discours et des postures des nouveaux acteurs, le peuple demeure le gardien souverain de sa révolution.
Par une ruse de l’histoire, les mouvements populaires qui traversent le monde arabe viennent rendre un ultime hommage à la pensée de Frantz Fanon, dont on commémore le cinquantième anniversaire de la disparition. De façon prémonitoire, cette figure de l’anticolonialisme avait prévenu : l’«indépendance» n’est pas forcément synonyme de désaliénation ou d’émancipation des peuples. L’avertissement vaut également pour la démocratie. Pour autant, l’expérience mérite d’être vécue.