Décembre 2016
Logiques du djihad / Par François-Bernard Huyghe
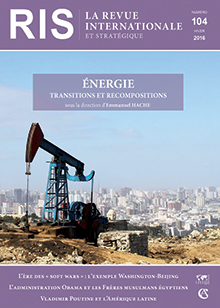 Énergie : transitions et recompositions
Énergie : transitions et recompositions
RIS N°104 – Hiver 2016
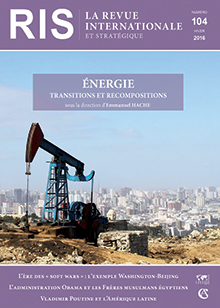
À propos de : Scott Atran, L’État islamique est une révolution, Paris, Les Liens qui libèrent, 2016. Jacques Baud, Terrorisme. Mensonges politiques et stratégies fatales de l’Occident, Paris, Éditions du Rocher, 2016. Gabriel Martinez-Gros, Fascination du djihad. Fureurs islamistes et défaite de la paix, Paris, Presses universitaires de France, 2016. Philippe-Joseph Salazar, Paroles armées. Comprendre et combattre la propagande terroriste, Paris, Lemieux Éditeur, 2016. « Quelle guerre ? Quelle victoire ? », Médium, n° 49, octobre-décembre 2016
« Pourquoi nous haïssent-ils ? », se demandaient les Américains au lendemain du 11-septembre. « Pourquoi nous combattent-ils ? », s’interrogent désormais les Français voyant certains de leurs compatriotes rejoindre l’organisation de l’État islamique (Daech) en Syrie ou commettre des attentats sur le sol national, et qui se considèrent donc comme en guerre avec leur propre pays. Nombre de librairies ont affecté une table aux livres qui proposent une réponse. Beaucoup renvoient à des causes sociologiques – exclusion, chômage, relégation sociale –, d’autres à des facteurs démographiques et culturels – poids de la population immigrée, crise de l’autorité. Nombre de travaux se réfèrent aussi aux pulsions et frustrations supposées des djihadistes : leur appétit de violence et de destruction décrirait, pour prendre une métaphore hydraulique, comme un vapeur trouvant le canal, ou l’alibi, de l’islamisme pour exploser [1]. Des notions comme « radicalisation » se sont banalisées, mais forment une catégorie ambiguë dont on se demande si elle renvoie à l’adoption d’idées « extrémistes » criminogènes ou au choix d’une violence illimitée pour réaliser une utopie. Pourquoi cette forme, pourquoi maintenant, pourquoi avec cette violence contagieuse ?
Aucune de ces analyses n’est sans fondement, mais des facteurs d’incitation ou de prédisposition ne sauraient suffire à expliquer un phénomène sans précédent. Pourquoi ne pas prendre la perspective inverse, et raisonner du point de vue de la « cause finale » ? Que Daech soit source ou réceptacle – peu importe – d’une rage contagieuse, son discours doit exprimer quelque chose de particulièrement envoûtant pour attirer ainsi les âmes, ce qui défie nos habitudes mentales. Quelques publications récentes partent d’une compréhension de ce qui exalte ou séduit dans le califat ; leurs titres même suggèrent souvent où chaque auteur voit des pistes.
Expliquer pour comprendre
Tous voient dans le phénomène Daech une synthèse inédite : la mise en scène d’un territoire symbolique – le califat au « pays de Shâm » –, doublée d’une idéologie aux ambitions illimitées – il s’agit rien moins que de conquérir le monde et vaincre les non salafistes, non djihadistes, qui n’auraient pas fait allégeance, soit quelques milliards de gens – à quoi s’ajoute l’efficacité d’une propagande qui échappe à tous nos codes.
L’État islamique est une révolution, rappelle l’anthropologue franco-américain Scott Atran, prenant au sérieux la promesse faite par Abou Bakr al-Baghdadi de créer « un monde de justice et de paix sous la bannière du Prophète ». Ainsi, ce qui est un délire à nos yeux constitue pour beaucoup un facteur d’attraction difficile à égaler. La « joie » du djihadiste de se sacrifier pour l’utopie – gagnant au passage le salut de son âme, la certitude de participer à la bataille finale contre les « croisés » et l’occasion de punir ceux qui offensent dieu – est à rebours de l’image du nihiliste chère aux médias. L’enthousiasme du combattant ne s’exprime pas que par l’action armée, il a besoin de se rendre contagieux au service d’un projet mystique : gagner toutes les âmes. L’auteur reformule la phrase de Marshall McLuhan – « le message, c’est le média » : désormais, « le message, c’est la guerre » (p. 23), sorte de prophétie autoréalisatrice. Elle active une forme de sacré, comme un « sublime », au sens d’Edmund Burke : cette quête d’une peur « délicieuse » au-delà de toute expérience habituelle, qui transcende et nourrit une soif de vaincre rarement égalée. S’y ajoute l’envie de rejoindre une communauté de guerriers, de se fondre en une fratrie héroïque. L’offre idéologique et eschatologique de Daech – lutte, danger, gloire et mort – ne trouve guère de rivale dans le monde occidental.
Paroles armées, donc proclamations efficaces, diagnostique Philippe-Joseph Salazar, dans un ouvrage qui se réclame de la rhétorique comme branche de la philosophie. Il en applique les catégories pour analyser comment la parole et l’iconologie du califat l’aident non seulement à recruter et fanatiser – nul n’en disconvient –, mais aussi manifestent une autorité d’une nature inédite, tout en réactivant des catégories de pensée dignes de la casuistique médiévale en guise de légitimation. Cela inaugure un processus de retour et de relecture : les djihadistes ne font, disent-ils, que reprendre la terre [2] qui leur revient de par la volonté divine ; ils ne terrorisent pas, ils appliquent des sentences ; ils n’égorgent pas, ils sacrifient ; ils ne déploient pas d’artifices de communication – fussent-ils numériques, modernes et par l’image –, ils proclament, etc. Tout change de signe. La rhétorique djihadiste crée une relation surprenante : face à la supériorité technique et quantitative de leurs adversaires, ils poussent à l’extrême le triomphalisme spirituel et exacerbent une esthétique de la terreur, qui fait de nous les faibles et les fascinés. Chaque terme du système de représentation / affirmation globale se réinsère dans un nouveau code.
L’auteur décortique notamment la nature d’un « féminisme » ou d’une virilité djihadiste affirmée, mais aussi l’inadaptation des réactions occidentales – de type « Nous sommes Charlie » ou les tentatives de réfutation et contre-propagandes médiatiques –, pour identifier chaque fois les postulats contradictoires des deux camps. La radicalité même de cette différence et la contradiction de nos codes suscite l’hostilité sans limite : « Dans sa définition de l’humain (le rapport à l’Humanité), dans sa profession de foi politique (la nature de l’État), dans son recrutement de civils et de militaires (la nature de l’organisation sociétale) et dans sa stratégie guerrière (l’objet et la méthode d’une défensivité agressive) » (p. 249) et ce, à la mesure du tort qu’ils nous reprochent. Nos « valeurs » si favorables à l’ouverture, ou nos célébrations de la différence se heurtent ici à une altérité, et donc à un différend irréconciliables qui portent sur les fondements mêmes de l’organisation de la vie.
Fascination, diagnostique de façon très complémentaire Gabriel Martinez-Gros, qui enseigne l’Islam médiéval. Pour expliquer ce nouveau rapport de force et de faiblesse, mais aussi cette efficacité du langage califal, il remonte jusqu’à Ibn Khaldoun, géographe et philosophe de l’histoire du XIVe siècle, lui empruntant les catégories de sédentaires et de « bédouins » – à comprendre comme une image des tribus nomades violentes repoussées à la périphérie de l’Empire : « En un mot, notre monde moderne est en train de recréer des tribus pillardes, des confins barbares, d’abord et avant tout parce qu’il existe un monde à piller, un monde sédentaire au sens d’Ibn Khaldoun, un monde éduqué, ouvert, attaché à produire et à échanger bien plus qu’à se défendre. » (p. 96). Pour l’auteur, les explications du djihadisme en termes d’islamisation des banlieues ou de réaction postcoloniale manquent l’essentiel : la fascination et l’Histoire ne sont plus du côté des démocraties. Nous aurions tendance à surévaluer la responsabilité des interventions occidentales ou même la part du djihadime européen dans un processus où, toujours reprenant les catégories d’Ibn Khaldoun, le califat a su réunir la force de la dawa – l’appel, la cause, l’ambition historique – et celle de l’assabyia – le rassemblement des tribus en vue de la conquête.
G. Martinez-Gros oppose ainsi « notre » empire – ô combien sédentaire qui ne se reconnaît plus de rival ni d’ennemi et espère juste la perpétuation de son ordre – à « leur » vision, certes paranoïaque puisqu’elle implique une hostilité presque universelle, mais aussi porteuse mobilisatrice pour les nouvelles « tribus » en formation. Le califat rompt avec nos valeurs pacifiques et invente sa propre version d’une aristocratie guerrière animée par la foi.
Des sens transformés
Les trois auteurs refusent donc de réduire à des réactions d’individus « débiles » ou fragiles justiciables d’une thérapie ou d’un traitement social. Ils s’accordent – l’un mettant l’accent sur l’utopie, l’autre sur l’autorité du verbe, le troisième sur une forme de combativité quasi tribale – pour décrire une même synergie du dogme, des passions collectives auxquelles il répond et une attraction où l’esthétique et l’exaltation jouent leur rôle. D’où l’inversion du sens des notions suivant le camp qui les formule : victoire – effondrement de l’adversaire pour les Occidentaux, capacité de perdurer dans la voie de l’engagement pour les islamistes –, territoire – notion purement juridique versus communauté de croyance – et a fortiori terrorisme – louable pour eux comme acte de résistance et de dissuasion, irrationnel et criminel pour nous.
En proclamant le califat, implanté sur un territoire sacré, en renouant avec l’ancien pouvoir spirituel et temporel mythifié après une parenthèse historique, en exigeant de chacun qu’il lui fasse allégeance sous peine de s’éloigner du pur monothéisme, A. B. al-Baghdadi fait bien plus que « propager » – au sens où la propagande classique séduit pour mobiliser et attire pour persuader : il crée de nouveaux rapports de sens et d’autorité.
Pour le colonel suisse A. Baud, spécialiste du renseignement et stratège de la guerre asymétrique, il faut aussi remonter à la genèse du conflit, longtemps pensé suivant la catégorie du djihad défensif. Le mécanisme des interventions occidentales (Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, etc.) – nos stratégies fatales et contre-productives – renforce le discours sur l’opposition planétaire : croisés et mécréants contre musulmans persécutés. Il sert d’agent de recrutement objectif au djihadisme. Ce cercle vicieux est aggravé par l’incompréhension des mécanismes mentaux adverses. S’ajoute le souvenir des mensonges de guerre, dont le plus célèbre est l’affaire des armes de destruction massive de l’Irak. Même si l’auteur aurait pu mieux marquer la différence stratégique entre Al-Qaïda et l’État islamique – affichant la volonté d’étendre un jour le califat à « Rome et Byzance » avant de convertir tous les hommes –, ces rappels d’un conflit largement alimenté par le ressentiment historique pointent nos erreurs stratégiques. La guerre que nous mènent les djihadistes se nourrit d’un ressentiment longtemps accumulé et qui réunit ceux qui le partagent.
Le numéro 49 de Médium, revue dirigée par Régis Debray, pose la question de ce que signifient désormais guerre et victoire. En effet, le djihadisme avec qui nous sommes censés être en guerre semble ne pouvoir ni gagner – il n’y aura pas d’émirat futur à Washington – ni perdre – si chaque kamikaze continue à recruter des successeurs. Plus généralement, la supériorité technique ne permet plus de gagner des guerres, tant les bienveillantes interventions armées suscitent de nouvelles hostilités. Les médiologues – qui donnent aussi la parole à quelques praticiens, militaires, spécialistes du numérique, etc. – interrogent la notion de victoire militaire censée faire céder durablement une volonté historique : il faut savoir la définir et définir l’ennemi, il faut y croire, y faire croire – surtout le vaincu – et il faut gagner une bataille du temps pour l’inscrire dans la mémoire des peuples. En un peu plus d’un quart de siècle, une « évidence » – l’Occident vainqueur du communisme triomphera militairement et idéologiquement liquidant les résistances à la mondialisation démocratique – n’est plus si crédible. Au contraire, semble se confirmer une supposée incapacité des « forts » à l’emporter par les armes ; les auteurs l’attribuent dans des proportions variables à une inadaptation stratégique ou à une faiblesse morale ou idéologique – répugnance à payer le prix, incapacité de convaincre de nos valeurs –, bref à ce qui empêche d’emporter les batailles mais surtout les « cœurs et esprits ».
Cet embarras se reflète dans les façons de définir la guerre – opération, intervention, contre-insurrection, etc. –, de la qualifier – hybride, asymétrique, insurrectionnelle, de l’information, hors limites, de « x » génération, de civilisation, au terrorisme, etc. –, dans la façon de désigner l’ennemi – un dictateur, un système, une idéologie, un extrémisme / radicalisme, la barbarie, tout sauf un peuple ou une nation. La lutte contre le djihadisme a poussé à l’absurde cette impuissance de la force. Elle révèle un nouveau paradigme : plus il multiplie ses ennemis et mobilise de forces contre lui, plus le califat se renforce dans la certitude que son exemple sera contagieux et son projet spirituel renforcé. Jamais le dilemme fondamental de la guerre – persuader l’autre qu’il a perdu, faire accepter aux siens le prix de la victoire – ne s’est posé de façon aussi cruciale.
Ces essais n’apportent certes pas la recette miracle pour en finir avec le djihadisme, ni même celle d’une contre-propagande enfin adaptée à son objet, mais suggèrent quelques méthodes. Une critique du réductionnisme d’abord : penser que le djihadisme n’est « que » le sous-produit d’une société imparfaite, un problème d’acculturation manquée ou de désordres psychiques, c’est passer à côté de l’essentiel, même s’il y a toujours une base matérielle et culturelle aux phénomènes politiques. Mais réduire le djihadiste à un manque, de reconnaissance et de protection, d’information objective qui le rendrait manipulable, à une carence de figure paternelle, à une rage ou à une frustration, bref faire l’impasse sur ce qu’il pense et ce qu’il croit au prétexte que ce ne serait qu’alibi ou syndrome, c’est manquer sa cible.
Le pouvoir des symboles – domaine dans lequel Daech excelle – est relayé par des méthodes du faire croire, sur des moyens notamment numériques pour atteindre les communautés, mais aussi sur une logique doctrinale, ainsi que sur un registre d’émotions et la clôture d’un système de valeurs – logos, pathos, ethos, disait la philosophie antique. Commencer par comprendre la force de l’adversaire, sa faculté de transmettre un ressentiment collectif ou de le mobiliser au service de terrifiantes utopies, telle est la première étape d’une riposte persuasive que nos sociétés dites de communication sont encore loin de produire.
- [1] Sans entrer dans le débat « radicalisation qui s’islamise versus islamisme qui se radicalise », signalons la position paradoxale d’Alain Badiou (Notre mal vient de plus loin, Paris, Fayard, 2016), qui pousse la théorie de la religion « prétexte » jusqu’à diagnostiquer un désir d’Occident et de fascisme déguisé en théologie chez les djihadistes.
- [2] L’idée, souvent négligée, que Daech essaie de rétablir un ordre interrompu par la violence, de restaurer un califat légitime est ici cruciale. Voir à ce sujet, pour replacer dans une perspective historique, Le retour du califat de Mathieu Guidère, Paris, Gallimard, coll. « Le débat », 2016

