Décembre 2016
L’ère des « soft wars » : l’exemple Washington-Beijing / Par Barthélemy Courmont
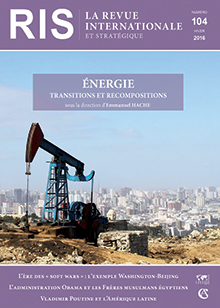 Énergie : transitions et recompositions
Énergie : transitions et recompositions
RIS N°104 – Hiver 2016
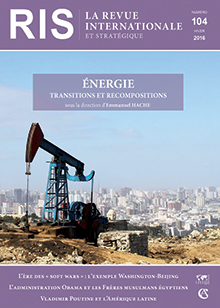
Dans les relations internationales en général et dans l’étude des conflits en particulier, les apparences sont souvent trompeuses. Ainsi, contrairement au spectacle que nous offre une actualité tumultueuse et aux idées reçues qu’elle véhicule, ne peut-on questionner le changement de nature de la notion de guerre entre grandes puissances ? Cette guerre pourrait-elle désormais marginaliser le choix des armes et se porter sur d’autres champs de bataille, propres aux stratégies de soft power ?
Les dernières années furent marquées par une recrudescence des conflits et de la violence armée impliquant à la fois États et acteurs non étatiques. De l’Est ukrainien à la Libye, en passant par les frappes contre l’État islamique sur les territoires irakien et syrien et les risques toujours présents dans la bande de Gaza, l’actualité internationale fut monopolisée par cet arc du chaos. Et les tendances sécuritaires actuelles invitent à considérer qu’il ne s’agit là peut-être que d’un début. L’Asie orientale est, à ce titre, la zone la plus sensible. Les tensions, telles que les tirs de missiles et essais nucléaires nord-coréens, les frictions en mer de Chine du Sud, ou encore la nouvelle interprétation de la Constitution pacifiste japonaise et la montée en puissance militaire de la Chine, font craindre le pire et s’ajoutent à cette liste d’inquiétudes, au point que certains en appellent, à tort ou à raison, au « dilemme de sécurité » pour décrire la course aux armements engagée en Asie [1]. Quand on sait qu’il s’agit d’un dilemme formulé au début des années 1950 par l’Allemand John Herz qui, pour mettre en garde les va-t-en-guerre à Washington et Moscou, s’efforçait de décrire les rapports de forces ayant conduit à la Première Guerre mondiale [2], il y aurait tout lieu de s’inquiéter. En l’absence d’un dialogue solide, soit sous la forme d’une bipolarité de type guerre froide, soit chapeauté par une multipolarité institutionnalisée de type Conseil de sécurité des Nations unies, les fantômes de 1914 seraient-ils de retour ?
Tandis que se poursuivent les commémorations du centenaire de la Première, nombreux sont ceux qui n’hésitent plus à mettre en garde contre la possibilité d’une Troisième Guerre mondiale, avec tous les excès et contre-sens que cela suppose [3]. Ils comparent ainsi volontiers l’Ukraine aux Sudètes, alarment sur un inquiétant retour des communautarismes ethniques et religieux sur fond de choc des cultures, et jugent inéluctable un conflit entre la Chine et le Japon, tout autant qu’un engagement des États-Unis en soutien de son principal allié asiatique, mais aussi aux Philippines ou au Viêtnam. Bref, l’histoire serait en train de se répéter. Pourtant, et à l’inverse, de nombreux signes montrent clairement qu’une nouvelle forme de confrontation entre grandes puissances est en train d’émerger, et pourrait très rapidement s’imposer comme la norme dans les nouveaux équilibres internationaux. La relation entre Washington et Beijing est révélatrice de cette nouvelle tendance.
La guerre a un bel avenir, à condition d’être en phase avec son temps
Même s’il est exagéré de parler de « choc des civilisations » [4], les conflits actuels rappellent une fois de plus que l’angélisme qui a suivi la fin de la guerre froide et les thèses sur la « fin de l’Histoire » et le « nouvel ordre mondial » étaient exagérés, voire déplacés [5]. De la même manière, les chantres de la globalisation et du libéralisme économique comme ultime réponse aux conflits se sont visiblement trompés sur toute la ligne, tant la mondialisation semble justement être à l’origine de nouvelles lignes de fracture et de confrontations armées. Enfin, d’aucuns voyaient dans la retraite de l’État la possibilité d’une diminution des risques de guerre. Or, non seulement l’État comme acteur central des relations stratégiques n’a pas disparu, mais surtout son absence se caractérise par des manifestations de violence, les conséquences du « printemps arabe » en étant sans doute l’exemple le plus manifeste. Résumant cette réalité, Henri Bentegeat note que « la perte de souveraineté des nations n’est pas compensée par une réelle montée en puissance de la gouvernance mondiale » [6]. En clair, la guerre n’a pas disparu ou, plus exactement, les guerres font encore et toujours partie de notre actualité. Elles se sont transformées, pour reprendre les mots de l’historien israélien Martin van Creveld [7], mais cette transformation ne s’est pas traduite par leur diminution. Au contraire, la guerre aurait même un bel avenir [8]. Des prophéties que la recrudescence des conflits asymétriques – pour ne pas dire « transformés » – et la résilience de la guerre réaliseraient.
Cette résistance des conflits armés en ce début de XXIe siècle ne saurait cependant masquer une évolution profonde de la définition de la guerre. Parallèlement à des conflits de basse intensité et des guerres asymétriques qui subsistent et se sont même dans une certaine mesure renforcés depuis deux décennies, les oppositions entre grandes puissances ont progressivement mais irrésistiblement glissé vers de nouveaux terrains. De fait, n’en déplaise à ceux qui voient dans la rivalité Russie-Occident, et plus encore dans le bras de fer Washington-Beijing ou les tensions Chine-Japon, les signes avant-coureurs d’une nouvelle guerre froide et pourquoi pas d’un troisième conflit mondial, les confrontations entre grandes puissances marginalisent désormais de plus en plus le langage des armes, au détriment de l’économie, de la diplomatie et, surtout, de la capacité d’influence. Moins médiatisé que les thèses de Francis Fukuyama et de Samuel Huntington, dont il est pourtant contemporain, un livre de John Mueller publié en 1989 annonçait déjà la fin de la guerre entre les puissances, arguant de leur coût prohibitif, de l’accent mis sur les capacités économiques plutôt que militaires, et du rejet progressif des valeurs guerrières dites traditionnelles [9]. L’intérêt de la thèse de J. Mueller est qu’elle pose la question d’un rapport de la guerre à son temps, et donc d’une adaptation des moyens à disposition des États et des acteurs non étatiques – même si cette deuxième catégorie est moins traitée. La guerre pourrait ainsi ne pas seulement se contenter d’une transformation, mais changer de nature, au point d’apparaître dénaturée, et se réinventerait sur la base des attributs contemporains de la puissance, au premier rang desquels celui que Joseph Nye identifie comme le plus important : le soft power ou capacité d’influence, qui se caractérise tout simplement par la possibilité offerte à A de convaincre B de faire ce qu’il n’avait pas nécessairement l’intention de faire [10].
La réinvention de la guerre
Dans le cas de la compétition Chine-États-Unis, la vision développée par Robert Gilpin selon laquelle la solution la plus courante de tout temps pour inverser les déséquilibres entre puissances est la guerre, et même ce qu’il qualifie de « guerre hégémonique », domine encore les perceptions trois décennies après sa publication [11]. Or, comme tous les indicateurs annoncent que la Chine deviendra la première puissance mondiale – et donc en position, si elle le souhaite, d’exercer son hégémonie – d’ici quelques décennies, la guerre serait de fait inévitable. Il s’agit d’ailleurs d’une hypothèse à laquelle souscrivent des experts américains, généralement associés aux thèses réalistes, en vertu du principe défini par Hans Morgenthau selon lequel « la politique internationale, comme toute politique, est un combat pour la puissance » [12]. Les réalistes chinois n’en pensent pas moins : Ye Zicheng estime ainsi que « les États-Unis n’autoriseront pas la Chine à accéder au rang de superpuissance. En conséquence, la puissance émergente de la Chine conduira inévitablement à une confrontation à grande échelle avec les États-Unis » [13].
On peut cependant ne pas souscrire au déterminisme d’une guerre non seulement inéluctable, mais également proche si l’on tient compte de la rapidité avec laquelle la Chine monte en puissance. Dans son célèbre Paix et guerre entre les nations, tout en critiquant au passage l’approche à son sens trop limitée des relations internationales offerte par les auteurs réalistes – en particulier américains –, Raymond Aron distingue des systèmes dits homogènes et hétérogènes, expliquant que les premiers sont « ceux dans lesquels les États appartiennent au même type, obéissent à la même conception du politique. [Il] appelle hétérogènes, au contraire, les systèmes dans lesquels les États sont organisés selon des principes autres et se réclament de valeurs contradictoires » [14]. Voilà une parfaite définition d’une multipolarité dans laquelle la Chine aurait une place centrale, et voilà une caractérisation encore plus exacte d’un système dans lequel les États-Unis et la Chine rivaliseraient tout en cohabitant.
De fait, parce qu’elle est plus complexe que toutes les relations qui ont concerné les grandes puissances par le passé, parce qu’elle est à la fois d’une grande proximité et emprunte d’une méfiance réciproque qui invite nécessairement à la prudence à Beijing comme à Washington, parce que les deux pays sont à la fois si différents et si semblables, parce qu’elle est parfois d’une grande violence mais évitera tant que possible de dégénérer en conflit armé, la relation entre les États-Unis et la Chine est une guerre pacifique, qui impose de nouvelles grilles de réflexion [15]. Elle impose aussi et surtout de nouveaux comportements qui, s’ils cohabitent avec les anciens modes de pensée pour la plupart issus de la guerre froide, seront amenés à les remplacer. Les signes de cette nouvelle forme de confrontation ne manquent pas, et révèlent à quel point la rivalité entre les deux pays est à la fois plus large que leur compétition stratégique, et voit dans le même temps les risques d’affrontements armés se limiter à de la rhétorique.
Guerres à coup – et à coût – de soft power
Les récentes critiques de l’Association américaine des professeurs d’université à l’égard des Instituts Confucius, véritables fers de lance de la stratégie de soft power de la Chine depuis une dizaine d’années et actuellement présents dans plus de 120 pays, sont assez inhabituelles et à la fois symptomatiques d’une nouvelle forme de confrontation. En comparaison, il faut imaginer ces mêmes universitaires américains appelant au boycott des Alliances françaises ou des Instituts Goethe. Ces critiques sont aussi et surtout révélatrices de ce que sont devenus les rapports de forces entre grandes puissances. Les universitaires américains reprochent à leurs homologues chinois une promotion tous azimuts de leur culture – ce qui est effectivement le cas, mais promouvoir signifie-t-il menacer ? – et cherchent de manière assez explicite à en limiter la portée, en invitant les structures d’accueil à cesser toute coopération. Une position qui semble faire écho aux critiques de l’occidentalisation de la Chine formulées de manière répétée et tout aussi explicite par les dirigeants chinois, inspirés sur ce sujet par des mouvements ultranationalistes ouvertement hostiles à l’Occident et dont certains travaux aux accents populistes ont connu un grand succès populaire dans le pays [16]. Une position qui rappelle également à quel point les deux pays sont engagés dans une rivalité que l’on retrouve sur les questions du commerce extérieur, de la finance, de la délocalisation, de la dette, de l’emploi, et donc de manière presque naturelle sur les questions culturelles.
Deux exemples illustrent l’importance de ces nouveaux facteurs au niveau politique. Lors de la campagne présidentielle américaine de 2012, qui opposa Barack Obama à Mitt Romney, la Chine fut omniprésente et, d’une certaine manière, accusée de tous les maux dont souffrent les États-Unis, par les républicains comme par les démocrates. Les deux adversaires ne désignèrent cependant jamais Beijing comme un adversaire stratégique – à l’inverse de la Russie, que M. Romney a même cité comme le principal rival de Washington [17]. Les références à la Chine furent en revanche incessantes, particulièrement sur les questions économiques. Côté chinois, on relève la même obsession quand le Parti communiste attend le résultat des élections américaines pour lancer son Congrès en novembre 2012, ou quand les dirigeants s’engagent dans des critiques acerbes de ce qu’ils qualifient d’« occidentalisation » – pour ne pas dire « américanisation » – de la Chine. Ajoutons à cela les accusations de part et d’autre sur les manipulations monétaires, les différends à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et une rivalité qui se traduit par de multiples luttes d’influence en Asie du Sud-Est, en Afrique ou en Amérique latine.
La Chine consacre une énergie phénoménale à sa stratégie de soft power, avec des résultats assez mitigés dans les pays occidentaux, mais plus notables dans d’autres régions, où ses investissements ont connu une croissance très nette – la Chine est ainsi aujourd’hui le premier investisseur sur le continent africain et en Asie du Sud-Est –, où le nombre d’Instituts Confucius a augmenté très rapidement et où son image est majoritairement positive. On relève ainsi un décalage très net entre la perception de la Chine dans les pays occidentaux et dans le reste du monde. De son côté, Washington s’est lancée, sous l’administration Obama, dans un vaste chantier visant à restaurer l’image des États-Unis dans le monde et à pratiquer ce qui est caractérisé comme smart power, concept assez mal défini qui s’apparente au final à une forme plus agressive de soft power – un peu à la manière de ce que pratique Beijing [18]. Chine et États-Unis ne sont pas des exemples singuliers en matière de course au soft power, qui prolifère à grande vitesse en Asie orientale, rassure ceux qui s’inquiètent de l’attractivité de l’Europe et s’impose de plus en plus dans les cercles stratégiques des autres pays. Certes, la Chine voit son budget de défense augmenter de manière constante, mais l’énergie qu’elle déploie pour tenter de séduire est nettement supérieure, et son cas est tout sauf isolé.
À ce constat s’en ajoute un autre, peut-être plus significatif : la Chine n’est encore, pour reprendre les propos de David Shambaugh, qu’une « puissance partielle » [19], ce qui ne signifie pas nécessairement qu’elle le sera un jour complètement. Mais l’est-elle par défaut ou par choix ? La réponse peut être double. La Chine a la volonté de redevenir une superpuissance et de refermer une parenthèse douloureuse de son histoire, mais se heurte à des limites propres à son régime – une image plutôt négative, en particulier en Occident, des problèmes de corruption que les réformes en cours ne résolvent qu’à moitié, etc. –, au point que cette désignation de « puissance partielle » lui sied plutôt bien. Dans le même temps, les dirigeants chinois savent que la superpuissance vient avec des responsabilités, des obligations, mais a aussi un coût. Derrière des slogans comme le « rêve chinois » et des discours sur l’engagement de la Chine sur la scène internationale, la réalité présente un tout autre visage, et voit plutôt Beijing choisir les situations dans lesquelles elle se montre active et engagée. Éviter de s’exposer et donc de se mettre en première ligne, voilà une recommandation de Deng Xiaoping qui, vingt ans après, impose encore sa griffe sur la politique étrangère chinoise.
Les États-Unis sont, pour leur part, de moins en moins en mesure d’assurer un rôle de leader planétaire et connaissent un effacement que certains qualifient de lent déclin, d’autres d’évolution inéluctable des rapports de forces internationaux. Les pays européens sont dans une situation comparable. En face, les puissances « émergentes » sont confrontées à des défis politiques et sociaux qui se maintiendront, voire pour certains se renforceront. Aussi serait-il précipité de considérer qu’elles remplaceront l’Occident sur le devant de la scène. On pourrait même se demander si l’avenir ne se caractérisera pas par l’absence de superpuissance. S’y superposeraient alors des puissances plus ou moins dominantes dans différents secteurs, tantôt contraintes à la coopération, tantôt rivalisant, des puissances partielles en somme. Les relations internationales seraient ainsi organisées autour d’un G0, pour reprendre l’idée initiée par Ian Bremmer [20], sans véritable leader. Un tel environnement apolaire ne se caractériserait pas par un retour aux rivalités entre puissances du siècle dernier, mais plutôt par des confrontations ciblées dans des domaines précis, dans lesquelles les stratégies de soft power seraient nettement plus efficaces que les arsenaux militaires. Et si ce temps s’écrivait déjà au présent ?
Le temps des soft wars
Ces confrontations dans lesquelles le poids des économies, la diplomatie publique et les stratégies d’influence sont plus importantes que les effectifs militaires peuvent être qualifiées de guerres douces – soft wars – en référence à la puissance douce – soft power – initiée par Joseph Nye. Si de nombreux acteurs, étatiques ou non, en sont encore à des postures de défense traditionnelles – de Daech à la Corée du Nord, en passant par la Russie –, mettant en avant des capacités militaires et des stratégies coercitives, les grandes puissances s’éloignent de ces méthodes de hard power. Washington et Beijing en sont les principaux acteurs, et leurs différends éclatent au grand jour sur quasiment tous les sujets, à l’exception notable des stratégies militaires, où les deux pays n’ont ni l’intérêt ni la volonté de durcir leurs positions. En juillet 2014, la Chine fut même invitée par les États-Unis, pour la première fois en plus de quarante ans, à participer aux gigantesques manœuvres militaires dans l’océan Pacifique (Rim Pac), événement qui fut certes moins médiatisé que le petit accrochage – ou presque – entre deux avions militaires américain et chinois au large de Hainan en août suivant. Le bras de fer entre les deux pays n’est ainsi en rien comparable à ce que fut, par exemple, la guerre froide. Il est à la fois moins frontal – pas de plans stratégiques officiellement dirigés l’un contre l’autre – et considérablement plus large, intégrant une multitude de terrains d’affrontement. D’une certaine manière, comme la guerre au sens classique aurait des conséquences dévastatrices, les deux choisissent d’autres champs de bataille.
Si cette guerre douce marginalise l’importance des forces armées, elle n’en perd pas nécessairement en intensité, au contraire. À Beijing, les critiques du consensus de Washington sont, comme celles des Instituts Confucius, d’une rare violence, ce qui incite de nombreux observateurs à prédire l’avènement d’un « consensus de Beijing » [21]. Pour paraphraser en l’inversant Carl von Clausewitz, il s’agit d’une continuation de la guerre par d’autres moyens, la guerre au sens propre du terme devenant de plus en plus improbable. Cette nouvelle manière de concevoir les rivalités entre grandes puissances n’élimine toutefois pas totalement les risques de confrontation armée. En témoignent les innombrables rapports du Pentagone sur la montée en puissance militaire de la Chine et la réalité de budgets de défense en forte hausse depuis une quinzaine d’années. Le temps des soft wars doit également s’accommoder de comportements et de postures de dirigeants qui s’adaptent parfois difficilement aux nouvelles réalités, et continuent de miser sur la force militaire en pensant qu’elle reste l’ultime attribut de la puissance ou le meilleur garant de la sécurité. Et il ne faut pas oublier que si la possibilité d’une guerre entre les deux pays semble excessive compte tenu de ses conséquences et de son caractère contre-productif, les escalades portent toujours en elles des facteurs irrationnels qui éclipsent et parfois écartent la raison, au point de dégénérer bien au-delà de toutes les prévisions. En clair, pour que la « guerre » demeure « pacifique », la vigilance reste de mise et chacun des deux acteurs doit faire preuve de bon sens et de retenue en toutes circonstances. En attendant, on ne changera pas les vieilles perceptions du jour au lendemain, et les forces armées restent un outil indispensable, notamment pour faire face aux acteurs moins puissants. Si la guerre entre grandes puissances pourrait appartenir au passé, les guerres asymétriques ont ainsi un bel avenir devant elles.
La relation Washington-Beijing est à la fois la plus déterminante et la meilleure illustration des préceptes de ces soft wars, mais ne saurait en revendiquer l’exclusivité. La guerre n’est pas une fatalité, encore moins une situation qui s’imposerait aux différents acteurs concernés sans que ces derniers n’aient le moindre contrôle sur sa conduite autant que sur les conditions préalables à son déclenchement. En d’autres termes, ce sont des acteurs – le plus souvent étatiques, mais l’on peut également imaginer des scénarios dans lesquels des groupes non étatiques prennent le relais – qui provoquent la guerre et décident de briser un statu quo qu’ils jugent inapproprié ou inadapté aux réalités du moment, ou plus simplement encore qu’ils perçoivent comme allant à l’encontre de leur intérêt national. La guerre devient une réalité quand au moins un acteur, manifestant son souhait d’en découdre militairement, la provoque. Dans ce registre, les postures continuent de s’appuyer sur un discours de fermeté, voire d’intransigeance, mais les conditions justifiant que de grandes puissances aient recours à la force armée pour s’affronter sont de plus en plus difficiles à réunir. Ajoutons à cela une interdépendance, souvent évoquée dans le cas de la relation Washington-Beijing, mais non moins évidente si l’on regarde de près les rapports entre d’autres grandes puissances pourtant fréquemment qualifiées de rivales et supposément au seuil de la guerre, comme la Chine et le Japon. De plus en plus fréquemment montrés du doigt pour leurs postures guerrières, ces deux pays n’en demeurent pas moins très étroitement associés économiquement, notamment dans le cadre de négociations sur la mise en place d’un accord de libre-échange. Beijing et Tokyo se livrent une lutte d’influence, de leadership en Asie, dans laquelle l’importance accordée aux forces armées semble relever de la rhétorique nationaliste plus que d’une véritable ambition stratégique. Sans doute est-il normal que ces deux puissances se montrent méfiantes l’une de l’autre, le poids du passé étant toujours très présent. Mais sans doute aussi est-il très excessif, voire déplacé, de considérer qu’elles sont au seuil de la guerre, surtout si l’on estime que cette dernière serait déclenchée par un différend de longue date sur des îles Senkaku / Diaoyu qui, à défaut d’agiter les milieux nationalistes chinois et japonais, ne justifie rationnellement pas un conflit à grande échelle.
La rationalité, voilà la piqûre de rappel que doivent constamment s’administrer les dirigeants des grandes puissances afin d’éviter des escalades inconsidérées ou des incidents qui dégénèrent en accidents. Dans les perceptions et les comportements entre grandes puissances, les mécanismes d’un autre âge et les vieux fantasmes ne disparaîtront probablement jamais complètement. Et certains seront toujours tentés, pour des raisons de politique intérieure ou de prestige, de les agiter. Mais ils ne suffisent plus à eux seuls à caractériser les relations entre grandes puissances rivales, qui associent désormais interdépendance et extension du domaine de leurs luttes. Des puissances structurelles dont la force de frappe ne se compte pas en nombre de blindés et d’avions de chasse, mais en capacité d’influence et de persuasion.
- [1] Notons au passage que cette idée ne date pas d’hier, et semble même revenir de manière fréquente pour annoncer un conflit imminent en Asie orientale à l’occasion d’une reprise des tensions. Lire par exemple Thomas J. Christensen, « China, the U.S.-Japan Alliance, and the Security Dilemma in East Asia », International Security, vol. 23, n° 4, printemps 1999.
- [2] Parmi les travaux significatifs et fondateurs, lire John H. Herz, « Idealist Internationalism and the Security Dilemma », World Politics vol. 2, n° 2, 1950 ; et John H. Herz, Political Realism and Political Idealism, Chicago, Chicago University Press, 1951. Dans un climat de guerre froide, plusieurs experts se sont inspirés des travaux de J. H. Herz et interrogés sur les contours de la coopération, et donc du rétablissement du dialogue, pour réduire les risques liés au dilemme de sécurité. Lire notamment Robert Jervis, « Cooperation under the Security Dilemma », World Politics, vol. 30, n° 2, janvier 1978.
- [3] La fiction s’est même emparée de cette question, très présente dans les débats géopolitiques. Lire Boualem Sansal, 2084. La fin du monde, Paris, Gallimard, 2015.
- [4] Samuel P. Huntington, « The Clash of Civilizations ? », Foreign Affairs, vol. 72, n° 3, été 1993 ; The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York, Simon & Schuster, 1996.
- [5] Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, New York, Free Press, 1992. Lire également Richard Rosecrance, « A New Concert of Powers », Foreign Affairs, printemps 1992. Sur la multiplication des conflits de basse intensité opposant des acteurs étatiques et / ou non étatiques après la fin de la guerre froide, lire Bertrand Badie et Marie-Claude Smouts, Le retournement du monde. Sociologie des relations internationales, 3e édition, Paris, Presses de Sciences Po – Dalloz, 1999.
- [6] Henri Bentegeat, « L’avenir de la guerre », Esprit, n° 407, août-septembre 2014, p. 87.
- [7] Martin van Creveld, The Transformation of War, New York, Free Press, 1991.
- [8] Philippe Delmas, Le bel avenir de la guerre, Paris, Gallimard, 1995.
- [9] John Mueller, Retreat from Doomsday. The Obsolescence of Major War, New York, Basic Books, 1989.
- [10] Joseph S. Nye, The Future of Power, New York, Public Affairs, 2011.
- [11] Robert Gilpin, War and Change in International Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
- [12] Hans J. Morgenthau, Politics among Nations, New York, Knopf, 1948, p. 13.
- [13] Ye Zicheng, Inside China’s Grand Strategy : The Perspective from the People’s Republic, Lexington, The University Press of Kentucky, 2010, p. 93.
- [14] Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962, p. 136.
- [15] Lire Barthélémy Courmont, Une guerre pacifique. La confrontation Washington-Pékin, Paris, ESKA, 2014.
- [16] Le plus connu de ces ouvrages est celui de Song Qiang, Huang Jisu, Song Xiaojun, Wang Xiaodong et Liu Yang, La Chine n’est pas contente, publié en 2009 et qui s’est vendu à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires.
- [17] Si M. Romney fut à l’époque la cible des railleries des médias américains, les événements internationaux depuis sa défaite et le regain de tension avec la Russie semblent, sans doute de manière involontaire, lui donner raison.
- [18] Plusieurs experts, dont J. Nye, se sont penchés sur le smart power. Pour les origines du concept, lire Suzanne Nossel, « Smart Power », Foreign Affairs, vol. 83, n° 2, mars-avril 2004.
- [19] David Shambaugh, China Goes Global. The Partial Power, New York, Oxford University Press, 2013.
- [20] Ian Bremmer, Every Nation for Itself. Winners and Losers in a G-Zero World, Londres, Portfolio, 2012.
- [21] Voir Joshua Cooper Ramo, The Beijing Consensus, Londres, Foreign Policy Centre, 2004 ; Martin Jacques, When China Rules the World : The Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World, Londres, Penguin, 2010 ; Stefan Halper, The Beijing Consensus. How China’s Authoritarian Model Will Dominate the 21st Century, New York, Basic Books, 2010 ; et Nancy Birdsall et Francis Fukuyama, « The Post-Washington Consensus », Foreign Affairs, vol. 90, n° 2, mars-avril 2011.

