Septembre 2016
Le Mexique est-il un pays émergent ? / Par Jean-Jacques Kourliandsky
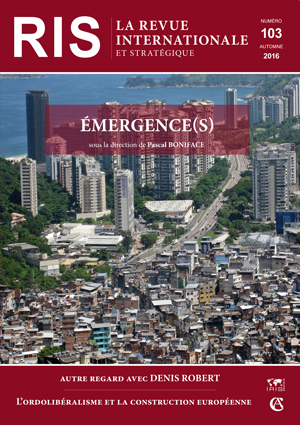 Émergence(s)
Émergence(s)
RIS N°103 – Automne 2016
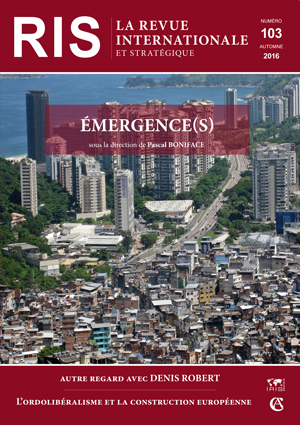
Le Mexique est-il un pays émergent ? Si tel était le cas, quelle serait la portée de cette émergence supposée ? Aurait-elle le même sens et le même périmètre que celle d’autres acteurs internationaux communément qualifiés d’émergents, à savoir l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde, la Russie ? Sans doute faudrait-il, pour avoir la possibilité sinon de répondre ou de penser comparativement, être en possession d’un « mètre étalon » universellement admis de l’émergence, ce qui n’est pas le cas.
Le périmètre des émergents est en effet relatif au chercheur, à l’analyste, au journaliste. Il est fonction de sa nationalité, de son domaine de recherche et / ou d’intérêt. Les acteurs les plus divers de la vie internationale – gouvernements, grandes entreprises transnationales et leurs organismes de conseil – en ont une compréhension différente [1]. L’émergence est-elle, par exemple, un espace national en phase de croissance accélérée et attractif pour les investisseurs occidentaux et japonais ? Ou est-elle source potentielle d’autonomie extérieure, comme le définissent les gouvernants des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ?
La définition de l’émergence ici privilégiée à propos du Mexique repose sur son interprétation la plus littérale possible. Le Mexique a-t-il, ces dernières années, émergé économiquement et politiquement au point d’être davantage en mesure de faire valoir ses intérêts, que ceux-ci soient matériels et commerciaux, diplomatiques ou culturels ? L’émergence sera donc appréciée en fonction d’une montée en puissance collective et nationale, renforçant les solidarités internes et réduisant de façon tangible les dépendances extérieures de toutes sortes.
Le pari de l’émergence dans la mondialisation
La mémoire du Mexique est historiquement marquée par la Révolution de 1910 et un farouche nationalisme, que perpétue le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) depuis les années 1920. À l’exception de la période 2000-2012, tous les présidents ont ainsi porté ses couleurs et son discours. Le PRI a toutefois mué idéologiquement dans les années 1980-1990, le président Carlos Salinas de Gortari faisant le pari de l’ouverture économique et commerciale.
Le régionalisme ouvert est alors devenu la ligne de conduite du Mexique. Selon les acteurs de ce changement d’orientation politique, économique et diplomatique, la meilleure façon de préserver l’intégrité nationale était de mettre en concurrence les États bénéficiaires de la fin du monde bipolaire. Un Accord de libre-échange nord-américain (Alena) a été signé avec le Canada et les États-Unis en 1994, suivi d’un autre partenariat avec l’Union européenne (UE). Le Mexique a également accédé à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 1994. D’autres traités ont, en outre, été négociés et signés avec plusieurs pays asiatiques.
Le retour du PRI au pouvoir en 2012 a été marqué par une accentuation de cet effort. Le Mexique a pris l’initiative, avec la Colombie, le Pérou et le Chili, de créer une entente de pays latino-américains partisans du régionalisme ouvert, l’Alliance du Pacifique. Celle-ci a permis d’élargir l’horizon de la coopération régionale d’origine mexicaine qui concernait jusque-là l’étranger proche, à savoir l’Amérique centrale, la République dominicaine et la Colombie, avec notamment le mécanisme de Tuxtla (1991), le Plan Puebla Panama (2004) et le Projet d’intégration et de développement de la Mésoamérique (2008). Le Mexique a également rejoint la Communauté d’États latino-américains et caribéens (Celac) afin de défendre le bien-fondé de son pari extérieur et d’en étendre la portée. Le 25 septembre 2013, il a aussi posé les bases d’une nouvelle internationale de pays émergents, parallèle aux BRICS, le groupe MIKTA (Mexique, Indonésie, Corée du Sud, Turquie, Australie), ces pays ayant décidé de conjuguer leurs économies afin d’en mutualiser l’impact international.
Longtemps hostile à toute participation aux opérations de paix de l’Organisation des États américains (OEA) comme de l’Organisation des Nations unies (ONU), le Mexique est entré dans une phase de réflexion et de révision prudente. En 2001 encore, conformément à une conception étroitement défensive de la souveraineté nationale, héritage d’ingérences répétées de la part du voisin nord-américain, il envisageait de proposer la dissolution du Bureau interaméricain de défense, organisme dépendant de l’OEA. En 2003, il a, en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, refusé de légitimer l’intervention militaire des États-Unis en Irak. Le pays était alors présidé par Vicente Fox, membre du Parti d’action nationale (PAN) et par ailleurs ancien président de Coca-Cola pour le Mexique.
Le 24 septembre 2014, le président Enrique Peña Nieto déclare devant la 69e Assemblée générale de l’ONU que son pays a décidé de participer aux opérations de maintien de la paix de l’organisation. Échaudé par l’ingérence séculaire du voisin américain, le Mexique avait en quelque sorte « sanctuarisé » cette réserve diplomatique [2]. À ce titre, il avait, dans les années 1960, refusé de rompre avec Cuba, comme le souhaitaient les États-Unis. De façon révélatrice l’étude et l’enseignement des relations internationales ont fait leur entrée dans le cursus des formations universitaires [3]. Créé en 1974, l’Institut Matías Romero d’études diplomatiques a accompagné cette montée en puissance extérieure. Il s’est ouvert au monde en publiant une revue de qualité et en mettant en place des cycles de formation en direction d’un public diplomatique étranger. Il organise également des expositions illustratives des choix extérieurs du Mexique.
Les retombées positives du pari d’une émergence globale
Ces choix ont-ils bonifié la place du Mexique dans le monde ? L’élection d’un président à nouveau issu du PRI en 2012, Enrique Peña Nieto, après deux mandatures du PAN, avait été placée sous le signe de l’émergence du pays. E. Peña Nieto avait ainsi revendiqué pendant sa campagne électorale un « Mexique, acteur global ». « Le “M” du Mexique a été oublié par les BRICS », écrivait-il dans son livre-programme [4].
L’espace d’influence du Mexique s’est incontestablement élargi. Le pays a été admis dans le cercle réduit des pays membres du directoire de l’économie mondiale, le G20, dont il a accueilli le sommet en 2012. L’un des siens, José Ángel Gurria, a même accédé au secrétariat général de l’OCDE. Usant des réseaux constitués par son pays, il a fait adhérer le Chili et obtenu que soit reconnu un droit d’adhésion à la Colombie et au Pérou. À son initiative, l’organisation publie également tous les ans, un état des lieux économique de l’Amérique latine. En outre, le basculement électoral de l’Argentine en 2015 et les crises économiques et institutionnelles brésilienne et vénézuélienne de 2015 et 2016 ont affaibli les ensembles diplomatiques d’Amérique du Sud, valorisant les préférences commerciales régionales. Le Mexique, qui avait fait le pari du panaméricanisme et du régionalisme ouvert, en a tiré bénéfice, alors que 49 pays sont aujourd’hui membres observateurs de l’Alliance du Pacifique.
Sa participation à de telles institutions intergouvernementales lui a également permis d’étendre le réseau de ses partenariats. Grâce à une mutualisation des moyens au sein de l’Alliance du Pacifique, son influence diplomatique couvre un espace plus universel. L’ambassade du Mexique au Ghana est ainsi partagée avec le Chili, la Colombie et le Pérou. Sa participation aux opérations de paix lui a, en outre, permis de se rapprocher de l’Espagne et de la Finlande, alors que ses soldats ont également suivi des formations dans une dizaine de pays. Cette montée en influence n’est pas passée inaperçue à Moscou, au point que le Conseil russe des affaires internationales a jugé bon de produire, en 2015, un rapport concluant à la nécessité de renforcer les relations avec un pays qui « a accru sa présence internationale en cherchant à diversifier ses partenariats ». « Il est temps, ajoutent les auteurs de ce document, de réviser les stéréotypes présentant le Mexique comme étant l’arrière-cour des États-Unis […], terre interdite à la Russie » [5].
D’un point de vue économique, le pays a connu une croissance notable. Le Mexique est bon an mal an dans le groupe des puissances situées entre le dixième et le vingtième rang mondial. Il est la deuxième économie d’Amérique latine, derrière le Brésil, mais la première puissance exportatrice. État essentiellement pétrolier, le Mexique a réussi à diversifier ses revenus : aéronautique, automobile, chimie et pharmacie occupent une place aujourd’hui majeure dans son économie. Plusieurs entreprises mexicaines transnationales ont ainsi émergé. Parmi les 50 premières latino-américaines, 10 étaient mexicaines en 2013. Elles investissent aussi à l’étranger, selon une logique « translatine ». En Espagne, leur principal point de chute européen, les investissements mexicains, stimulés par la crise que connaît le pays depuis 2008, ont suscité une certaine préoccupation [6]. Reste qu’ils se sont accrus de 273 % en 2013, au point que 20 % des investissements latino-américains en Espagne proviennent désormais du Mexique [7].
Les limites de l’émergence globale
Malgré tout, l’écart entre ambitions et résultats demeure important, tant dans la diplomatie que dans l’économie et la consolidation de l’État. En matière de rayonnement ou, plus modestement, d’influence régionale, les initiatives les plus importantes ont été, entre 2003 et 2012, portées par les gouvernements nationalistes et progressistes. L’Alliance des peuples de notre Amérique (Alba), l’Union des nations d’Amérique du Sud (Unasur / Unasul) et les ponts ouverts par ces organisations interaméricaines en direction de l’Afrique et du monde arabe ont relativement isolé le Mexique. Et les gouvernements d’Amérique du Sud ont pénétré l’espace traditionnel d’influence mexicaine dans la Caraïbe et en Amérique centrale.
La modeste participation du Mexique aux opérations de maintien de la paix ne lui a pas permis de prétendre à un rôle d’entraînement dans la région. En 2004, c’est en effet le Brésil qui a pris le commandement de la première opération de paix confiée à un pays latino-américain, la Mission des nations unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah). En 2016, le Mexique ne dispose d’ailleurs que de 12 casques bleus, loin derrière l’Uruguay (1 472), le Brésil (1 303), le Chili (425) ou encore l’Argentine (338). En outre, il a été observateur plus qu’acteur de la réconciliation de Cuba avec les États-Unis, alors qu’il avait été pendant la guerre froide le seul pays latino-américain à préserver des relations normales avec La Havane.
En tant que membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), l’Équateur et, surtout, le Venezuela ont pesé jusqu’en 2012-2013 sur l’évolution des prix du baril, stratégique pour le Mexique, producteur important qui n’a pourtant jamais adhéré à cette organisation en raison de sa proximité avec les États-Unis. Le Venezuela avait quelques années plus tôt, en 2006, rompu le lien diplomatique et énergétique le liant à la Colombie et au Mexique au sein de l’accord de libre-échange G3. Le Nicaragua et le Salvador ont, pour leur part, renforcé leurs relations avec le Brésil et le Venezuela, au détriment de Mexico. Médiateur reconnu de la paix au Salvador, le Mexique n’a pas été représenté de façon significative, en 2012, au vingtième anniversaire des accords de paix, pas plus qu’il n’a joué un quelconque rôle dans la négociation de la fin du conflit entre Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et autorités.
La relation avec le voisin du Nord a, quant à elle, gardé son caractère asymétrique. Le Mexique est resté en retrait, aligné sur les positions des États-Unis sur les grands dossiers de politique internationale. À la différence de la plupart de ses voisins du Sud, il n’a pas voté, en 2011, l’admission de la Palestine comme membre à part entière de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). Il n’a pas davantage réussi à convaincre le président Obama d’aller au-delà d’une déclaration symbolique reconnaissant, il est vrai pour la première fois, la coresponsabilité des États-Unis dans le trafic des stupéfiants et la violence au Mexique. Et si les critiques xénophobes lancées pendant la campagne à la primaire républicaine par le candidat Donald Trump sont caricaturales, elles sont aussi révélatrices de la nature du rapport inégal que les efforts de diversification diplomatique ne sont pas parvenus à rééquilibrer. De façon plus générale, la conjoncture mexicaine est restée dépendante de celle de son grand voisin du Nord. Les États-Unis sont toujours le premier partenaire commercial, le premier investisseur et le premier pourvoyeur de touristes du Mexique. Le pays se trouve de fait intégré dans un espace économique dont les clés se trouvent hors de portée de son contrôle souverain. Cette réalité impose, par ailleurs, ses cycles de croissance ou de repli à l’économie mexicaine, qui vit au rythme des oscillations l’économie américaine.
Par ailleurs, les ambitieuses réformes engagées par le chef de l’État élu en 2012, Enrique Peña Nieto, n’ont pas apporté de retombées rompant significativement et qualitativement avec le passé récent. La convergence des économies et le rattrapage entre les niveaux de développement, fondement de l’émergence économique selon les experts des pays du Nord, n’ont pas eu lieu. La croissance, bien que positive, est restée modérée, et les évolutions constatées vers une diversification des ressources ne concernent que des pôles de développement très localisés : Monterrey, Querétaro et la capitale, Mexico. Ce développement n’a pas permis d’élargir la capacité de décision autonome du pays, objectif de l’émergence vue du « Sud ». Les efforts visant à diversifier les dépendances n’ont pas apporté les dividendes attendus. Ils ont même parfois, comme avec la Chine, tourné à l’aigre : la dénonciation, le 14 juillet 2014, de l’appel d’offres gagné par China Railway Construction en vue d’équiper de trains à grande vitesse chinois la ligne Mexico-Querétaro a, par exemple, sensiblement altéré les perspectives de coopération économique et commerciale entre les deux pays.
L’industrie pétrolière, dont la production devait être stimulée par l’ouverture de son exploitation aux capitaux étrangers, a vu les perspectives attendues d’investissements contraintes par la chute brutale des cours. Ce pari, provisoirement perdu, a révélé une autre forme de dépendance économique extérieure, celle à l’égard du prix du baril, déterminé par les États-Unis et l’Arabie saoudite.
Le Mexique n’est également pas parvenu à faire glisser les catégories sociales les plus pauvres vers les classes moyennes. Les inégalités n’ont pas été significativement réduites. Une part importante de ces catégories sociales continue ainsi de chercher aux États-Unis un mieux vivre et du travail, ce qui, avec l’effet remesa (envoi d’argent au pays par les migrants), perpétue une forme supplémentaire de dépendance.
L’État mexicain, pendant longtemps « dictature parfaite » selon la formule de Mario Vargas Llosa, s’est paradoxalement défait avec la fin de la fraude électorale et l’alternance au sommet du pouvoir. La corruption et le crime organisé étaient jusque-là contenus par des compromis inavoués et étroitement contrôlés au plus haut niveau. La destruction de l’édifice a généré un désordre social et des violences accentuées par la montée en puissance d’une économie illicite reposant sur les stupéfiants.
Enrique Peña Nieto, dans l’ouvrage-programme précédemment mentionné, affichait la nécessité première de « construire un État efficace ». On est, en 2016, très loin du compte et ce, en dépit de multiples tentatives de réformes négociées avec l’ensemble des partis politiques représentés au Parlement. Diverses réformes ont en effet été adoptées, concernant la fiscalité, l’enseignement, les médias, l’ouverture de l’industrie pétrolière au capital étranger. Mais outre les résistances croissantes au consensus réformateur, opposées par les formations les plus à gauche, la réforme de l’État a buté sur l’obstacle sécuritaire. Le taux d’homicide reste, en effet, très élevé [8]. L’impact économique de la violence a même été évalué par le Institute for Economics and Peace à 13 % du PIB pour l’année 2015 [9]. Elle érode le développement d’un certain nombre de secteurs et encourage, elle aussi, l’émigration. L’importance des flux financiers issus de l’économie des stupéfiants a introduit des formes « de porosité entre mondes légaux et illégaux » [10]. Celle-ci alimente la corruption des agents de l’État et parfois des élus, générant un cercle vicieux d’impunité. Au final, sans obstacle policier et judiciaire effectif, le crime se perpétue et finit par déstabiliser l’économie légale. L’incapacité des autorités à faire la lumière sur les disparitions de masse, comme celles survenues à Iguala, dans l’État de Guerrero, le 26 septembre 2014, illustre l’ampleur du défi.
* * *
Gilles Bataillon, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) critique de façon insolite et courageuse le refus de « la majorité des scientifiques sociaux » d’affronter le défi du réel mexicain, en « prenant grand soin de ne jamais entrer dans le vif du débat […] Ils ont ainsi peint un Mexique imaginaire, […] permettant de faire carrière dans l’université mais pas de comprendre ce qui se passait dans le pays et encore moins d’aider à ce qu’émerge dans ce pays un réformisme démocratique conséquent » [11]. L’analyse pourrait être étendue aux discours tenus par les responsables politiques et les diplomates mexicains, comme par les partenaires économiques principaux de ce pays. Feuilles de route ambitieuses, défis disséqués et assortis de propositions intelligentes n’ont, en effet, pas manqué [12]. Mais parler de l’émergence éventuelle du Mexique, comme s’il s’agissait d’un pays aux catégories fondamentales assimilables à celles de ses partenaires de l’OCDE, ne relève-t-il pas de l’illusion sémantique ? Prétendre jouer un rôle d’acteur international, que la partition soit néolibérale, nationaliste ou néosocialiste, suppose en effet que l’État considéré ait une consistance préalable suffisante. La question reste ouverte à propos du Mexique.
- [1] Voir par exemple à ce sujet le n° 3080 de la revue Problèmes économiques, La Documentation française, janvier 2014.
- [2] Le Mexique avait de façon exceptionnelle et symbolique participé à trois opérations de paix, au Cachemire en 1949, dans les Balkans de 1947 à 1950 et au Salvador en 1992-1993.
- [3] Voir à ce sujet Verónica de la Torre Oropeza, « Teoria e ensino em Relações internacionais no México », in Carlos R. S. Milani et Maria Gabriela Gilda de la Cruz, A política mundial contemporânea, Salvador, Edufba, 2010 ; et Thomas Legler, Arturo Santa Cruz et Laura Zamudio González, Introducción a las Relaciones Internacionales. América latina y la política global, Mexico, Oxford University Press, 2014.
- [4] Enrique Peña Nieto, México, la gran esperanza, Mexico, Grijalbo, 2011.
- [5] Vladimir Davydov, Vladimir Súdarev, Valery Morózov, Alexandr Sizonenko, Nadezdha Kudeyárova, Nilolay Jolodkov, Yulia Vizgunova et Dmitry Razumovsky, Relaciones Ruso-Mexicanas, Moscou, RIAC, 2015.
- [6] « México “conquista” España », El Pais, 24 mai 2014.
- [7] « México, primer inversor no europeo en España », América Economia, 25 mai 2014.
- [8] Le taux d’homicides est passé de 8 pour 100 000 habitants en 2008, à 24 en 2011. Institute for Economics and Peace, Mexico Peace Index 2016, mars 2016.
- [9] Ibid.
- [10] Gilles Bataillon, « Les formes de la violence mexicaine au XXIe siècle », Problèmes d’Amérique latine, n° 96/97, Eska, 2015, p. 149.
- [11] Ibid., p. 159.
- [12] Voir notamment le n° 100 de la Revista Mexicana de Política exterior, Instituto Matias Romero, janvier-avril 2014.

