Septembre 2017
Keep calm and don’t overreact. Le président Trump, le terrorisme et la menace existentielle / Par Alexandre Andorra
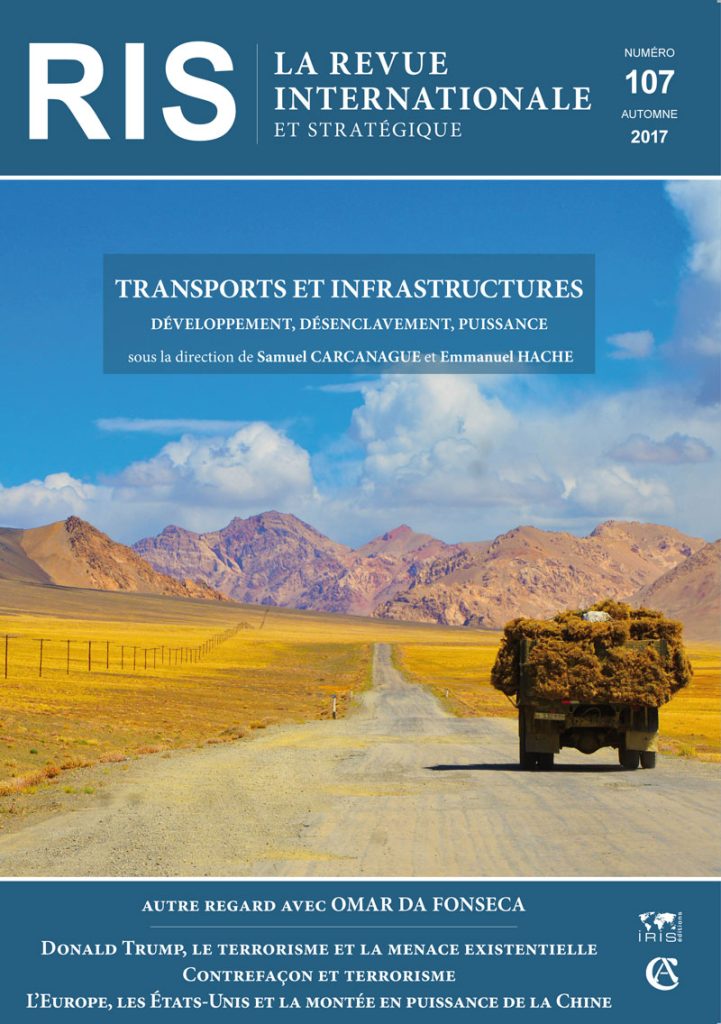 Transports et infrastructures : développement, désenclavement, puissance
Transports et infrastructures : développement, désenclavement, puissance
RIS N°107 - Automne 2017
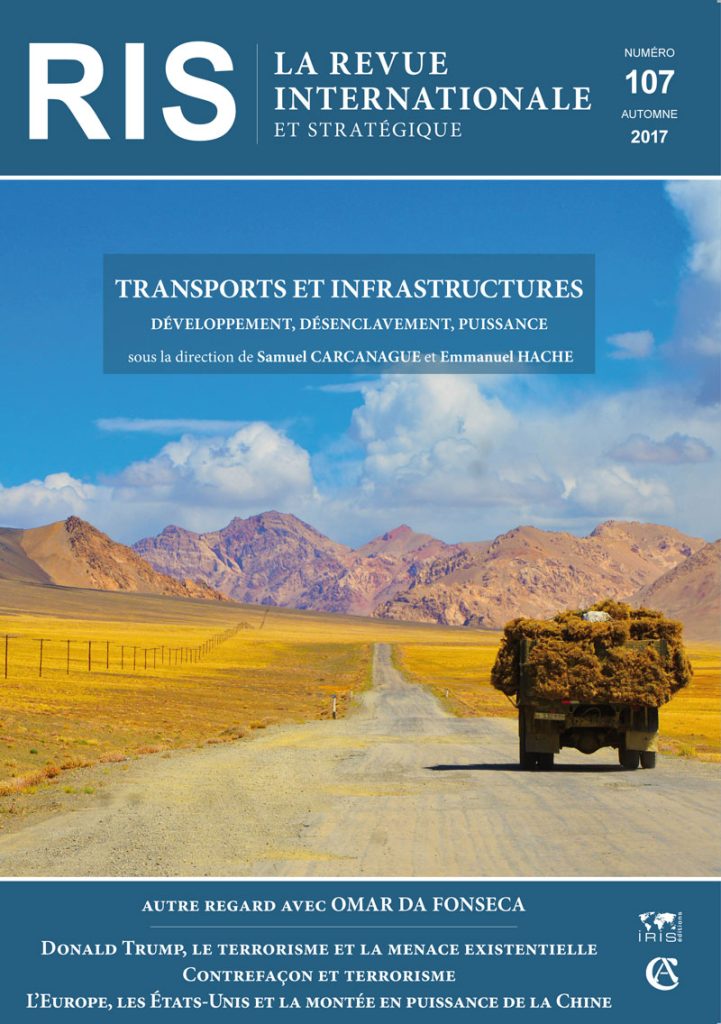
« Je prie Allah pour qu’il donne l’Amérique à Trump » [1]. En août 2016, un porte-parole du soi-disant État islamique (EI, ou Daech) tenait ces propos étonnants. Pourquoi soutenir le candidat qui promettait d’« éradiquer » Daech [2] ? Un djihadiste apporte sa réponse sur Telegram : « quand [George W. Bush] est venu avec ses soldats […] et a dit avec une absolue clarté que c’était une croisade, […] le peuple […] suivait et célébrait les djihadistes. Mais sous l’ère des démocrates comme Barack Obama – des loups déguisés en brebis –, les musulmans ont commencé à parler de tolérance et de modération » [3]. Pour les djihadistes, sa rhétorique belliqueuse fait de D. Trump l’ennemi idéal. Si des troupes au sol seraient l’argument ultime, son discours islamophobe fait déjà une grosse partie de leur travail.
Refusant à la fois la rhétorique haineuse et les déploiements massifs au sol, B. Obama n’était pas tombé dans ce piège. Il fut pourtant le seul président de l’histoire des États-Unis à diriger une nation en guerre durant l’intégralité de ses deux mandats. Sa politique contre-terroriste est toutefois plus complexe qu’une statistique : pendant qu’il divisait par 20 les troupes présentes en Irak et en Afghanistan [4], il entreprenait des actions militaires – principalement reconnaissance, drones, frappes aériennes et forces spéciales – dans sept pays différents [5]. Mais il a toujours pris soin de définir ses guerres de manière restreinte, comme un défi sécuritaire long, récurrent mais gérable, plutôt que comme une mobilisation totale mais relativement brève, à l’image de l’Irak, du Viêtnam ou plus encore de la Seconde Guerre mondiale.
Le candidat Trump avait fustigé cette approche, suggérant plutôt d’envoyer 30 000 hommes supplémentaires [6] et n’écartant pas l’emploi d’armes nucléaires pour combattre Daech [7]. Il préconisait aussi de tuer les familles des terroristes et se disait ouvert au retour de la torture. L’« islam radical », pour reprendre ses termes [8], constitue la menace existentielle : « nous n’avons vraiment pas le choix. Nous devons éliminer l’EI, nous devons nous en débarrasser, puis nous devons rentrer à la maison et reconstruire notre pays qui est en train de s’effondrer » [9].
Mais l’« islam radical » est-il réellement une menace existentielle pour les États-Unis ? Si oui, est-ce la première ? Et qu’est-ce qu’une menace existentielle ? Doit-on même parler d’« islam radical » ? En effet, le terme apparaît trop vague et connoté. Nous parlerons ici de « mouvance radicale salafiste » et de « salafisme djihadiste », termes plus appropriés car plus précis.
Désormais aux commandes, D. Trump se trouve contraint de répondre en plus de 140 caractères à des interrogations stratégiques primordiales : faut-il prolonger ou revoir la politique contre-terroriste de B. Obama ? étendre ou restreindre le rôle de l’Amérique dans le monde ? avec quels outils ? Ceux-ci devront, en outre, faire l’objet d’une pondération. Enfin, et peut-être surtout, le terrorisme constitue-t-il réellement une menace existentielle pour les États-Unis, et la peur qu’il génère n’est-elle pas disproportionnée par rapport aux risques qu’il fait peser sur l’Amérique ? De la réponse à cette question découlent toutes les autres.
Définir la menace
Une menace existentielle se caractérise par son ampleur, sa simultanéité et sa cible [10]. Elle vise les points névralgiques indispensables à l’existence matérielle de l’État – centres décisionnels, infrastructures, réseau énergétique, métropoles, réseaux de communication, approvisionnement –, dans le but d’entraver sa capacité d’action et son fonctionnement. Elle trouve sa plus sérieuse illustration dans les menaces à l’intégrité territoriale et les risques de conflits inter et intraétatiques. En découle le rôle de la sécurité nationale pour préserver l’existence de l’État et sa capacité à exercer le pouvoir.
Apparaissent alors trois caractéristiques supplémentaires. Tout d’abord, une menace existentielle est évolutive : certaines disparaissent – l’Union soviétique pour les États-Unis, l’Allemagne pour la France –, d’autres apparaissent – les réseaux électroniques. Ensuite, elle n’est pas que mortelle ; elle est aussi vitale car elle incite un pays à se mobiliser pour y répondre. Autrement dit, un pays a besoin d’ennemis [11]. Enfin, elle est associée à une notion d’antagonisme à l’égard d’un Autre absolu, dont la présence même constitue une menace à l’existence et justifie des mesures urgentes et exceptionnelles allant jusqu’à la guerre.
Il s’agit donc d’un domaine teinté de subjectivité et de phénomènes autoréalisateurs : désigner une menace à la survie renforce le sentiment de danger, ce qui radicalise le discours sur la menace, et ainsi de suite. D’où le soin à apporter à ce que l’on désigne comme « menace existentielle ». La sécurité n’est pas seulement l’art de sécuriser ; c’est aussi un acte de langage.
Terrorisme et sacralité du territoire
Un territoire sacré, une mission divine, un peuple élu
Au XIXe siècle, la conquête de l’Ouest conduit les Américains à s’installer toujours plus à l’intérieur des terres, qui restent disponibles en quantité suffisante pour des millions de colons. Les menaces mexicaine et canadienne sont contenues à peu de frais, si bien que la population en oublie leur existence même. Tout se passe comme si l’Amérique vivait isolée du reste de monde. L’un des pères fondateurs, Alexander Hamilton, n’avait-il pas professé que « si nous sommes assez sages pour conserver l’Union, nous pourrons jouir durant des siècles d’un avantage comparable à celui d’une île » [12] ? Le niveau de vie des Américains ne cessant de progresser pendant plus de cinq générations, les habitants de la jeune nation en vinrent à croire que leur bonheur, leur richesse et leur sécurité étaient ainsi garantis parce qu’ils étaient les représentants d’une « destinée manifeste », peuplant un territoire béni de Dieu.
Affolement du leadership, distraction stratégique
L’on est d’autant plus accablé par un revers que l’on est convaincu de sa supériorité. Si les Américains ont été « choisis » pour vivre sur ce territoire à la fois autosuffisant et inviolable, alors échouer à le protéger revient à faillir à leur mission divine. De la réponse au lancement de Spoutnik en 1957 à l’invasion de l’Irak en 2003 en passant par la guerre du Viêtnam et la japanophobie des années 1980, la panique et la surréaction engendrées par la remise en cause de leur leadership sont l’un des fondements de la politique étrangère des États-Unis. L’illustration la plus récente se trouve évidemment dans les conséquences du 11-septembre : si les attentats à l’étranger visant les intérêts et ressortissants américains sont considérés comme des tragédies, ils restent moins humiliants et traumatisants que les attaques sur le sol américain. Bien qu’exceptionnel, le territoire n’est ni inviolable ni invulnérable. Pourtant, le mythe de sa sanctuarisation reste ancré dans l’imaginaire américain. Dès lors, tout ce qui le menace devient existentiel. Ce mythe constitue en cela un objectif indépassable et mobilisateur influençant la politique étrangère.
Mais la fierté blessée et le sentiment d’humiliation ne sont pas des guides stratégiques fiables, car ils incitent à surréagir. Le risque est alors fort de surestimer le danger, de confondre menace existentielle et menace majeure – c’est-à-dire réelle mais limitée [13]. Les conséquences peuvent être désastreuses, comme l’illustre l’invasion de l’Irak en 2003 au nom, justement, d’une menace surévaluée.
L’état de la menace : majeure, mais pas existentielle
Pour Daech, le monde est bipolaire, séparé entre les terres de son soi-disant califat, dar al-Islam (« le domaine de l’islam »), et celles de ses ennemis, dar al-harb (« le domaine de la guerre »). En divisant lui aussi le monde entre « eux » et « nous », D. Trump retombe dans les travers de l’administration Bush. Le « filtrage renforcé » des immigrés – version épurée de l’interdiction d’accès au territoire pour les musulmans avancée pendant la campagne – corrobore l’affirmation djihadiste selon laquelle les musulmans ne sont ni les bienvenus ni en sécurité aux États-Unis, et que la violence est plus prometteuse que la participation politique et l’intégration sociale. Si D. Trump maintient sa posture, voire s’il allie les actes aux mots, il négligera trois des principaux dangers que présente le salafisme djihadiste.
Le mythe de l’omnipotence militaire
Le premier serait de plaquer un cadre d’analyse interétatique classique sur ces conflits asymétriques. Alors qu’historiquement, la puissance de l’État augmente les probabilités de guerre, c’est désormais plus souvent l’absence d’État qui crée de telles situations [14]. Les conflits sont aujourd’hui plus sociologiques que militaires, faisant apparaître des entrepreneurs de violence qui capitalisent sur l’exclusion sociale et l’éclatement du contrat social – Al-Qaïda hier, Daech aujourd’hui, un autre demain. La menace n’est plus systématiquement étatique ; elle est aussi constituée par des réseaux hybrides et transnationaux. Bien qu’importante, elle n’est pas nécessairement existentielle, ni même exclusivement militaire. La rhétorique d’une « guerre contre l’islam radical », si commode en politique, est éminemment trompeuse, car ancrée dans une représentation biaisée du monde. Elle se trompe d’outil et fixe des objectifs inatteignables – mettre fin à la terreur, éradiquer le Mal –, nourrissant une impression d’impuissance pour finalement renforcer la peur et l’hystérie qui l’ont fait naître.
Le danger du trou noir
« L’EI n’est pas une menace existentielle pour les États-Unis », estimait le président Obama [15]. Ce dernier n’a en effet jamais cru que le terrorisme [16] actuel faisait peser sur l’Amérique un risque proportionné à la peur qu’il génère. Même en 2014, quand Daech décapite des otages américains, B. Obama ne cède pas à l’émotion et rappelle que le terrorisme tue beaucoup moins d’Américains que les armes à feu, les accidents de la route ou même les chutes dans les salles de bains. Son but est alors de susciter la résilience et des débats sur les faits plutôt que la panique – en l’occurrence une islamophobie doublée d’une remise en cause de l’ordre constitutionnel et de la société ouverte.
À plus long terme, la politique étrangère ne peut se limiter au contre-terrorisme. Les pandémies, le changement climatique, la cybersécurité, l’assertivité chinoise et l’aventurisme russe sont autant de menaces qui méritent au moins autant d’attention. Et si « déterroriser » la politique étrangère et mettre fin à deux guerres d’occupation n’impliquent pas de se désintéresser des menaces terroristes, faire revenir 190 000 hommes d’Irak et d’Afghanistan permet d’envisager une diversification de la projection de puissance sur les menaces potentiellement existentielles, et ainsi de ne pas se faire happer par le trou noir terroriste.
Le risque de l’exagération politique
Revenir aux chiffres relativise grandement le chaos et l’apocalypse que le terrorisme est censé faire peser sur les sociétés occidentales. Entre 2005 et 2015, 24 citoyens américains ont été tués par des attaques terroristes salafistes sur le sol américain. Pas vraiment une menace existentielle donc, ni même la menace terroriste la plus directe, puisque dans le même temps, 47 Américains mouraient du fait d’attaques terroristes non salafistes – suprématistes blancs et extrême droite notamment. Durant la même décennie, 301 797 Américains sont morts par arme à feu [17]. Un Américain vivant aux États-Unis a donc 12 000 fois plus de chances d’être tué par une arme à feu que par un terroriste salafiste. En Europe occidentale, les morts dues au terrorisme sont aujourd’hui nettement moins élevées que dans les années 1970 et 1980, quand l’Euskadi ta Askatasuna (ETA), l’Armée républicaine irlandaise (IRA) et les groupes communistes multipliaient les attentats [18]. De même, le territoire américain a subi moins d’attaques terroristes depuis le 11-septembre que dans les années 1970 [19]. Si le terrorisme est bien une menace majeure pour la sécurité humaine des pays de la zone transatlantique, tant qu’il ne s’attaque pas à des infrastructures vitales – ce n’est pas un hasard si, le 11 septembre 2001, des avions visaient aussi le Pentagone et la Maison-Blanche –, il n’est pas une menace existentielle. À l’inverse des situations au Nigeria, au Mali, en Libye, en Irak ou en Afghanistan, les attaques terroristes n’altèrent pas l’intégrité territoriale des États européens et américain, et n’accroissent pas les risques de conflits inter et intraétatiques. Contrairement à l’Union soviétique, le salafisme djihadiste serait bien incapable de vaincre les États-Unis et l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Contrairement au communisme, il ne séduit pas les intellectuels occidentaux, mais principalement des individus instables, manipulables et fragiles. La lutte contre la mouvance radicale salafiste, millénariste et nihiliste, sera longue, mais n’est pas existentielle. La contrer nécessite des forces judiciaires, policières, militaires et de renseignement efficaces, financées et encadrées, mais aussi une intégration des risques et une capacité de résilience de la part de la population. La lutte sera autant technique que psychique, selon Gérard Chaliand : « n’importe quelle violence qui pourrait nous menacer nous rend tremblants. Il faut quand même avoir un minimum de courage : le terrorisme se joue essentiellement dans les esprits et dans les volontés » [20].
Une guerre sans fin contre les « barbares » est un slogan politique très commode à court terme. Mais pour trouver des solutions de long terme, il faut se départir de ce cadre d’analyse manichéen. Car la spécificité du système international dans les années à venir sera précisément cette zone grise déroutante entre guerre et paix. « Paix impossible, guerre improbable », résumait Raymond Aron [21]. Dans une certaine mesure, les terroristes ont le pouvoir qu’on veut bien leur donner. Le péril est réel mais plus limité que l’EI veut le faire croire ; il reste plus moral et politique que matériel et militaire. Mais il peut devenir existentiel, si la réaction au terrorisme approfondit les divisions intraétatiques par la xénophobie, l’instrumentalisation politique de la peur et l’irrespect de l’État de droit au nom de la sécurité à tout prix. L’équilibre est délicat : comment affaiblir un péril réel mais restreint sans pour autant le nourrir ? comment mobiliser la population sans l’apeurer ? comment projeter une image d’autorité sans alimenter la panique ? comment raisonner sans paraître faible ?
Quelle feuille de route ?
Outre la « déterrorisation » de la politique étrangère, il faut retenir trois lignes de force de la politique étrangère de B. Obama. Premièrement, la puissance ne se réduit pas à la force militaire et la politique étrangère doit être multidimensionnelle. Deuxièmement, la puissance américaine doit s’inscrire dans le temps long : un changement brutal et sans implication des acteurs locaux engendre une victoire moins durable que des mesures incrémentales. Troisièmement, l’Amérique doit se recentrer sur ses intérêts vitaux, donc déléguer plus. D’où un besoin de responsabiliser davantage ses alliés pour se concentrer sur les menaces existentielles et les problèmes à haute valeur ajoutée.
À l’extérieur, un catalyseur indispensable
La menace la plus saillante est évidemment l’EI, tant parce qu’il contrôle territoires et populations au Moyen-Orient que parce qu’il est capable de mener ou d’inspirer des attaques ailleurs dans le monde. D. Trump aura donc des décisions difficiles à prendre. Tout d’abord, faut-il des troupes au sol ? Le risque est grand de mener à nouveau des combats épuisants, qui ont la préférence des terroristes et finissent par renforcer l’extrémisme. Ensuite, faut-il armer davantage les Kurdes ? En Syrie et en Irak, ces forces ont été les partenaires locaux les plus efficaces contre l’EI. Mais soutenir plus avant les Kurdes syriens signifie se mettre à dos la Turquie, qui les considère comme terroristes. Et accroître le soutien aux Kurdes irakiens augmente les chances de voir émerger un État kurde indépendant, ce à quoi l’Irak, l’Iran, la Turquie et la Syrie sont opposés. D. Trump devra donc choisir entre renforcer le soutien aux Kurdes ou s’allier aux Russes – donc implicitement à l’Iran et à Bachar Al-Assad. Soutenir les Russes implique un renversement de la position américaine actuelle. Les Américains stopperaient-ils alors leur soutien aux partenaires sunnites locaux qui cherchent à renverser B. Al-Assad ? Les alliés saoudiens, turcs et israéliens goûteraient peu à ce renforcement induit de l’influence iranienne dans la région. En outre, quel serait le coût d’un alignement sur les Russes et B. Al-Assad ? Premièrement, la coalition internationale menée par les États-Unis se retrouverait marginalisée par l’action de son propre leader. Deuxièmement, la Maison-Blanche adopterait le discours de la Russie et de B. Al-Assad, qui se posent aujourd’hui comme les seuls remparts efficaces au terrorisme. Troisièmement, les États-Unis risqueraient de donner l’impression d’abandonner leur rôle de leader à la Russie et d’en faire un pair géopolitique.
Mais éliminer l’EI n’est pas une fin en soi : que faire une fois que Daech aura été détruit, ou plutôt contraint de redevenir une organisation en quelque sorte clandestine sur le modèle d’Al-Qaïda ? Qui reconstruira et administrera ces régions ? Qui financera la reconstruction ? Qui assurera la stabilisation de ces zones ? Si le président commet l’écueil classique des interventions occidentales – frapper, puis partir, sans se soucier de ce qui vient après –, il ne fera que remplacer la tyrannie par le chaos, tout en augmentant la probabilité d’émergence d’un nouveau Daech.
La lutte contre l’EI est donc imbriquée dans une multitude de problèmes régionaux. Les enjeux, protagonistes et intérêts sont tellement nombreux que Washington ne peut ni ne doit agir seule – d’autant que la menace n’est pas existentielle. Il faudra poursuivre le passage, enclenché par B. Obama, de « nation indispensable » à « catalyseur indispensable » [22], en incitant les alliés à prendre plus de responsabilités. Surtout, il faudra éviter de céder à la facilité : « les États-Unis ont envahi et occupé l’Irak, et le résultat fut un coûteux désastre. [Ils] ont envahi mais n’ont pas occupé la Libye, et le résultat fut un coûteux désastre. [Ils] n’ont ni envahi ni occupé la Syrie, et le résultat fut un coûteux désastre » [23].
À l’intérieur, une bataille pour les esprits
Pour sortir de cette apparente impasse, les États-Unis doivent reconnaître que le terrorisme ne représente pas seulement un conflit militaire, mais aussi une bataille d’idées et de volontés. Pour cela, Washington devra éviter de rejouer l’invasion de l’Irak de 2003, quand un débat légitime de politique étrangère fut transformé en test de patriotisme et de lâcheté. Pouvoir s’interroger publiquement pendant que l’EI interdit le débat est précisément l’une des meilleures défenses. Pour citer R. Aron, même quand les démocraties « ont l’air passives, elles sont, en fait, par leur existence même, par le niveau de vie et les libertés qu’elles réservent aux individus, agressives ». Exister, c’est vaincre [24]. De là, il est indispensable de fermer Guantanamo, qui représente aux yeux du monde les pires abus de l’Amérique. Il faut également prolonger les efforts de l’administration Obama visant à incorporer les pratiques judiciaires et policières classiques – y compris les procès civils – dans les actions contre-terroristes de la Central Intelligence Agency (CIA) et du Pentagone. Le terrorisme est un problème permanent qui peut être géré mais pas éradiqué ; il doit donc rester dans le champ de la justice et du droit pénal. Enfin, les attaques récentes montrent que la menace est domestique avant d’être moyen-orientale. Ainsi, malgré leurs effets difficiles à quantifier à court terme, les stratégies préventives – lutte contre le recrutement domestique et propagation des idéologies extrémistes, engagement civique auprès des communautés vulnérables – doivent rester une part essentielle du mix contre-terroriste américain.
Ces mesures préventives doivent aussi être utilisées dans les pays qui souffrent de conflits, de mauvaise gouvernance, d’exclusion sociale, de faiblesse économique ou politique, de corruption, de manque d’éducation. L’aide au développement doit chercher à prévenir l’expansion de l’extrémisme plutôt qu’à simplement y réagir, en aidant ces pays à moderniser leur économie, leur système éducatif – notamment pour les jeunes filles –, les incitations à l’entrepreneuriat et la lutte contre la corruption. En cela, le président devra se souvenir des paroles de son prédécesseur : « nous ne pouvons plus continuer à penser le contre-terrorisme et la sécurité comme totalement séparés de la diplomatie, du développement, de l’éducation – toutes ces choses qui sont considérées comme soft mais qui sont en fait vitales pour notre sécurité nationale ». La lutte contre la mouvance radicale salafiste requiert une politique polymorphe, conciliant action extérieure et travail de fond sur les esprits : contrer la propagande, résister à la panique, démanteler les réseaux, éliminer les principaux leaders sur le terrain, tarir les sources de ravitaillement et de financement, aider au développement et à l’éducation des populations vulnérables.
Le raisonnable et le rationnel
La mouvance radicale salafiste, malgré tout l’espace médiatique et politique qu’elle occupe, ne menace pas l’existence des États-Unis. Réelle mais limitée, elle correspond à une menace majeure. Mais le président Trump pourrait contribuer, par un discours trop belliqueux, à la transformer en menace existentielle. Les États-Unis l’ont découvert depuis 2003 : faire la guerre au terrorisme est une solution simple et attractive, mais c’est précisément pour cela qu’elle est vouée à l’échec. Tout président qui promettra la défaite totale de la terreur en tirera peut-être des bénéfices politiques à court terme, mais perdra plus à long terme. De 90 % au lendemain du 11-septembre, la cote de popularité de George W. Bush était tombée à 30 % fin 2008 [25]. B. Obama estimait qu’on ne célébrera pas « notre victoire contre le terrorisme par une cérémonie de capitulation sur un navire de guerre ou par la démolition d’une statue. On la célébrera en voyant des parents amener leurs enfants à l’école, […] des fans aller à un match, […] une rue d’une grande ville grouiller d’activité. » Ce propos n’est pas un prétexte à l’inaction. Il signifie qu’une éradication du terrorisme est inenvisageable, encore moins en utilisant exclusivement l’outil militaire. Une menace complexe implique une stratégie rationnelle, souple et réactive exploitant tous les leviers de puissance. Tout cela dessine une politique protéiforme, compliquée à déchiffrer ou à résumer en 140 caractères.
À raison, l’école pacifiste reprochera à cette stratégie le risque de guerre permanente qu’elle implique. À raison, l’école offensive lui opposera le risque de défaite graduelle qu’elle comporte. Reste que le risque de guerre perpétuelle ne peut être affaibli qu’en augmentant celui de capitulation progressive. Inversement, réduire le risque de défaite par étouffement impose d’accepter un risque plus grand de guerre permanente. Dès lors, une stratégie modérée semble présenter la plus grande probabilité de contrer à la fois la menace d’épuisement et la menace d’étouffement. Elle permet aussi d’atténuer le problème de long terme qu’est le terrorisme – surtout quand il se combine à celui des États faillis –, tout en limitant le risque d’enlisement dans des conflits locaux dans lesquels les États-Unis n’ont pas d’intérêts vitaux. Plus globalement, elle permet de rester concentré sur les menaces vraiment ou potentiellement existentielles : changement climatique, pandémies, Chine, Russie, cybersécurité, Corée du Nord, etc.
Pour l’instant, D. Trump nie le changement climatique, une urgence lente toujours dépassée par des problèmes apparemment plus pressants, mais qui a le potentiel pour aggraver la plupart des problèmes mondiaux actuels. Par ailleurs, la Chine, en situation de ralentissement économique, pourrait recourir au nationalisme et refuser les responsabilités qui reviendraient à un pays de ces dimensions dans le système international, augmentant ainsi le risque de conflit externe et la difficulté pour les autres puissances à gérer les défis transnationaux. Sur ce dossier, D. Trump évalue mal l’étendue de la menace : en affirmant que les États-Unis dépensent trop pour leurs alliés asiatiques, il insinue que la rivalité avec la Chine est moins stratégique qu’économique. Mais dans le même temps, il a désengagé son pays de l’accord de partenariat transpacifique (TPP), ce qui risque de conduire un peu plus les pays asiatiques dans les bras de Beijing [26]. Enfin, la position de la Russie est moins favorable qu’elle n’y paraît, confrontée à des problèmes démographiques, une économie rentière et des fragilités sociales nombreuses. Vacillante et fragile, elle renforcera la tendance de Vladimir Poutine à projeter sa force militaire pour donner une impression de puissance. Là encore, D. Trump sous-estime la menace : il ne nie pas seulement que les interférences russes dans les dernières présidentielles américaines avaient pour but de le faire élire, mais leur existence même [27], malgré des preuves récoltées par ses propres services de renseignement. Ce dossier est relié à la cybersécurité, domaine dans lequel les fragilités sont également nombreuses [28]. Enfin, une Corée du Nord nucléarisée serait autrement plus inquiétante que la mouvance radicale salafiste actuelle. D. Trump a ainsi parfois semblé remiser sa rhétorique de campagne : « après dix minutes [à écouter Xi Jinping], j’ai réalisé que ce n’était pas si simple » [29]. Cela explique un ton plus conciliant sur la Chine : plus il s’en éloigne, moins il a de leviers d’influence sur la Pyongyang.
Malgré tout, le concept de menace existentielle a ses défauts. Teinté de subjectivité, il laisse la place à l’interprétation et aux postures. Le classement des menaces a donc tendance à changer selon l’interlocuteur [30]. Mais il existe des menaces objectivement existentielles – jadis l’Union soviétique pour les États-Unis, aujourd’hui la Corée du Nord pour la Corée du Sud. Bien qu’imparfait, le critère « existentiel » constitue un bon guide en ce qu’il met en relation les capacités et intentions des menaces, et les intérêts des États-Unis [31]. La mouvance radicale salafiste ne franchit pour l’instant pas ce seuil. Le commander-in-chief devra donc distinguer menaces périphériques et menaces vitales, et aligner les outils de la puissance sur l’intensité de ces périls. C’est l’une des conditions pour que la Maison-Blanche impose son agenda au salafisme djihadiste, et non l’inverse.
- [1] Mara Revkin, « ISIS’ Perfect Enemy », Foreign Affairs, 14 novembre 2016.
- [2] Mara Revkin et Ahmad Mhidi, « Why ISIS Is Rooting for Trump », Foreign Affairs, 24 août 2016.
- [3] Ibid.
- [4] De 200 000 à 10 000 hommes.
- [5] Libye, Somalie, Yémen, Syrie, Pakistan, Irak, Afghanistan.
- [6] Shoshana Weissmann, « Trump Calls for 20,000-30,000 Troops to Fight ISIS », The Weekly Standard, 10 mars 2016.
- [7] Ben Geier, « Donald Trump Won’t Rule Out Using Nukes Against ISIS », Fortune, 23 mars 2016.
- [8] « Trump takes on Obama, Clinton over ‘radical Islam’ as candidates condemn terror », FoxNews.com, 13 juin 2016.
- [9] Shoshana Weissmann, op. cit.
- [10] Pour une formulation officielle, voir Steve Benen, « Obama on ISIS : “They’re not an existential threat to us” », msnbc.com, 24 mars 2016 ; et Jeffrey Goldberg, « The Obama Doctrine », The Atlantic, avril 2016.
- [11] Voir Pierre Conesa, La fabrication de l’ennemi, Paris, Robert Laffont, 2011.
- [12] Alexander Hamilton, Federalist n° 8. The Consequences of Hostilities Between the States, 20 novembre 1787.
- [13] Voir notamment Jean-François Daguzan, « D’Al Qaïda à AQMI, de la menace globale aux menaces locales », in Pierre Verluise (dir.), « Géopolitiques des terrorismes », diploweb.com, janvier 2015.
- [14] Voir Bertrand Badie, L’impuissance de la puissance. Essai sur les nouvelles relations internationales, Paris, Fayard, 2004
- [15] Cité par Jeffrey Goldberg, « The Obama Doctrine », The Atlantic, avril 2016.
- [16] Que Raymond Aron définissait comme « une action de violence dont les effets psychologiques sont hors de proportion avec les résultats purement physiques ». Voir Paix et Guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962.
- [17] Sources : NowThis, New America Foundation, CDC National Vital Statistics System, Mass Shooting Tracker, Gun Violence Archive. Voir aussi Jessica Stern, « Obama and Terrorism », Foreign Affairs, septembre-octobre 2015.
- [18] Sources : Global Terrorism Database et Datagraver.
- [19] Daniel Byman, « Beyond Counterterrorism », Foreign Affairs, novembre-décembre 2015.
- [20] Gérard Chaliand, in Pierre Verluise (dir.), « Géopolitiques des terrorismes », op. cit.
- [21] Raymond Aron, Le grand schisme, Paris, Gallimard, 1948.
- [22] Alexandra De Hoop Scheffer, « Les États-Unis, une puissance en crise d’adaptation », Ceriscope Puissance, 2013.
- [23] Philip Gordon, cité par Gideon Rose, « What Obama Gets Right », Foreign Affairs, septembre-octobre 2015.
- [24] Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, op. cit.
- [25] Un score particulièrement bas pour un président américain : en comparaison, la cote de Barack Obama est passée de 67 % en janvier 2009 à 57 % en décembre 2016, soit légèrement inférieure à Ronald Reagan et Bill Clinton (63 %) en fin de mandat. Source : Gallup.
- [26] En novembre 2016, le ministre australien du Commerce a confirmé le soutien de son pays à un accord de libre-échange mené par la Chine, incluant 16 pays de la région mais excluant les États-Unis. Voir Jamie Smyth, « Australia snubs US by backing China push for Asian trade deal », Financial Times, 16 novembre 2016.
- [27] « Putin turned Russia election hacks in Trump’s favor : U.S. officials », Reuters, 16 décembre 2016 ; et Max Boot, « How to Wage Hybrid War on the Kremlin », Foreign Policy, 13 décembre 2016.
- [28] Écouter « The President’s Inbox : Cybersecurity », Council on Foreign Relations, 15 décembre 2016, disponible en ligne.
- [29] « Trump Says He Offered China Better Trade Terms in Exchange for Help on North Korea », The Wall Street Journal, 12 avril 2017.
- [30] Voir Dan Lamothe, « Who’s an existential threat to the U.S. ? In Washington, it depends who’s talking », The Washington Post, 13 juillet 2015.
- [31] Pour une réflexion intéressante sur ce concept, voir James Fallows, « On “Existential” Threats », The Atlantic, 20 février 2015.

