Septembre 2017
Entre fermeture fantasmée et ouverture effective : les infrastructures de transport, levier majeur du développement de l’Afrique / Par Benjamin Steck
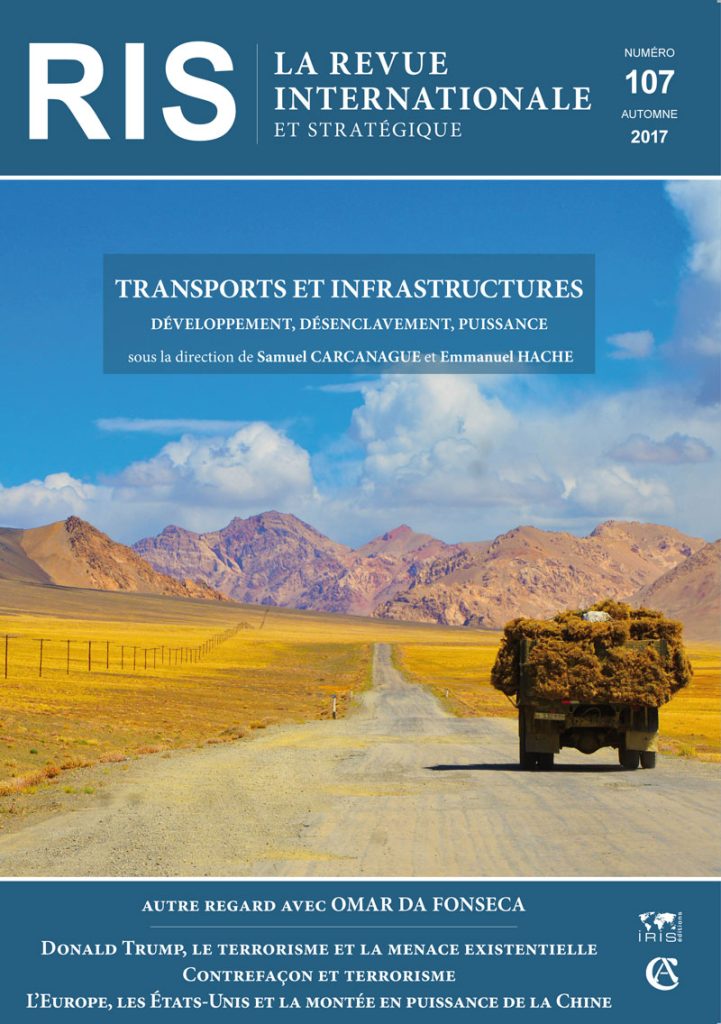 Transports et infrastructures : développement, désenclavement, puissance
Transports et infrastructures : développement, désenclavement, puissance
RIS N°107 - Automne 2017
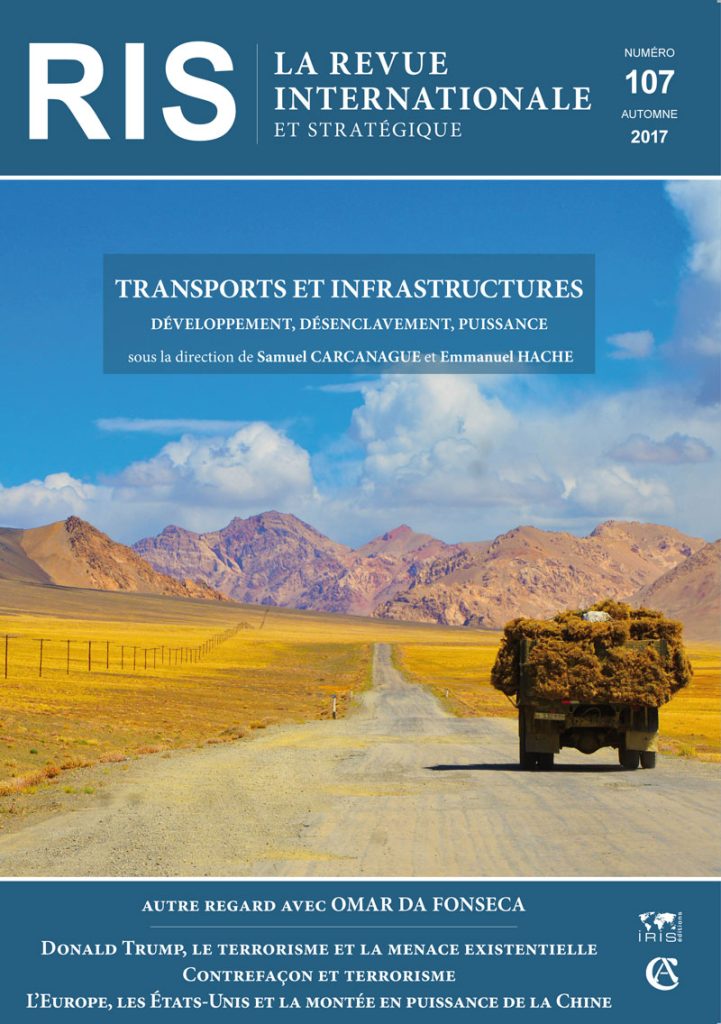
L’Afrique est terre de paradoxes. D’un côté, elle serait un monde de campagnes reculées et de traditions immuables, une terre où dominerait un fatalisme stérile, inapte à produire de l’innovation. Elle serait dans l’incapacité à assurer sa sécurité alimentaire, à dominer les épidémies. L’Afrique serait un continent de crises et de guerres, présentées de façon univoque comme ethniques ou religieuses, incapable de se doter de formes politiques démocratiques stables. Elle subirait, sans réagir, l’explosion démographique la plus radicale de toute l’histoire de l’humanité, générant des migrations incontrôlées et redoutées. Elle serait un continent massif, perçu comme fermé, réputé dangereux, institué par les fantasmes des colonialistes de tout temps en vestiges de l’humanité primitive qui peine à assurer son avenir. De l’autre côté, l’Afrique serait une terre aux potentialités considérables et attractives pour les opérateurs économiques globaux, un continent aux populations avides de sortir de leur vulnérabilité et d’atteindre les standards de vie présentés comme l’horizon de l’Histoire, éprises de modernité technologique et constituant un vivier dynamique de compétences à former. Elle serait un marché à conquérir, l’un des derniers où la transaction mondialisée pourrait déployer ses ambitions. Paradoxes des représentations et des discours qui accompagnent des passions toujours vivaces plaçant volontiers l’Afrique en paradigme de l’altérité à la fois inquiétante et stimulante.
La persistance réductrice de tous ces schémas imprime dans les esprits une image négative de l’Afrique, image combattue avec constance par des travaux de plus en plus nombreux [1]. L’histoire des populations africaines révèle en effet une Afrique en mouvement, matériellement et symboliquement, quelles que soient les défaillances des instruments de la mobilité. Les populations africaines sont mobiles, quoi que l’on puisse écrire de leurs prétendus enracinement et emprisonnement configurés par un déterminisme naturel qui dicterait sa loi aux dynamiques humaines. La mobilité n’y est pas l’apanage des peuples nomades. Les recherches historiques [2] soulignent combien les populations du continent ont affronté la distance, toujours prêtes à se mettre en route, à composer avec les aléas et les crises, à trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Il y a là une question de survie, certes, mais il en va aussi d’une stimulante interrogation sur les horizons à dépasser, ce qui est clairement établi, par exemple, dans le champ de l’agriculture, activité longtemps dominante en Afrique. Des travaux déjà anciens ont analysé avec minutie les logiques et les pratiques des paysans démontrant leur capacité d’innovation dans des situations de grande précarité technique [3]. Les dynamiques contemporaines d’une mondialisation qui bouleverse les vieux rapports de forces, loin de marginaliser encore un peu plus les populations africaines, y trouvent au contraire un terrain propice de déploiement [4]. Les Africains ont en effet la capacité de saisir l’ouverture au monde, fût-elle douloureuse, avec une aisance avérée. Se battre pour survivre pousse à aller hors de chez soi. La pratique de plusieurs langues, dans la proximité, crée une aptitude à l’apprentissage de langues plus lointaines. L’oralité tant décriée trouve un nouvel élan dans le déploiement des technologies de la communication [5]. L’art de la récupération se concilie avec la multiplication des fablabs [6].
Les obstacles sur la voie du développement demeurent malgré tout considérables et les défaillances des systèmes de transport freinent toujours la mobilité généralisée, qui est un des fondements de la modernité globalisée. Le développement est intrinsèquement lié au mouvement, si l’on accepte de considérer qu’il est l’ensemble des processus par lesquels une société déploie ses potentialités dans l’espace et la durée, dans une diffusion des libertés fondamentales [7]. Dès lors, nul responsable africain ne peut refuser d’affronter la question des circulations en la plaçant en tête des réflexions et des actions à mettre en œuvre pour répondre aux attentes de populations en croissance et en souffrance. Depuis les indépendances, les politiques dites de développement promues par les institutions internationales ont mis l’accent sur l’alimentation, l’éducation, la santé, l’accès à l’eau, le logement, etc. Face aux urgences des situations de précarité radicale, de telles orientations demeurent inscrites dans tous les textes officiels des institutions africaines. Mais toutes ces actions entreprises au profit des populations les plus vulnérables ont été limitées dans leur déploiement par la fermeture territoriale que provoque l’absence d’infrastructures et de moyens de transport. Or, sans ouverture physique, les investissements, aussi bien dans la production que dans les actions sociales et humaines de proximité, subissent des entraves préjudiciables à leur réussite. Le transport, et plus largement la logistique qui l’englobe, est une condition sine qua non pour répondre aux attentes des populations, y compris dans leur volonté de devenir des acteurs économiques productifs. La route est physiquement et symboliquement le vecteur de l’innovation, de l’amélioration des conditions de vie, de la croissance, composante du développement. « Si l’Afrique était dotée des mêmes infrastructures de base que les pays développés, elle serait mieux en mesure de se consacrer à la production et à l’amélioration de la productivité pour faire face à la concurrence internationale. Les insuffisances structurelles des infrastructures handicapent sérieusement la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Améliorer les infrastructures, y compris le coût et la fiabilité des services, serait dans l’intérêt de l’Afrique comme de la communauté internationale, qui pourrait obtenir des biens et services africains à meilleur marché. » [8]
Un outil de réponse à l’urgence régionale
Dans les premières décennies qui ont suivi les indépendances, les politiques de transport n’ont pas été au cœur des investissements, quels que soient les discours et les incantations sur la nécessité de doter les territoires d’infrastructures pour répondre à l’exigence de la construction nationale et aux attentes des citoyens en matière de mobilité. Les financements ont même manqué pour assurer la seule maintenance de l’existant légué par quelques décennies de colonisation. Les infrastructures en ont pâti, en particulier dans le domaine des transports ferroviaires, qui auraient dû être un fer de lance de l’ouverture des territoires [9]. Depuis vingt ans environ, les chantiers se multiplient, ouvrant les territoires enclavés et permettant aux marchés régionaux de gagner en fluidité, autorisant aussi les populations à se rapprocher de l’administration, de l’éducation, des soins, des marchés [10]. Ces politiques de transport signent la reconnaissance par tous les acteurs que le secteur est non seulement vecteur de croissance économique mais aussi de développement humain. La Banque mondiale a ainsi soutenu la création d’observatoires des transports dans le cadre des plans sectoriels qui ont accompagné les plans d’ajustement structurel.
Les programmes qui ont été lancés suivent deux voies différentes mais complémentaires. La première relève d’une approche qu’il est possible de qualifier d’interne [11]. Il s’agit de répondre aux urgences du développement des populations. Ce qui est en jeu, c’est la capacité à créer les conditions d’une meilleure organisation de l’espace de circulation d’une Afrique en phase d’appropriation maîtrisée de son étendue. Sans les transports, infrastructures, mais aussi outils d’animation de ces dernières, les politiques de lutte contre la pauvreté et celles dites d’intégration régionale sont vouées à l’échec. Il s’agit aussi de créer les conditions d’une communauté de destin et d’une solidarité effective matérialisées par des liaisons physiques, dépassant le champ des discours et des incantations. Mais les postures adoptées par les États sont encore bien souvent ambigües. Les gouvernants disent vouloir dépasser le cadre des frontières héritées de la colonisation et entrer dans des processus de construction d’ensembles régionaux [12]. Dans le même temps, ils se crispent toutefois sur le principe de souveraineté nationale, qui commande leurs choix politiques. Or la route fait et conforte le pouvoir. Les choix qui ont été opérés ont concentré les efforts sur la mise en relation des territoires avec le lieu du pouvoir, délaissant ainsi les zones frontières : les franchir par des voies modernes de circulation, c’est faire courir le risque d’une désagrégation territoriale par les forces centrifuges des dynamiques humaines précoloniales. Et pourtant, elles constituent des zones marchandes « d’entre-deux » de toute première importance [13], quelles que soient les faiblesses infrastructurelles déplorées.
Cette posture de repli territorial des infrastructures est aujourd’hui dépassée. Les États, les différentes communautés régionales, l’Union africaine (UA) prônent le lancement de programmes internationaux. Le problème demeure toutefois en partie non résolu. Pour vaincre la distance, obstacle encore majeur du mal-développement, il faut établir le lien là où il est fragile et incertain. L’Afrique est un continent très étendu – 30 millions de kilomètres carrés – et, désormais, très peuplé – 1 milliard d’habitants selon les dernières estimations. Mais l’inégale répartition des êtres et des activités pose la question de la pertinence économique d’investissements très lourds dans des infrastructures de liaison entre les foyers principaux, le plus souvent les capitales. La traversée du Sahara, par exemple, par des axes goudronnés, relève, pour l’instant du moins, d’une volonté politique plutôt que d’impératifs économiques déterminants, encore que le Maroc y trouve un appui à son expansion économique vers le sud, depuis que la route Nouadhibou-Nouakchott, dernier maillon d’un grand axe atlantique, a été ouverte. Cela posé, l’intensité croissante des flux intérieurs est une réalité à laquelle il faut faire face. Il y a nécessité de répondre à cette pression du mouvement que provoquent les inégalités de développement. Peuvent permettre d’y faire face des politiques d’ouverture de routes goudronnées, mais aussi d’aménagement de pistes pour les rendre permanentes.
Les grands projets sont portés par le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA), qui dépend de l’UA. Les investissements majeurs concernent l’ouverture d’axes transafricains. Neuf ont été privilégiés, ordonnés ainsi : 1- Le Caire-Dakar ; 2- Alger-Lagos ; 3- Tripoli-Le Cap ; 4- Le Caire-Le Cap ; 5- Dakar-N’Djamena ; 6- N’Djamena-Djibouti ; 7- Dakar-Lagos ; 8- Lagos-Mombasa ; 9- Beira-Lobito. Établir ces liaisons majeures, sorte de colonne vertébrale de la circulation africaine, ne doit pas dispenser de multiplier les investissements dans les pistes de proximité que réclament de façon constante les populations rurales. Mais tous ces programmes butent sur le maintien de pratiques liées à la corruption. Se pose alors la question des barrières illicites condamnées mais toujours vivaces, comme en témoignent les études de l’Observatoire des pratiques anormales de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).
Répond aussi aux besoins des populations la mise en œuvre de politiques favorables à un renouveau du transport ferroviaire, non seulement pour l’acheminement des marchandises, mais aussi pour le déplacement des personnes. En témoignent l’ouverture de la ligne Addis-Abeba-Djibouti ou encore le gigantesque chantier « East Africa Railway Masterplan » qui, à terme, vise à relier le port de Mombasa, au Kenya, et les capitales des États enclavés du centre de l’Afrique. La Chine en est le constructeur et le principal financeur, par le truchement de l’Exim Bank. En Afrique de l’Ouest, un projet très ambitieux doit relier Cotonou à Abidjan via Niamey et Ouagadougou, avec des « barreaux de raccordement » à Lomé, Accra et Bamako. Ce projet contesté, très onéreux, porté par une ambition privée, celle de l’homme d’affaires français Vincent Bolloré, demeure pour l’instant très embryonnaire et soulève bien des oppositions d’acteurs africains déplorant de ne pas être associés étroitement. Répondent aussi à ces demandes de mobilité toutes les initiatives lancées pour résoudre le problème crucial de l’engorgement des villes, qui peinent à faciliter la circulation de leurs résidents. Si l’art de la débrouille permet de faire face tant bien que mal, la solution n’est pas seulement à chercher dans l’informel. Dans les grandes métropoles, l’urgence est à la mise en place de réseaux de transports collectifs modernisés et performants, ce qui est encore loin d’être le cas [14].
Un outil d’insertion dans la mondialisation
Le deuxième enjeu est celui de l’ouverture au monde. L’Afrique s’ancre dans la mondialisation marchande. Certes, elle représente seulement 3 % des échanges mondiaux qui s’opèrent pour plus de 90 % par la voie maritime. Mais les opérateurs économiques mondiaux ont besoin des richesses naturelles d’un continent qui en regorge, alors que les citoyens africains ont des besoins croissants, non seulement pour faire face aux pénuries alimentaires encore trop fréquentes, mais aussi pour s’équiper en biens matériels de toute nature, biens matériels produits hors du continent et surtout en Chine. Les flux mondialisés sont donc désormais l’une des composantes déterminantes du fonctionnement des économies africaines, ouvertes, de plein gré ou par soumission à des rapports de forces inégaux [15].
Cela nécessite des ports qui puissent permettre ces échanges. Le port n’est pas une simple enclave de la mondialisation marchande. Il est aussi le cœur qui pulse des flux irriguant tout le territoire qui constitue l’arrière-pays. Les projets ambitieux pullulent [16]. Parmi les plus importants, peuvent être cités les programmes de développement portuaire du Kenya (Lamu, pour 24 milliards de dollars), de Tanzanie (Bagamoyo, pour 10 milliards de dollars), du Cameroun (Kribi, pour 10 milliards de dollars), du Mozambique (Nacala, pour 5 milliards de dollars ; Beira, pour 1,5 milliard de dollars) de Tunisie (Enfidha, pour 1,8 milliard de dollars), du Nigeria (Badagry, pour 1,3 milliard de dollars ; Lekki, pour 1,4 milliard de dollars). Lors des appels internationaux à projets portuaires, les grands groupes de la logistique mondiale emportent les marchés (Bolloré, DPW ou APM), mais il y a désormais des alliances entre capitaux mondialisés et entrepreneurs africains solidement établis [17]. Les entreprises chinoises sont omniprésentes pour les infrastructures terrestres, routes et voies ferrées. Elles sont encore peu présentes dans les activités maritimes et portuaires en tant qu’opérateurs de terminaux, mais le sont en tant que sociétés de génie civil et de travaux publics. Le risque d’une telle course à l’investissement portuaire est toutefois celui d’une surcapacité portuaire. En outre, ouvrir de nouveaux ports, ou plutôt de nouveaux terminaux suppose une meilleure desserte de ceux-ci au sein de mégalopoles en expansion rapide et déjà congestionnées par la surimposition des flux mondialisés aux flux urbains. Il faut aussi ouvrir des voies de pénétration intérieure de meilleure qualité et plus nombreuses, routières certes mais également ferroviaires. Le concept spatial de corridor, associé à celui de port sec, s’affirme ainsi comme un paradigme de l’aménagement contemporain de l’Afrique [18].
L’autre outil de l’ouverture au monde, le transport aérien intercontinental, est devenu l’une des clés de l’ancrage de l’Afrique à la mondialisation. Les États ont cherché à créer des compagnies nationales, à l’exception près d’Air Afrique, compagnie multinationale qui rassemblait les États issus de l’empire colonial français. Cette dernière, qui fut en son temps une réussite et la démonstration de possibles coopérations entre États, a subi les effets des revendications nationales centrifuges et a disparu faute de soutiens effectifs, y compris de la part d’Air France, qui participait à son capital. Désormais, se déploient de nouvelles lignes aériennes entre les grandes villes, portées par des compagnies émergentes et qui ne sont pas toutes, loin s’en faut, placées sur les listes noires de l’Europe – par exemple Arik Air, Asky, Air Côte d’Ivoire, RwandAir, etc. Certaines d’entre elles, à peine plus jeunes que les grandes compagnies aériennes mondiales, se sont imposées dans le ciel africain et sont entrées dans les grandes alliances qui se partagent le transport aérien mondial. C’est le cas d’Ethiopian Airlines, de Kenya Airways, de Royal Air Maroc, de South African Airways, d’Egyptair, etc. À côté des vieilles compagnies européennes, d’autres acteurs interviennent avec succès en Afrique, tels Turkish Airlines ou Emirates. L’attraction de l’Afrique pour toutes ces compagnies qui lui sont extérieures démontre la confiance des intérêts privés aériens dans la croissance de ce continent et, à terme, lui permet de se libérer d’une tutelle européenne trop contraignante. Les aéroports eux-mêmes sont devenus des enjeux pour les grands opérateurs de terminaux d’échelle mondiale dans le cadre de privatisations ou de partenariats public-privé [19]. Ces aéroports africains gèrent toutefois des trafics assez faibles comparés à ceux des grands hubs mondiaux. Émergent peu à peu quelques grandes places aéroportuaires, hubs actifs des grandes compagnies nationales. Aux premiers rangs se situent Johannesburg, Le Caire, Lagos, Addis-Abeba, Casablanca, Nairobi, Alger, Tunis, avec plus de 5 millions de passagers annuels.
*
Les transports sont enfin reconnus comme un des piliers du développement. Les interrogations que pose leur rôle dans l’avenir de l’Afrique se renouvellent. Il n’est plus seulement question d’infrastructures. La première d’entre elles est d’ordre environnemental et, par conséquent, d’ordre social. Les nuisances qui accompagnent la croissance des flux obèrent lourdement les attentes en termes d’amélioration de la qualité de vie. Nouvelle voie d’expression des opinions publiques émergentes, les réseaux sociaux s’en sont d’ailleurs fait le relais. Il s’agit des pollutions qui se diffusent dans les villes, avec leurs charges de gaz à effets de serre et leurs particules lourdes et fines, de la récupération et du retraitement des fluides de toutes natures consommés par les mécaniques automobiles, du maintien en circulation de véhicules anciens, de la sécurité routière dans un continent qui atteint des sommets en matière d’accidentologie, de la surcharge des poids lourds détériorant les axes à peine livrés à la circulation, etc.
La deuxième grande question est celle du passage de l’analyse des circulations en termes de transport à l’analyse en termes de logistique. La pression des opérateurs mondialisés, commandée par la généralisation de la supply chain management, de l’organisation des réseaux en hubs and spokes, de la dématérialisation des flux documentaires accompagnant tout acte de transport, bouleverse les pratiques usuelles. Derrière cette question d’adaptation à de nouvelles modalités d’organisation et de fonctionnement, s’impose celle de la formation des acteurs et des agents du transport. La complexité croît, non seulement dans les ports et les aéroports mais aussi dans la gestion des flux internes au continent africain, sur la route principalement. Le secteur économique de la logistique et du transport est devenu un foyer d’appel pour de nombreux jeunes Africains. L’Afrique dispose aujourd’hui de cadres, de techniciens, d’ingénieurs compétents dans le transport et la logistique, soucieux du développement de leur continent, mais ils sont encore trop peu nombreux : la formation demeure donc un défi à relever dans un champ d’activité aux puissants effets d’entraînement.
- [1] Voir Georges Courade, L’Afrique des idées reçues, Paris, Belin, coll. « Mappemonde », nouvelle édition, 2016.
- [2] Voir Catherine Coquery-Vidrovitch et Henri Moniot, L’Afrique noire, de 1800 à nos jours, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio », 2005.
- [3] Voir le dossier dirigé par Paul Pélissier et Gilles Sautter, « Terroirs africains et malgaches », Études rurales, n° 37-38-39, École pratique des hautes études, janvier-septembre 1970 ; « Maîtrise de l’espace agraire et développement en Afrique tropicale. Logique paysanne et rationalité technique. Actes du colloque de Ouagadougou (4-8 décembre 1978) », Mémoires, n° 89, Paris, Éditions de l’ORSTOM, 1979 ; et Chantal Blanc-Pamard et al., Le développement rural en questions, Paris, Éditions de l’ORSTOM, 1984.
- [4] Voir Philippe Hugon, L’économie de l’Afrique, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2013.
- [5] Voir Annie Chéneau-Loquay, « L’Afrique au seuil de la révolution des télécommunications. Les grandes tendances de la diffusion des TIC », Afrique contemporaine, n° 234, De Boeck, 2010 / 2.
- [6] Voir le site innovafrica.org
- [7] Amartya Sen, Development as Freedom, New York, Oxford University Press, 2001
- [8] Texte du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), adopté à Abuja en octobre 2001, section B1, 98.
- [9] Jean-Louis Chaléard, Chantal Chanson-Jabeur et Chantal Béranger (dir.), Le chemin de fer en Afrique, Paris, Karthala, 2006.
- [10] Un exemple des effets de la révolution combinée des transports et de la téléphonie mobile illustre la vigueur des processus d’ouverture territoriale. Des commerçants maures de Nouadhibou, en Mauritanie, vendent désormais du poisson sur les marchés de Bamako, à environ 1 900 kilomètres de distance, grâce à l’ouverture de routes goudronnées qui relient les deux villes à travers le désert et le Sahel. Des véhicules frigorifiques parcourent le trajet en un peu plus de trente heures, à la satisfaction des producteurs et des clients (enquêtes de terrain conduites en 2008).
- [11] Jérôme Lombard et Olivier Ninot, « Des mobilités aux transports. Regards croisés en Afrique de l’Ouest », EchoGéo (en ligne), n° 20, avril-juin 2012.
- [12] Charlie Mballa et Issiaka Mande (dir.), « L’Afrique est-elle partie ? Bilan et perspectives de l’intégration africaine », Revue Interventions économiques, hors-série, mars 2017.
- [13] Emmanuel Grégoire et Pascal Labazée (dir.), Grands commerçants d’Afrique de l’Ouest, Paris, Karthala – ORSTOM, 1993.
- [14] Xavier Godard, Les transports et la ville en Afrique au Sud du Sahara, Paris, Karthala, coll. « Économie et développement », 2002.
- [15] Olivier Hartmann, « Comment les pays enclavés s’articulent-ils à la mondialisation ? », Afrique contemporaine, vol. 234, n° 2, 2010.
- [16] Voir le dossier « Le secteur portuaire en Afrique : plein cap sur le développement », Secteur privé & développement. La revue de Porparco, n° 26, mars-avril-mai 2017.
- [17] Voir Benjamin Steck, « Introduction à l’Afrique des ports et des corridors : comment formuler l’interaction entre logistique et développement », in Pierre André, Georges Lanmafankpotin, Samuel Yonkeu et Sandrine Gilles (dir.), « L’Afrique : environnement, développement, sociétés », Cahiers de géographie du Québec, vol. 59, n° 168, décembre 2015.
- [18] Yann Alix (dir.), Les corridors de transport, Cormelles-le-Royal, Éditions EMS, coll. « Océanides », 2012.
- [19] Voir Benjamin Steck, « La desserte aérienne de l’Afrique, entre oligopole européen et nouveaux acteurs africains », in Bruno Lecoquierre et Eric Wauters (dir.), Métamorphoses du voyage et de l’exotisme du XVIIIe siècle à nos jours, Rouen, Presses universitaire de Rouen et du Havre, 2015.

