Septembre 2017
Désenclaver pour mieux régner ? Rivalité des grandes initiatives régionales en Asie centrale / Par Samuel Carcanague
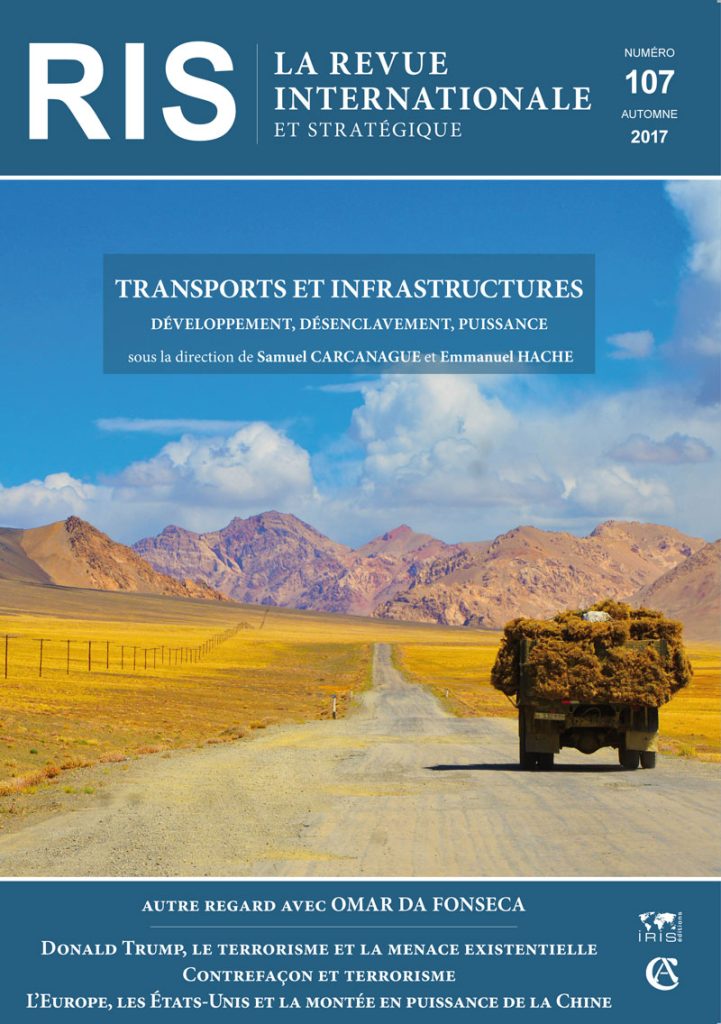 Transports et infrastructures : développement, désenclavement, puissance
Transports et infrastructures : développement, désenclavement, puissance
RIS N°107 - Automne 2017
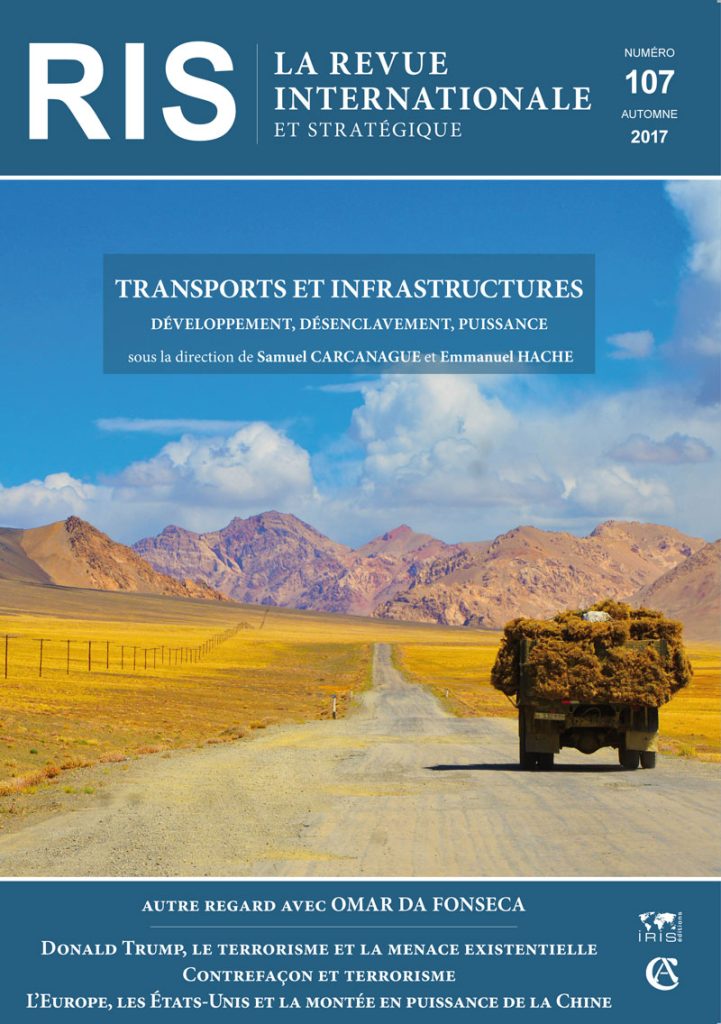
L’Asie centrale [1] possède, dans l’imaginaire européen comme asiatique, une place à part lorsque sont évoquées les questions de commerce et de transport internationaux. Elle fut en effet traversée par les routes de la soie, reliant, à partir du IIIe siècle de notre ère, les deux extrémités du continent eurasiatique dans ce qui constituait les prémices de la mondialisation des échanges. L’Asie centrale tirait alors profit de sa position géographique entre Europe et Asie, ce qui participa à la constitution d’un patrimoine d’infrastructures, au premier rang desquelles les caravansérails, relais pour les hommes, les bêtes et les marchandises, saupoudrés le long des différents trajets des vallées balkaniques jusqu’aux steppes du Kazakhstan. À partir du XVIe siècle, le rôle de l’Asie centrale dans le commerce mondial se réduit considérablement, en raison notamment du développement des routes maritimes entre Europe et Asie. Le centralisme des périodes tsariste et soviétique transforme ensuite la région davantage en une périphérie plutôt qu’en un hub de transit, avec des infrastructures de transport, routières et ferroviaires orientées principalement vers la Russie.
La dislocation de l’Union soviétique, en 1991, fait réapparaître le potentiel de la zone centrasiatique pour être un « pont » entre Europe et Asie. Au-delà des nouvelles frontières qui redessinent la centralité géographique de la région, la montée en puissance de l’Asie sur le plan commercial, et de la Chine en particulier, semble offrir une rationalité supplémentaire à la réactivation du vieux mythe des routes de la soie, symbole d’une vision apaisée et consensuelle du commerce international. Cet imaginaire positif a participé à mobiliser les différents acteurs – gouvernements locaux, institutions internationales, pays tiers – autour d’une réactivation à la fois rhétorique et pratique d’une référence culturelle commune au-delà même de l’ensemble du continent eurasiatique. Le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l’Inde et les États-Unis ont chacun à leur manière invoqué cette référence (« Silk Road », en anglais), au prix d’une déformation plus ou moins importante de la réalité historique. La Russie, en revanche, préfère s’appuyer sur le concept d’Eurasie, dont la généalogie s’inscrit davantage dans l’histoire de sa pensée politique [2].
Dès lors, le désenclavement de l’Asie centrale devient un objectif de développement que partagent les institutions internationales et les grandes puissances actives dans la région. De multiples projets voient ainsi le jour pour favoriser la coopération régionale et développer, entre autres, des infrastructures de transport, soutenus par divers pays extérieurs à la région ou par des organisations financières internationales. Ils sont considérés comme l’un des outils essentiels pour parvenir à son développement, à sa prospérité et à sa sécurité. Mais ils révèlent ou entraînent également des enjeux de puissance et des rivalités géopolitiques entre acteurs qui dépassent de loin la simple problématique des transports.
Une multiplication des projets dans l’espace centrasiatique
Les infrastructures, objectif de développement dès les années 1990
Une conjonction de facteurs a conduit à la multiplication des projets d’infrastructures de transport en Asie centrale depuis une vingtaine d’années [3] : émergence de la Chine sur la scène régionale puis internationale à la suite de l’ouverture de son économie dès la fin des années 1970, disparition de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), volonté des nouveaux États indépendants de multiplier les partenaires en matière de commerce et de développement, etc. Au début des années 1990, les autorités locales ainsi que différentes institutions financières régionales et internationales font le constat de l’enclavement des États nouvellement indépendants de la région, qui freine leur développement et leur insertion dans le système économique en cours de mondialisation. La volonté de s’émanciper de la Russie de la part des pays centrasiatiques rejoint la volonté des pays occidentaux de voire diminuer son influence dans la région. L’un des objectifs est par ailleurs d’en favoriser la stabilité, alors que certains conflits menacent voire éclatent, notamment au Tadjikistan [4]. La construction d’infrastructures de transport est alors perçue comme l’un des préalables pour développer l’activité économique régionale, dont le corollaire serait l’amélioration des conditions politiques, sociales et sécuritaires.
L’Union européenne (UE) est la première à lancer, en 1993, une initiative pour améliorer les infrastructures de transport dans les nouveaux États indépendants d’Asie centrale, à travers le programme TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucase-Asie), toujours en place aujourd’hui. Celui-ci réunit à la fois les pays centrasiatiques, mais également du Caucase, ainsi que certains pays d’Europe orientale (Ukraine, Moldavie) et la Turquie. Il bénéficie de l’apport financier de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et de la Banque asiatique de développement (BAD). Toutefois, les sommes engagées directement par la Commission européenne – 178 millions d’euros répartis sur 85 projets [5] – apparaissent particulièrement modestes en comparaison avec celles affichées dans le cadre des initiatives chinoises (voir infra).
En 2001, c’est au tour de la BAD de lancer, sous l’impulsion du Japon, le programme Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC). Plus ambitieux que le TRACECA, il réunit six institutions multilatérales (BAD, BERD, Fonds monétaire international, Banque islamique de développement, Programme des Nations unies pour le développement, Banque mondiale) autour de ses 11 membres : les cinq pays d’Asie centrale, l’Azerbaïdjan, la Géorgie – depuis 2016 –, l’Afghanistan, le Pakistan, la Mongolie et la Chine. Sur la période 2011-2015, le montant des projets financés atteint 27,7 milliards de dollars, 78 % de ces investissements étant consacrés au secteur des transports, principalement routiers et ferroviaires [6].
Les États-Unis ont également, dès la fin de la guerre froide, investi le champ rhétorique de la « route de la soie » à travers les Silk Road Strategy Acts de 1999, puis de 2006, qui prônent un développement Est-Ouest liant Asie centrale et Caucase. Cette stratégie visait trois objectifs principaux : réduire la dépendance de ces pays à la Russie, éviter que l’Iran ne devienne un hub du commerce régional et permettre à la Turquie de jouer un rôle plus important dans la zone [7]. Alors que le contexte régional et les priorités américaines évoluent avec l’intervention internationale en Afghanistan, le désenclavement de l’Asie centrale devient, pour les États-Unis, un facteur de développement et de stabilisation pour toute l’Asie du Sud. La secrétaire d’État Hillary Clinton annonce ainsi, lors d’un discours en Inde en juillet 2011, le lancement de la « New Silk Road », sur un axe Nord-Sud, lié en partie au Northern Distribution Network, qui assurait l’approvisionnement de la Force internationale d’assistance et de sécurité (FIAS) en troupes et en matériel à partir de la mer Baltique jusqu’à la frontière Nord de l’Afghanistan. L’absence conjointe de rationalité économique sur le plan régional [8] et de réelle volonté politique du gouvernement américain – qui semble se confirmer avec l’administration du président Donald Trump – ne fait de ce projet qu’un concurrent mineur face aux initiatives russe et chinoise, et dans une certaine mesure japonaise et coréenne, qui possèdent en outre l’avantage d’être menées par un acteur régional.
2010, décennie des infrastructures centrasiatiques
Selon un rapport de la BAD, l’Asie aurait besoin, pour maintenir sa croissance, de 26 000 milliards de dollars d’investissements entre 2016 et 2030, dont presque 15 000 dans l’énergie et plus de 8 000 dans le secteur des transports [9]. Pour la seule Asie centrale, l’organisation recommande 38 milliards d’investissements annuels. Si elles n’atteignent pas encore ces chiffres, les initiatives régionales ou globales se multiplient néanmoins depuis le début des années 2010. Elles émanent principalement des pays asiatiques – Chine, Corée du Sud, Japon –, dont les acteurs économiques, financiers et industriels peuvent bénéficier de ces grands projets.
En septembre 2013, le président chinois Xi Jinping annonce, dans la capitale kazakhstanaise Astana, son initiative Silk Road Economic Belt (SREB), complétée un mois plus tard par l’annonce en Indonésie d’une 21st Century Maritime Silk Road. Les deux sont désormais réunies sous l’appellation Belt and Road Initiative (BRI) [10], devenue un projet global, structurant de la politique étrangère chinoise. Cette initiative est soutenue par les banques publiques chinoises, par un fonds souverain spécialement créé en 2014 (Silk Road Fund), qui devrait atteindre une capitalisation de 55 milliards de dollars et, à partir de 2016, par la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB), capitalisée à hauteur de 100 milliards de dollars.
Cette initiative ambitieuse vise à développer les infrastructures de transport et les facilités de commerce entre la Chine et l’Europe le long d’une « route » maritime et d’une « ceinture » terrestre traversant l’Asie centrale. Outre les bénéfices pour les entreprises chinoises, l’objectif est notamment de faciliter l’accès de la Chine aux marchés moyen-orientaux, russes et européens par voie terrestre et de permettre d’acheminer, dans le sens inverse, les matières premières centrasiatiques (hydrocarbures, or, uranium, terres rares) vers le territoire chinois. Plus spécifiquement, la SREB constitue également un moyen pour Pékin de faire du Xinjiang, province occidentale pauvre et soumise à des tensions ethniques entre majorité han et minorité musulmane ouïgoure, un hub de son expansion vers l’Eurasie, afin de l’intégrer davantage dans le système économique national et d’en favoriser le développement et la stabilité sociale. Enfin, les autorités chinoises voient dans la construction d’infrastructures à l’étranger le moyen d’écouler les surcapacités industrielles de leur pays, notamment dans le secteur de la construction.
Bien que la BRI ait considérablement mobilisé l’attention médiatique et politique mondiale – ou du moins occidentale –, il convient de relever que deux projets du même type ont été lancés par la Corée du Sud et le Japon. L’Eurasia Initiative, destinée à financer les infrastructures de transport en Asie centrale notamment, a même été annoncée par la présidente sud-coréenne Park Geun-hye en octobre 2013, un mois après la SREB. Là encore, l’imaginaire des routes de la soie a été convoqué, en soulignant les liens anciens entre la Corée du Sud et l’Asie centrale – et en particulier l’Ouzbékistan. La Corée du Sud tire notamment profit de son développement économique accéléré depuis les années 1980-1990, affiché en modèle – et dont la dimension autoritaire passée n’échappe pas aux régimes centrasiatiques, qui peuvent y voir une légitimation de leurs pratiques pour le bien de leur pays [11]. Deux défis demeurent toutefois pour Séoul : la concurrence de la BRI chinoise, qui n’inclue pas la péninsule coréenne – la Corée du Sud a d’ailleurs été invitée à la dernière minute au Silk Road Forum organisé par la Chine en mai 2017, bien qu’elle soit membre de l’AIIB depuis 2015 – et la Corée du Nord, qui constitue littéralement un obstacle au développement d’un lien terrestre avec le reste de l’Eurasie.
Enfin, le Japon est le dernier pays asiatique à avoir annoncé son initiative en faveur du développement des infrastructures dans le monde, et notamment en Asie, en 2015, avec le Partnership for Quality Infrastructure, en lien avec la BAD, puis l’Expanded Partnership for Quality Infrastructure en mai 2016. L’objectif est de fournir près de 110 milliards de dollars d’investissements d’ici à 2020. Longtemps classé parmi les premiers donateurs en matière d’aide au développement en Asie, Tokyo tente de se distinguer des autres initiatives en promouvant des infrastructures durables et les hautes-technologies. À ce titre, l’accent mis sur la « qualité » plutôt que sur la « quantité » vise directement l’approche chinoise [12].
Cette prolifération d’initiatives en matière d’infrastructures soulève un certain nombre de questions sur leur coordination et sur la pertinence des projets qu’elles mettent en œuvre. Le CAREC, qui compte parmi les programmes de coopération régionale les plus anciens et les plus fonctionnels en matière d’infrastructures, se pose par exemple ouvertement la question de son positionnement envers ces différentes initiatives [13]. Or, c’est bien l’interrogation fondamentale à laquelle doit désormais faire face l’Asie centrale : comment appréhender ces différents projets, dont les objectifs et les moyens semblent être en concurrence ?
Le désenclavement centrasiatique, terrain d’affrontement géopolitique
Ces différents programmes d’investissements massifs dans les infrastructures, au premier rang desquels la BRI chinoise, charrient évidemment des enjeux de puissance et d’influence. Nombreuses sont ainsi les interrogations sur les conséquences géopolitiques que la concrétisation de ces différents projets pourrait soulever. Car si la BRI, par exemple, est présentée comme un projet « gagnant-gagnant » par les autorités chinoises, la réalité de son financement reflète la prédominance de Pékin, tant en matière de décision que de réalisation [14]. Les autres projets, qu’ils soient américain, coréen, japonais ou européen, relèvent de la même logique. De plus, des investissements étrangers dans des infrastructures stratégiques dans les secteurs de l’énergie et des transports, à destination d’économies dépendant largement de l’exportation de matières premières et de l’importation de biens manufacturés, conduisent inévitablement à une forme d’influence politique [15]. L’exemple de la BRI chinoise est particulièrement frappant à cet égard.
Or, cette potentielle influence politique chinoise en Eurasie est relativement nouvelle. Le poids économique de la Chine a certes considérablement augmenté, mais Pékin n’était pas perçue, jusqu’au début des années 2010, comme un acteur essentiel du jeu politique régional. Sa volonté de circonscrire son action au seul domaine économique distinguait jusqu’alors son approche de celle des États-Unis et de leur New Silk Road Initiative. Cette dernière était un projet basé sur une vision de l’Eurasie liée aux intérêts américains en Afghanistan et à la rivalité entre Washington et Moscou. Le fait de lier le désenclavement de l’Asie centrale au développement de connexions avec l’Asie du Sud correspondait ainsi davantage à la poursuite d’un projet géopolitique qu’à la réalisation d’un objectif de développement économique rationnel. C’est l’un des éléments qui explique aujourd’hui son atonie.
En réalité, au vu de cette initiative américaine quasi mort-née, du rôle très modeste de l’UE, et d’initiatives japonaises et coréennes encore trop récentes pour avoir un réel poids, la question d’une potentielle confrontation entre la BRI chinoise et d’autres projets se pose principalement autour de son articulation avec les intérêts de la Russie dans la zone et son projet d’intégration régionale : l’Union économique eurasiatique (UEE).
L’UEE diffère fondamentalement de la BRI. Lancée le 1er janvier 2015, elle est un projet d’intégration économique inspiré de l’Union européenne, qui découle d’une série de projets institutionnels et d’accords commerciaux élaborés dans les années 1990 et 2000. Elle rassemble la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et l’Arménie dans un espace économique commun, favorisant la circulation des biens et des personnes. Outre la résonnance historique que l’organisation peut avoir avec l’URSS, la conjonction de son lancement avec l’aggravation des tensions russo-occidentales a participé à donner à l’UEE une dimension politique, voire idéologique, que par ailleurs certains de ses membres comme le Kazakhstan et la Biélorussie réfutent vigoureusement.
Ces éléments distinguent donc fortement l’UEE de la BRI, qui se veut apolitique et désinstitutionnalisée, et qui n’est pas, à proprement parler, un projet d’intégration régionale. Malgré cela, la Russie a observé avec méfiance et inquiétude le lancement de la BRI en septembre 2013 : ce projet venait souligner son déclassement économique en Asie centrale au profit de la Chine et, plus largement, la montée en puissance chinoise sur la scène eurasiatique, bien que Pékin ait toujours soigneusement éviter de remettre en cause le rôle politique et sécuritaire que Moscou y joue.
La question de la coexistence et de la coopération des deux projets dans la zone centrasiatique s’est ainsi très vite posée. Pour la Russie, la BRI possède plusieurs atouts : elle offre des capacités financières qu’elle-même ne peut proposer à ses partenaires – notamment depuis la chute des cours des hydrocarbures en 2014, qui a fortement réduit ses marges de manœuvres – et qui participeront à améliorer les infrastructures et fluidifier les échanges au sein de l’UEE ; elle ne remet pas en cause le monopole russe sur les questions politico-sécuritaires en Asie centrale et permet une reconnaissance institutionnelle de l’UEE en tant qu’organisation régionale crédible et légitime [16]. De plus, une coopération avec la BRI s’inscrit dans la logique de pivot vers l’Asie décidée par Vladimir Poutine en 2014, et permet au pays d’afficher sa prise de distances avec l’Occident. Ainsi le Kremlin a-t-il décidé d’adopter, après une période de flottement, une attitude conciliante et coopérative à l’égard de la BRI. En mai 2015, les présidents russe et chinois ont annoncé que l’UEE serait le principal interlocuteur pour la mise en place de la BRI dans les pays membres. Un fonds commun de 10 milliards de dollars pour des projets transfrontaliers a même été créé en juillet 2017 [17].
Si les deux gouvernements insistent sur la complémentarité entre les deux projets, la réalité démontre néanmoins que les potentiels sujets de confrontation entre Russes et Chinois autour de la BRI ne manquent pas. Sur le fond, les deux projets ne relèvent pas de la même représentation du monde et de l’économie : la BRI promeut le libre-échange et la connectivité dans une vision positive de la mondialisation, tandis que l’UEE s’inscrit davantage dans une vision protectionniste d’un monde divisé en pôles économiques et civilisationnels qu’il s’agit de préserver. En pratique, cela s’illustre par le souhait exprimé par la Chine d’établir une zone de libre-échange avec l’Asie centrale – dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) –, ce à quoi la Russie s’oppose fortement [18]. L’un des objectifs de l’UEE est d’ailleurs précisément de protéger un marché intérieur contre l’afflux de produits chinois.
La manière de procéder pour mener à bien ces initiatives est également fondamentalement différente : la BRI s’appuie principalement sur des discussions bilatérales autour de projets, parfois déjà existants. Outre les opportunités qu’elle offre aux entreprises chinoises, elle s’apparente à un label au service de la diplomatie publique développée par Pékin autour des valeurs de mondialisation positive précédemment citées. L’UEE, en revanche, se construit de manière bien plus « classique », en tant qu’organisation régionale basée sur les États, qui délèguent certaines de leurs prérogatives à des organes supranationaux.
La souplesse conceptuelle de la BRI trouve une illustration dans la diversité des tracés chinois au-delà de l’Asie centrale. La SREB est en effet constituée de trois routes principales dans la région : au Nord, passant par la Russie et la Biélorussie ; au centre, joignant le Kazakhstan, le Caucase et la Turquie ou l’Ukraine en passant par la mer Caspienne ; au Sud par le Turkménistan et l’Iran. Chacune des routes possède déjà des infrastructures ferroviaires de fret qui ont été testées, mais dont la rationalité économique reste à démontrer. La justification de ces tracés répond en effet, pour l’instant, davantage à des préoccupations politiques qu’économiques. L’activation d’une ligne de fret Ukraine-Chine passant par la Caspienne et évitant la Russie constitue ainsi un message à destination de Moscou : la Chine, jouant de l’aspect global, supposé apolitique et multivectoriel de sa BRI, entend multiplier les options et les partenaires, quelles que soient les relations qu’ils entretiennent entre eux, sur la seule base de ses propres intérêts.
*
Les projets d’infrastructures de transport représentent au premier abord des projets consensuels – notamment au niveau des gouvernements –, dont le récit est limpide sur le rapprochement des peuples et des cultures, immédiatement compréhensible par tous, symbole d’une vision égalitaire, « gagnante-gagnante » du développement et de l’économie. Alors que l’immense majorité des projets de la BRI attendent encore leur réalisation concrète, leur dimension géopolitique ne doit toutefois pas être sous-estimée dans l’évaluation de leur potentiel de succès. La coordination, coopération ou confrontation éventuelle avec d’autres projets de développement ou d’intégration régionale doit faire l’objet d’une attention particulière. De manière plus globale, outre leur rationalité économique, les impacts politiques et sociaux de ces initiatives dans les pays d’Asie centrale – et ailleurs – devront être observés de près, tant le jeu des acteurs locaux autour de ces projets – enjeux de pouvoir, corruption – et leur perception par les populations – ressentiment antichinois par exemple – pèseront sur leur concrétisation.
- [1] L’Asie centrale est considérée ici comme réunissant Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan.
- [2] Marlène Laruelle, « The US Silk Road : geopolitical imaginary or the repackaging of strategic interests ? », Eurasian Geography and Economics, vol. 56, n° 4, 2015.
- [3] S. Frederick Starr, Svante E. Cornell et Nicklas Norling, « The EU, Central Asia and the developpment of continental transport and trade », Silk Road Paper, Central Asia-Caucasus Institute, décembre 2015.
- [4] Le Tadjikistan a connu une guerre civile de 1992 à 1997, dont les conséquences se ressentent encore aujourd’hui.
- [5] D’autres financements, notamment de la BERD et des pays membres de TRACECA complètent ceux de l’UE, mais les chiffres demeurent faibles en comparaison.
- [6] CAREC, Development Effectiveness Review 2015, Manille, Banque asiatique de développement, 2015.
- [7] Marlène Laruelle, op. cit.
- [8] Sebastien Peyrouse et Gaël Raballand, « Central Asia : the New Silk Road Initiative’s questionable economic rationality », Eurasian Geography and Economics, vol. 56, n° 4, 2015.
- [9] Banque asiatique de développement, Meeting Asia’s infrastructure needs, Manille, février 2017.
- [10] L’initiative a longtemps été désignée par la formule « One Belt, One Road » (OBOR) mais le nom a officiellement changé en 2016.
- [11] Balbina Y. Hwang, « A Fork in the Road ? Korea’s and China One Belt, One Road Initiative », Academic Paper Series, Korea Economic Institute of America, 16 novembre 2016.
- [12] Ministry of Economy, Trade and Industry, « Partnership for Quality Infrastructure. Investment for Asia’s Future », Tokyo, 21 mai 2015.
- [13] CAREC, « Mid-term review of CAREC 2020 : a discussion note », avril-mai 2016.
- [14] Alice Ekman, Françoise Nicolas, John Seaman, Gabrielle Desarnaud, Tatiana Kastouéva-Jean, Şerif Onur Bahçecik et Clélie Nallet, « Three Years of China’s New Silk Roads. From Words to (re) action ? », Études de l’IFRI, IFRI, février 2017.
- [15] Mathieu Duchâtel, « Neighbourhood policy : tactics and tools », Chineses Futures : Horizon 2025, EUISS, juillet 2017.
- [16] Mathieu Duchâtel et al., « Eurasian Integration and the EU », in Absorb and Conquer : An EU Approach to Russian and Chinese Integration in Eurasia, Londres, ECFR, 2016.
- [17] « Russia, China form $10bn investment fund », Financial Times, 4 juillet 2017.
- [18] International Crisis Group, Central Asia’s Silk Road Rivalries, rapport n° 245, juillet 2017.

