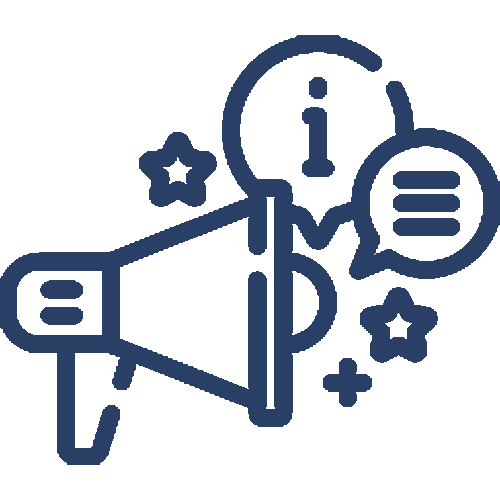Barah Mikail, chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), spécialiste du Moyen-Orient nous explique la stratégie adoptée par l’AQMI pour développer sa visibilité.
Initialement, AQMI était le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC). A l’époque, cette organisation terroriste était cantonnée au milieu maghrébin et en particulier algérien, là où elle est née. La visibilité du GSPC était limitée car leurs actions étaient réduites au niveau local ou régional. L’organisation était en quête de légitimité. Le 25 janvier 2007, au lendemain du meurtre de quatre ressortissants français à Aleg en Mauritanie, le GSPC rejoint Al- Qaïda et devient Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI). Ils ont bénéficié de l’impact et des moyens d’actions d’Oussama Ben Laden en se déclarant filiale d’Al-Qaïda. Le GSPC avait vraiment la volonté de s’approprier un label pour renforcer sa visibilité. En revanche, AQMI n’est pas du tout une création de Ben Laden même si l’idéologie affichée et la rhétorique rejoignent celles des salafistes djiadistes comme lui. Il y a d’ailleurs un parallèle intéressant à faire entre Al- Qaïda au Maghreb Islamique et l’Al-Qaïda en Mésopotamie. Au départ c’est Al Zarqaoui, le fondateur d Al-Tawhid qui a demandé à Ben Laden de le reconnaître. Un aval qu’il a donné par la suite en décembre 2004. C’est le même processus que pour l’AQMI. Ces deux organisations avaient besoin de se réapproprier leur image pour bénéficier de plus d’audience.
Les otages qui font du bruit sont les Occidentaux : les français et les espagnols pour reprendre des exemples récents. En optant pour cette cible, AQMI engage un bras de fer avec les gouvernements occidentaux et s’érige comme un acteur politique potentiel, un interlocuteur. D’ailleurs, sa capacité d’impact est plus forte quand il s’agit d’otages occidentaux. Si AQMI se limitait à une cible régionale comme l’Algérie, le Maroc ou la Mauritanie, les médias y accorderaient moins d’importance. Alors que, dès que des intérêts occidentaux y sont mêlés, il y a un phénomène de réappropriation médiatique. Le public y est plus sensible. Ils ont une véritable capacité de discernement.
AQMI sait pertinemment que négocier avec les Français est plus difficile qu’avec les Italiens ou les Espagnols, qui semblent plus enclins à composer avec eux. Mais difficile de dire quels Etats ont déjà cédé à la demande de rançon. L’option diplomatique clandestine est la méthode usuelle. Aucun pays n’assume de verser l’argent demandé par les ravisseurs. Afficher la possibilité de négocier avec des terroristes, c’est d’abord le risque de voir les prises d’otages réitérées à l’infini. La crainte des urnes est une autre explication. L’opinion publique n’accepterait pas que son gouvernement pactise avec le diable, car négocier revient à valider le processus.
Un enlèvement représente en effet une manne financière. On parle par exemple de 7 ou de 8 millions d’euros pour les otages espagnols. Cet argent, même s’il y a une grande opacité sur les moyens concrets de ce type d’organisation, leur permet d’acquérir des armes. Ils composent parfois avec les armées régionales. Des généraux algériens, malgré la rigidité du pays à l’égard d’AQMI, leur ont déjà fourni, contre de l’argent, des armes.
Pour ces formations terroristes, les gouvernements sont des ennemis parce qu’ils composent avec l’Occident et aussi parce qu’ils développent des moyens de lutte à leur encontre. Dans cette logique, les cibles gouvernementales, comme les agents qui assurent la sécurité, sont souvent victimes d’attaque