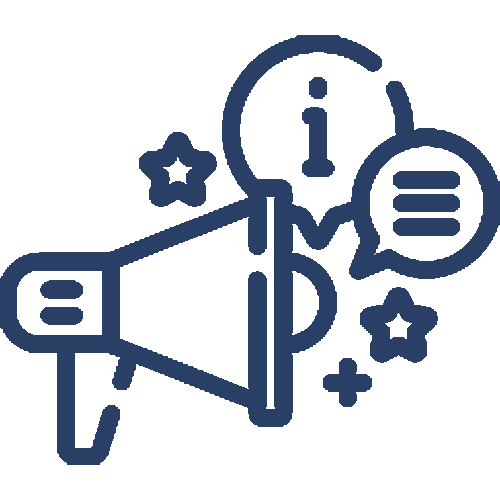Pour le chercheur Barthélémy Courmont, la politique de la main tendue du président américain vers le "monde musulman" est "en partie à l’origine" du succès de la plus grande chasse à l’homme de l’histoire.
– Le printemps arabe est plus lourd de conséquences sur la politique américaine au Moyen-Orient que la mort de Ben Laden. Ce personnage était en effet rejeté par une grande partie de la population de ces pays, et accusé d’incarner le terrorisme transnational et de donner une image négative de l’Islam. Sa mort ne modifie pas cette situation, à l’exception d’un nombre limité – mais actif – de sympathisants qui pourraient en représailles s’attaquer aux autorités politiques des pays du Moyen-Orient.
Mais dans leur majorité, les musulmans avaient tout intérêt à prendre leurs distances avec le chef d’Al-Qaïda afin de ne pas être assimilés à son radicalisme. Sa mort dans un isolement visiblement marqué – et malgré les soutiens dont il bénéficiait nécessairement – est symptomatique de la difficulté du fondateur d’Al-Qaïda à se positionner comme un véritable chef de guerre. Il n’était devenu rien d’autre qu’un fugitif, et ce depuis sans doute le début de l’opération militaire en Afghanistan.
Sur le théâtre d’opérations en Afghanistan, la mort de Ben Laden peut avoir deux effets sur le court et moyen terme.
D’un côté, les insurgés talibans peuvent être démoralisés par la disparition de celui en qui ils voyaient une sorte de guide, même si leur lien avec Ben Laden reste incertain.
De l’autre, par vengeance, il est possible que la mort de Ben Laden entraîne un regain de violence, un peu à la manière de ce qui s’est produit en Irak après l’exécution de Saddam Hussein.
En tout état de cause, la mort de Ben Laden ne marque pas la sécurisation totale de l’Afghanistan, et ne doit pas changer la nature de l’engagement militaire. Il sera simplement indispensable pour les alliés engagés de rappeler que la présence n’était pas uniquement justifiée par la traque d’un homme, mais aussi – et surtout – par la nécessité de reconstruire une société meurtrie par des années de guerre civile et le régime absurde des talibans, sans quoi les opinions publiques pourraient exiger un retrait rapide, et sans avoir préparé l’après.
– La smart diplomacy initiée par Barack Obama dès janvier 2009 est effectivement en partie à l’origine d’un succès comme celui-ci, même s’il ne faut pas négliger le travail des services de renseignement, qui se sont d’une certaine manière rachetés de leur déroute à l’occasion des attentats du 11 septembre 2001, et dans la décennie de déconvenues dans la plus grande chasse à l’homme de l’histoire qui suivit.
La smart diplomacy stipule une plus grande coopération entre les Etats-Unis et ses partenaires, et surtout une plus grande responsabilité de la part des uns et des autres. Washington ne veut plus ainsi se contenter d’imposer ses vues, mais cherche à s’imposer en ravivant le soft power très présent dans les années 1990.
Le contexte international ayant depuis évolué, il était impossible pour l’administration Obama de revenir en arrière sans tenir compte de la nécessité de maintenir une main ferme sur certains dossiers, et c’est ainsi que cet équilibre entre hard et soft power fut trouvé.
En d’autres termes, les Etats-Unis s’efforcent désormais d’attaquer le mal à la racine, plutôt que de renforcer leur impopularité sur le terrain en agissant de manière trop brutale.
Dans le même temps, cette plus grande souplesse ne doit pas être assimilée à une faiblesse, et c’est pourquoi elle s’accompagne de mesures de fermeté. C’est grâce à cette redéfinition de la politique étrangère américaine que les Etats-Unis sont parvenus à reprendre pied au Pakistan, et nous pouvons considérer que c’est grâce à cet effort de coopération qu’un succès comme la mort de Ben Laden fut rendu possible.
Le discours du Caire d’Obama, appelant à un regain de dialogue avec le monde musulman, est symbolique de cette volonté de tendre la main, et de ne plus apparaître comme une puissance hégémonique qui cherche à imposer ses vues. Sans cette redéfinition de la relation de Washington avec ses alliés, il est possible que Ben Laden ait encore longtemps bénéficié du soutien de responsables politiques pakistanais.
– Tout dépend de la manière dont on définit la lutte contre le terrorisme. Si on voit l’empreinte de l’administration Bush, ce double jeu montre effectivement de profondes limites, puisque face aux pressions américaines, les Pakistanais se montraient hésitants, et cette hésitation a profité à Ben Laden – mais aussi sans doute à d’autres.
Barack Obama a apporté un nouveau regard sur cette lutte, en s’associant aux efforts pakistanais et en accompagnant cet effort d’aides au développement renouvelées, sorte de carotte dont ne peut se passer le gouvernement pakistanais.
On voit bien avec cette mise hors d’état de nuire que cette politique porte ses fruits, et que l’approche de George W. Bush, stipulant que l’on soit "avec eux ou contre eux" (les Etats-Unis) ne fonctionnait pas.
Plus fondamentalement, cet exemple démontre l’importance d’une politique de long terme dans la lutte contre le terrorisme, qui ne doit pas se contenter d’un volet sécuritaire et policier, mais s’accompagner de mesures d’aide au développement, sans quoi ce problème se pérennise. Ce n’est qu’à ce prix que la mort de Ben Laden sera, dans la durée, identifiée comme un réel succès dans la lutte contre le terrorisme.