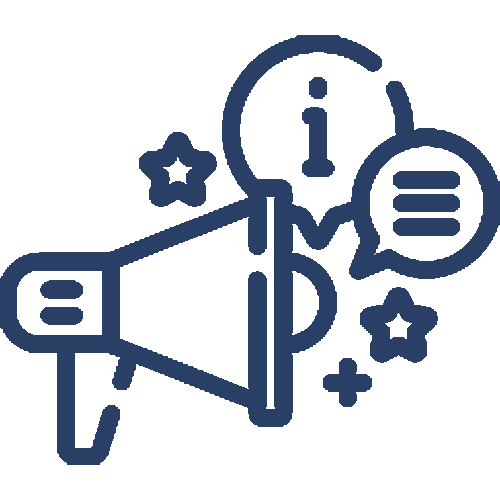Alors que les dernières troupes américaines de combat quittent l’Irak, Barah Mikaïl, chercheur en sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), revient sur les grandes étapes qui restent à franchir dans la transition démocratique de l’Etat irakien, au premier plan desquelles la nomination d’un nouveau premier ministre et d’un gouvernement. Pour le chercheur, si "les communautés veulent maintenir leurs spécificités, la consécration d’un Etat irakien semble être une idée qui fait consensus".
La nomination d’un nouveau premier ministre et d’un gouvernement, toujours en suspens, est une étape cruciale. Le retrait américain implique la nécessité pour l’Irak de montrer sa capacité à exercer ses fonctions souveraines. Or, on constate une grande difficulté des différentes formations politiques irakiennes à se mettre d’accord sur un dirigeant. Il y a un attachement fort à trouver une voie de sortie mais le bras de fer continue de prévaloir. En 2006, lors des précédentes élections législatives, les choses avaient également pris du temps mais les paramètres étaient différents : l’ayatollah iranien Ali al-Sistani, d’une part, et l’Iran, d’autre part, avaient tous deux fait valoir leurs volontés de manière très forte. Aujourd’hui, l’influence de l’Iran est moindre.
Par ailleurs, il y un entêtement manifeste du premier ministre sortant, Nouri al-Maliki, à se maintenir à son poste. Et si en 2009 il tenait un discours transconfessionnel, aujourd’hui, il est le premier à sortir la carte communautaire, expliquant la nécessité d’avoir un chiite au poste de premier ministre.
La nouvelle Constitution consacre un principe de fédéralisation des institutions, mais on ne sait toujours pas selon quelles modalités : est-ce que cela se fera selon des lignes communautaires, avec une majorité kurde qui s’organisera dans le Nord, une majorité chiite dans le Sud et une majorité sunnite dans le Centre ou est-ce que cela pourra se faire sur d’autres niveaux, par exemple celui des dix-huit provinces irakiennes ? Cette question obscurcit un peu l’horizon politique irakien. Un motif de satisfaction est l’amélioration du climat sécuritaire, globalement meilleur malgré un récent regain de tension.
Le risque n’est pas totalement écarté, mais il semblait beaucoup plus fort il y a deux ou trois ans. On a l’impression que les Irakiens sont arrivés à un modus vivendi : les communautés veulent maintenir leurs spécificités, mais la consécration d’un Etat irakien semble être une idée qui fait consensus. Tant que les différentes formations continuent de traiter leurs tensions au sein des institutions, les consacrant comme enceinte des négociations, on reste dans la perspective d’un avenir en commun.
Ce n’est pas le gage d’une amélioration de la situation politique. Par exemple, au niveau énergétique, le gouvernement a déjà entrepris la distribution de différents contrats permettant de faire bénéficier les Irakiens des ressources du pays, mais le processus bute sur l’adoption par le Parlement de la loi sur les hydrocarbures, bloquée depuis 2007. C’est l’illustration des blocages institutionnels que connaît le pays. Au Moyen-Orient, il n’y a pas vraiment d’exemple où l’amélioration de la situation économique résoud une situation politique. C’est prégnant dans les relations israélo-arabes : les modalités de coopération économiques qui ont, par exemple, prévalu entre l’Egypte et la Jordanie et Israël n’ont pas permis de faire progresser le processus de paix. En Irak, les provinces à majorité kurde ont connu une forme de boom économique, mais ce n’est pas pour autant qu’il y a eu une avancée politique bénéficiant à l’ensemble du pays. L’influence est plutôt en sens contraire : les acteurs de la sphère économique attendent la résolution des problèmes politiques pour s’engager.
Certains pays se sentent obligés de développer des politiques d’influence pour limiter les risques qui peuvent découler de la situation. Il y a une nouvelle géopolitique qui est en train de se mettre en place autour de l’Irak et cela n’est pas une très bonne nouvelle pour le pays. La méfiance réciproque entre l’Arabie saoudite et l’Iran passe par l’Irak, la volonté de la Turquie de prendre sa part du gâteau dans le développement de la région et la stratégie qu’elle déploie pour mettre à mal les bases du PKK, la volonté de la Syrie de montrer se puissance… Suivant la personne qui prendra le poste de premier ministre l’un ou l’autre des partis sera favorisé ; dans tous les cas, l’Irak pourra tout sauf prétendre à la neutralité.
Les Etats-Unis sont obligés de faire en sorte que la consolidation des perspectives en Irak apparaisse comme réussie : leur souci premier est de faire coïncider la baisse de leur contingent avec une baisse de la violence et un accord des forces politiques. Mais le processus leur échappe en bonne partie. Ils se trouvent dans une situation difficile : en retirant leurs troupes, ils annoncent vouloir permettre à l’Irak de retrouver sa souveraineté, mais un ensemble de leaders politiques irakiens disent : "Il ne faut pas que les Américains se retirent, nous ne serons pas prêts avant 2020." Il y a une peur de certains responsables de perdre leur posture privilégiée à partir du moment où ils ne bénéficieront plus de la cooptation américaine