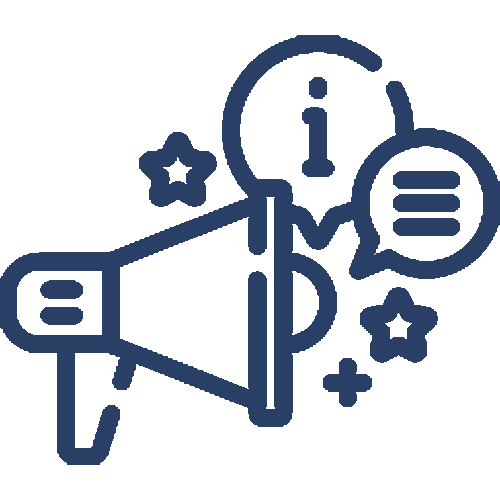Mise au point : Un bombardement nécessaire pour mettre fin à la guerre ?
Au début du mois d’août 1945, les forces militaires japonaises étaient considérablement réduites et dispersées, les capacités industrielles du Japon ne permettaient plus de produire des armes en quantité suffisante et les diplomates japonais étaient engagés dans des pourparlers en vue d’une éventuelle reddition. L’ambassadeur Naotake Sato échangeait avec Moscou qui n’avait pas encore officiellement déclaré la guerre au Japon (elle le fera le 9 août 1945). Tokyo souhaitait également que le prince Fumimaro Konoe (ancien Premier ministre) se rende à Moscou pour négocier avec les Alliés, mais cette mission n’avait pu se tenir avant la conférence de Potsdam (17 juillet – 2 août 1945) qui allait aboutir à un ultimatum de capitulation sans négociation adressé par les Alliés au Japon.
C’est donc un pays affaibli et sur le point de capituler qui subit de plein fouet les deux bombardements atomiques de l’armée américaine les 6 et 9 août 1945. Si ces bombardements précipitèrent la demande de capitulation par le Japon, en revanche l’utilisation de l’arme atomique n’était pas nécessaire à cette capitulation. Partant de ce constat, de nombreux historiens ont critiqué le principal argument avancé par Washington pour justifier l’emploi de l’arme atomique : économiser les vies de centaines de milliers de soldats américains en but à un adversaire engagé dans une résistance acharnée. À partir des années 1960, ces historiens dits « révisionnistes » ont voulu démontrer que les responsables américains avaient agi selon des motifs inavouables : racisme antijaponais, volonté de tester la bombe dans le cadre du projet Manhattan, rivalité naissante avec la puissance soviétique dans le Pacifique.
Ces prises de positions historiographiques ne sont jamais totalement éloignées d’intentions politiques sous-jacentes, qu’il s’agisse de défendre la politique étrangère des États-Unis ou, à l’inverse, de critiquer l’impérialisme américain. Pour y voir plus clair dans ce débat, des travaux récents étudient au plus près les motivations des acteurs qui ont pris la décision d’utiliser l’arme atomique (hommes politiques, militaires, ingénieurs américains).
Ces travaux ont montré que l’arme atomique était considérée par l’administration américaine comme un outil parmi d’autres (blocus, bombardements aériens) pour mettre fin le plus rapidement possible à la guerre et économiser des vies américaines. En effet, à partir des combats sanglants de l’archipel d’Okinawa au printemps 1945, plusieurs études commandées par l’administration américaine calculèrent les pertes humaines causées par un éventuel débarquement au Japon. Le scénario retenu, connu sous le nom d’opération Olympic, faisait état de 500.000 victimes américaines, chiffre totalement inacceptable pour les autorités et l’opinion publique américaine.
Face à ces chiffres, le président Harry Truman (1884 – 1972) ne pouvait ignorer l’existence d’une arme qui, en cas de succès, permettrait de réduire de façon indiscutable le nombre de victimes. En outre, ne pas utiliser l’arme atomique aurait relevé d’un véritable suicide politique pour un homme nommé Président des États-Unis quelques semaines plus tôt sans même avoir été élu et qui jouait sa crédibilité dans les premiers mois de sa Présidence. Il faut encore ajouter le coût pharaonique (2 milliards de dollars) du projet Manhattan qui avait réuni depuis 1942 les autorités scientifiques américaines en charge de créer l’arme nucléaire pour comprendre qu’un tel coût ne pouvait pas être totalement ignoré par la Maison Blanche.
Enfin, l’utilisation de l’arme nucléaire créait une situation d’asymétrie immédiatement favorable à Washington face à l’Union soviétique qui figurait au premier rang des alliés devenus encombrants, voire indésirables. En ce sens, l’utilisation de la bombe atomique précipita la fin de la Seconde Guerre mondiale avant de lancer la course aux armements entre les deux superpuissances durant la Guerre froide, instaurant un équilibre de la terreur qui se maintint pendant plus de quarante ans.
Document : éditorial d’Albert Camus dans Combat, 8 août 1945
Le monde est ce qu’il est, c’est-à-dire peu de chose. C’est ce que chacun sait depuis hier grâce au formidable concert que la radio, les journaux et les agences d’information viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique. On nous apprend, en effet, au milieu d’une foule de commentaires enthousiastes, que n’importe quelle ville d’importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de la grosseur d’un ballon de football. Des journaux américains, anglais et français se répandent en dissertations élégantes sur l’avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets guerriers, les conséquences politiques et même le caractère indépendant de la bombe atomique. Nous nous résumerons en une phrase : la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l’utilisation intelligente des conquêtes scientifiques.
En attendant, il est permis de penser qu’il y a quelque indécence à célébrer ainsi une découverte qui se met d’abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l’homme ait fait preuve depuis des siècles. Que, dans un monde livré à tous les déchirements de la violence, incapable d’aucun contrôle, indifférent à la justice et au simple bonheur des hommes, la science se consacre au meurtre organisé, personne sans doute, à moins d’idéalisme impénitent, ne songera à s’en étonner.
Ces découvertes doivent être enregistrées, commentées selon ce qu’elles sont, annoncées au monde pour que l’homme ait une juste idée de son destin. Mais entourer ces terribles révélations d’une littérature pittoresque ou humoristique, c’est ce qui n’est pas supportable.
Déjà, on ne respirait pas facilement dans ce monde torturé. Voici qu’une angoisse nouvelle nous est proposée, qui a toutes les chances d’être définitive. On offre sans doute à l’humanité sa dernière chance. Et ce peut être après tout le prétexte d’une édition spéciale. Mais ce devrait être plus sûrement le sujet de quelques réflexions et de beaucoup de silence.
Au reste, il est d’autres raisons d’accueillir avec réserve le roman d’anticipation que les journaux nous proposent. Quand on voit le rédacteur diplomatique de l’agence Reuter annoncer que cette invention rend caducs les traités ou périmées les décisions même de Postdam, remarquer qu’il est indifférent que les Russes soient à Königsberg ou la Turquie aux Dardanelles, on ne peut se défendre de supposer à ce beau concert des intentions assez étrangères au désintéressement scientifique.
Qu’on nous entende bien. Si les Japonais capitulent après la destruction d’Hiroshima et par l’effet de l’intimidation, nous nous en réjouirons. Mais nous nous refusons à tirer d’une aussi grave nouvelle autre chose que la décision de plaider plus énergiquement encore en faveur d’une véritable société internationale, où les grandes puissances n’auront pas de droits supérieurs aux petites et aux moyennes nations, où la guerre, fléau devenu définitif par le seul effet de l’intelligence humaine, ne dépendra plus des appétits ou des doctrines de tel ou tel État.
Devant les perspectives terrifiantes qui s’ouvrent à l’humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d’être mené. Ce n’est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l’ordre de choisir définitivement entre l’enfer et la raison.
Éclairages : Albert Camus met en garde ses contemporains après le bombardement d’Hiroshima
Quand Albert Camus écrit son éditorial pour le journal Combat, le 6 ou le 7 août 1945, son intention est d’abord de nuancer l’enthousiasme avec lequel le premier bombardement d’Hiroshima (6 août 1945) a été reçu par la presse occidentale : « […] des journaux américains, anglais et français se répandent en dissertations élégantes sur l’avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets guerriers, les conséquences politiques et même le caractère indépendant de la bombe atomique ». Il est vrai qu’en août 1945, Le Monde s’intéresse avant tout aux caractéristiques techniques de la bombe quand le journal chrétien La Croix comme le journal communiste L’Humanité saluent le véritable progrès technique que constitue la première utilisation de l’arme atomique. De fait, il faudra attendre les années 1950, dans le contexte de la course aux armements entre les deux superpuissances, pour voir apparaître dans la presse française les commentaires plus inquiets sur Hiroshima et l’utilisation de l’arme nucléaire. En août 1945, la voix de Camus est encore isolée, en dépit de ses accents prophétiques.
Dans cet éditorial, Albert Camus s’interroge sur les réelles motivations de cet enthousiasme dans la presse occidentale : « Quand on voit le rédacteur diplomatique de l’agence Reuter annoncer que cette invention rend caducs les traités ou périmées les décisions même de Postdam, remarquer qu’il est indifférent que les Russes soient à Königsberg ou la Turquie aux Dardanelles, on ne peut se défendre de supposer à ce beau concert des intentions assez étrangères au désintéressement scientifique ». En effet derrière les commentaires positifs d’une partie de la presse, ce sont bien les positions militaires soviétiques qui sont jugées dépassées par l’avance atomique des États-Unis, ce qui semble apaiser les craintes de certains journaux opposés dès 1945 à l’extension de la puissance soviétique en Europe et dans le monde.
L’appel de Camus en faveur d’une « véritable société internationale » garantissant la paix se situe exactement entre la signature de la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945 et la ratification de ce texte le 24 octobre 1945 qui donne officiellement naissance à l’Organisation des Nations Unies (ONU). Ce texte est donc contemporain des interrogations sur la sécurité collective qui doit être assurée en 1945 dans le cadre des Nations Unies et dont le bombardement d’Hiroshima vient brusquement rappeler la fragilité : l’arme nucléaire offrira des moyens décuplés aux grandes puissances militaires pour imposer leurs « appétits et leurs doctrines ». Selon Camus, seule la garantie internationale de la paix permettra donc « de choisir entre l’enfer et la raison ».
Dans les heures qui suivirent le bombardement d’Hiroshima, Camus pouvait encore espérer dans la capacité d’une organisation internationale comme les Nations Unies de garantir la paix et de réguler l’utilisation de l’arme atomique. Il ne pouvait pas encore prévoir que la détention de l’arme nucléaire allait créer un d’équilibre de facto entre les deux superpuissances américaines et soviétiques aboutissant, selon les mots de Raymond Aron, à rendre « la guerre impossible » et la « paix improbable ». Il faudra finalement attendre plus de deux décennies pour que soit signé, en 1968, le Traité de Non-Prolifération (TNP), pierre angulaire de la lutte contre la prolifération des armes nucléaires.
Barthélémy Courmont , « 6 et 9 août 1945 : les bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki », Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 12/05/23, consulté le 15/05/2023.