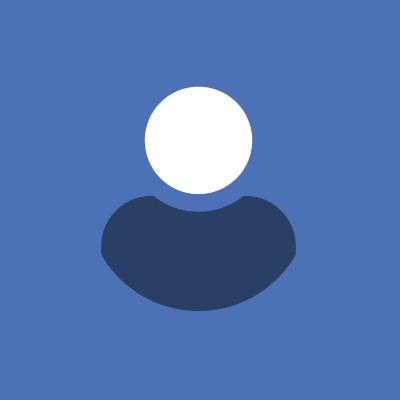Notes / Observatoire géopolitique du religieux
30 novembre 2011
Dynamiques politiques du christianisme en asie centrale

Après la dissolution de l’Union soviétique, les nouveaux États indépendants d’Asie centrale ont développé une rhétorique soulignant la renaissance de la liberté religieuse dans la région après deux tiers de siècle marqués par des tentatives régulières de mise en place d’un athéisme d’État par le régime soviétique. L’influence historique de l’islam dans la région a vite retrouvé de la vigueur sous une pluralité de formes, mais des courants religieux non musulmans ont également pu s’exprimer à nouveau, notamment le christianisme, à travers plusieurs mouvances parfois concurrentes. Mais il faudrait plutôt parler de christianismes au pluriel. La superposition des héritages politiques et culturels de l’Asie centrale contemporaine révèle sa richesse religieuse. Ainsi le christianisme qui s’y est implanté à partir du VIème siècle après J.C. sous l’impulsion des « nestoriens » a disparu d’Asie centrale au XIVème siècle à la suite des conquêtes de Tamerlan pour réapparaître sous une forme bien différente au XIXème siècle avec la conquête de la région par la Russie orthodoxe et trouver un nouveau dynamisme dès le début des années 1990, via des mouvements missionnaires protestants. Les recherches menées par plusieurs générations de chercheurs, de Jean-Paul Roux (1925-2009) à Sébastien Peyrouse aujourd’hui, sans oublier l’héritage d’orientaliste comme Paul Pelliot (1878-1945), nous invitent à nous interroger sur la place du christianisme en Asie centrale et son enracinement dans l’histoire centrasiatique. Elles nous permettent ainsi de mieux comprendre des dynamiques régionales qui écartent la tentation du « choc des civilisations », mettent fermement à mal les stéréotypes sur la situation des religions minoritaires en terre d’islam et révèlent la prégnance d’un contrôle politique des cultes, construit et pérennisé pour mieux gouverner les populations.